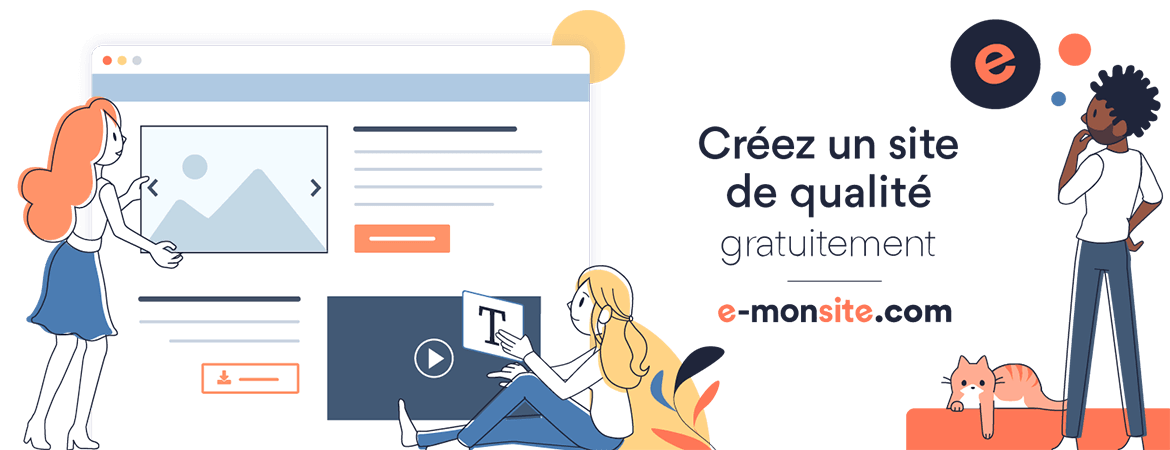Charlotte Corday ou le mysticisme révolutionnaire
Charlotte Corday ou le mysticisme révolutionnaire
 Dans le cadre d’une étude des principales figures féminines révolutionnaires, je vous propose ici le cas de Charlotte Corday qui fit couler beaucoup d’encre (à défaut d'écrire elle-même)… et le sang de Marat.
Dans le cadre d’une étude des principales figures féminines révolutionnaires, je vous propose ici le cas de Charlotte Corday qui fit couler beaucoup d’encre (à défaut d'écrire elle-même)… et le sang de Marat.
Marie-Anne-Charlotte de Corday d’Armont naît le 27 juillet 1768 en fin de matinée à Saint-Saturnin-des-Ligneries, entre Argentan et Vimoutiers, dans la ferme du Ronceray. Voici son acte de baptême, établi le 28 juillet : « Ce vingt-huit de juillet mil sept cent soixante-huit, par nous soussigné curé, a été baptisée Marie-Anne-Charlotte née d’hier. » Il est bon de savoir qu’une ordonnance du roi François Ier contraint les prêtres à tenir un registre des naissances dès 1539. Louis XIV, quant à lui, obligera les parents à baptiser les enfants au plus tard le lendemain de la naissance.
Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur son enfance et son adolescence, éléments fondateurs chez tout être humain. Après avoir analysé le choix de Marat, nous la suivrons au long de son épopée parisienne jusqu’à son issue fatale.
1/ Une enfance misérable
À son hérédité paternelle, elle doit des idées libertaires et novatrices qu’elle défend avec ardeur. Toute jeune, elle fait preuve d’un enthousiasme excessif. Fanchon Marjotte, une amie de jeunesse, note : « Elle mettait une fougue extrême dans ses jeux. Il fallait tout quitter pour jouer avec elle. » Elle met sa combativité et sa force de caractère au service d’une vie quotidienne assez difficile : « Cette fille est sans pitié pour elle-même. Elle ne se plaint jamais et je suis obligée de deviner quand elle est malade, car elle ne le dirait pas », dit sa mère qui mourra à quarante-six ans le mardi 9 avril 1782 d’une fausse couche lors de sa septième grossesse.
Charlotte vit dans des conditions très modestes et met la main à la pâte très jeune : à six ans, elle arrose les légumes et les cueille, étend le linge, donne à manger aux poules et ramasse les œufs. Son père, ancien officier, a démissionné et attend la dot de sa femme, qui ne sera jamais payée. En 1774, Charlotte perd sa sœur aînée, événement dont sa mère ne se remettra pas. Charlotte, en manque affectif, devient emportée, agressive et susceptible. Elle aide sa mère à s’occuper de sa cadette, Éléonore, qui souffre de malformations, une paralysie partielle l’empêchant de se déplacer. Elle a encore deux autres frères, Alexis et Charles. Six personnes dans une petite ferme et peu de revenus : la misère s’installe et donne à Charlotte une maturité prématurée. Jour après jour, elle combat énergiquement : « Elle s’appliquait à tous les travaux de ménage pour soulager sa mère […]. Elle remplissait les fonctions dont elle avait voulu se charger avec la maturité d’une petite femme », témoigne une amie des Corday, Mme de Maromme, dans ses Mémoires.
2/ Une adolescence vouée à la lecture
Pensionnaire durant neuf ans au couvent de La Trinité qui dépend de l’Abbaye-aux-Dames de Caen, d’une religiosité plutôt tiède, Charlotte va s’adonner aux études et à la lecture en totale liberté, chose plutôt rare en ce lieu et à cette époque. Mais le règlement est peu strict et l’abbesse lui laisse toute latitude à cet égard en raison de la « lucidité » de la jeune fille (voire !) et de « l’élévation de ses sentiments », déclare-t-elle. Ses lectures et ses études la pousseront à l’action dans une espèce de compensation héroïque à la déficience affective de son enfance.
Pour l’instant, dans la solitude de la bibliothèque et à l’abri des plaisirs du monde, elle rêve et médite sur la littérature classique, notamment Corneille (dont elle est l’une des arrière-petites-nièces) et ses héroïnes tragiques. Le Cid est son livre de chevet et elle apprécie ces vers de Cinna : « Plus le péril est grand, plus doux est le fruit / La vertu nous y jette et la gloire la suit. / Meurs s‘il faut mourir en citoyen romain / Et par un beau trépas couronne un beau dessein. »
Vertu, gloire, Rome et trépas, tels sont les termes qui résument bien le destin de Charlotte. On pense ici à cette remarque de Napoléon : « A l’influence du grand Corneille la France doit quelques-unes de ses grandes actions ; la tragédie élève l’âme humaine, anime le cœur d’une noble passion et avec des hommes fait des héros. »
On la laisse lire les philosophes des Lumières et elle s’enthousiasme pour Rousseau dont elle apprécie la sincérité passionnée et généreuse : « L’homme naît bon […]. Tous les avantages de la société ne sont-ils pas pour les puissants et les riches ? » Elle souligne et médite des passages du Contrat social, notamment cette phrase : « Il [un citoyen en désaccord avec l’État] doit être retranché par la mort comme ennemi public. » Robespierre souscrit à cette thèse et Charlotte l’appliquera à Marat, ennemi juré de la République et responsable à lui tout seul de la Terreur, selon elle. On devine ici la naissance de l’idée fixe et une méconnaissance de la situation réelle. Le meurtre sera donc le prix à payer pour construire un monde nouveau.
Mais son livre préféré et dont elle connaît des passages par cœur reste L’Histoire philosophique et politique de l’abbé Raynal, publié en 1770 en dix volumes où, comme Voltaire dans son Dictionnaire philosophique, il dénonce l’injustice sociale et prône la légalité du meurtre et du pillage. Un témoin précise : « Elle résistait, elle avait des convictions et les défendait même contre un curé, un confesseur, et les aurait aussi bien défendues contre un évêque […] ; elle avait plus de force et d’indépendance que les autres jeunes filles de son âge. L’abbesse elle-même en était effrayée. »
Elle développe ainsi un sens de la justice pas toujours bien compris, se fait quelques illusions et, comme ces concitoyens, souscrit au mécontentement général contre le pouvoir à partir de 1785 et de la fameuse Affaire du Collier de la Reine. Elle a une vision simpliste de la situation générée par la misère insoutenable qui accable la France, due en grande partie aux hivers rigoureux de 1787 et 1789 et aux mauvaises récoltes de blé. Elle cherche toujours à s’informer en lisant la presse, notamment Le Courrier universel et, plus tard, L’Ami du Peuple, de Marat, et en discutant avec le neveu de l’abbesse.
3/ La jeune fille
Le dimanche 16 mars 1789, elle assiste avec enthousiasme au départ des députés du Tiers qui doivent se réunir à Versailles le 4 mai. Le 15 juillet, à l’arrivée de la diligence, la nouvelle du renvoi de Necker (le 11 juillet), soutenu par le peuple se propage. Mais elle fonde un grand espoir dans la prise de la Bastille. Le 12 août cependant, avec le meurtre sordide du major de Belzunce, chargé de surveiller le ravitaillement en blé de Caen mais accusé d’affamer le peuple, elle prend conscience de la barbarie de la populace.
Charlotte est particulièrement sensible aux misères des uns et des autres, avec un sens du service aiguisé : elle se veut utile. Elle imagine une révolution légale, voire légalisée, reposant sur des discours, des motions et des signatures.
Après la saisie des biens du clergé par l’État, elle quitte l’abbaye le 12 juin 1791 et se rend dans la ferme de son père à Argentan. Pour donner un sens concret et actif sa vie, elle donne des leçons aux petites filles pauvres : dentelle et tapisserie, dessin et catéchisme, lecture et français. Mais son impétuosité naturelle ne peut s’extérioriser librement dans cette existence routinière et monotone d’une jeune fille de la campagne qui a besoin de s’exprimer, voire de briller, d’une manière ou d’une autre. Charlotte choisira la manière forte, qui en fera une martyre de la Révolution pour l’éternité.
Elle décide donc de regagner Caen où elle réside chez une lointaine cousine, elle aussi descendante de Corneille, Mme de Bretteville. Charlotte va passer là deux années décisives, en prise avec les événements, lisant, s’informant et, dans le secret de son âme, méditant une action décisive. C’est ainsi qu’un familier, Frédéric Corday de Renouard affirme : « Charlotte avait le feu sacré de l’indépendance, ses idées étaient arrêtées et absolues, elle faisait ce qu’elle voulait. On ne pouvait la contraindre, c’était inutile ; elle n’avait jamais de doutes, jamais d’incertitudes. Son parti une fois pris, elle n’admettait plus de contradiction. » Un autre témoin déclare : « Têtue, elle s’accroche à ses idées, elle a une opinion sur tout dont elle change rarement. » Charlotte a une idée fixe inébranlable : construire une République pour le bonheur de tous. Sans doute faut-il y voir son appartenance à une génération éprise d’absolu, de liberté et d’amour universel.
Chez sa cousine, elle assiste à quelques mondanités. Mme de Maromme écrit : « Elle méprisait nos mœurs faciles et relâchées ; elle regrettait les beaux temps de Sparte et de Rome. Elle aurait dû naître dans ces temps héroïques. » Plus tard, Manon Roland souscrira au même jugement, voyant en Charlotte « une héroïne d’un siècle meilleur. »
Cependant, elle goûte là quelque peu à l’affection, la tendresse et la douceur qui lui manquèrent tant dans son enfance. Mme de Bretteville éprouve pour elle une affection maternelle : « Je ne puis me passer de cette jeune fille, c’est la bonté simple unie à la candeur et à la discrétion. »
4/ La jeune femme raffinée
Surtout, elle lui apprend à se mettre en valeur, ce qui ne déplaît pas à Charlotte, belle et bien faite. Toute jeune, elle soigne déjà sa toilette et sa coiffure : « Elle avait un ruban autour de la tête et ses cheveux plats ou tressés tombaient an aval sur le dos », témoigne une amie de jeunesse. Du reste, Charlotte a la nostalgie de la vie raffinée menée quelque temps dans la demeure de ses grands-parents paternels, à Cauvigny.
Lors de voyage vers Paris (dont on sait qu’elle ne reviendra pas), elle prépare soigneusement sa malle, emportant deux chemises, deux jupons, deux paires de bas de coton, quatre mouchoirs blancs, un peignoir de toile, deux bonnets de linon, quatre fichus, un déshabillé de basin rayé, un dé d’argent, du fil et des aiguilles.
Le jour de son départ, le 9 juillet 1793, elle revêt une toilette de voyage bleu foncé et un chapeau à haute calotte noire. Une fois arrivée à Paris, avant de quitter l’Hôtel de la Providence, elle dispose soigneusement ses affaires : les enquêteurs trouveront ses effets bien rangés, comme il se doit à une jeune fille coquette et vertueuse. Avant l’assassinat de Marat, elle s’occupe d’elle une dernière fois, commande la prestation d’un perruquier pour lequel elle se vêt d’une « robe de basin moucheté de brun ». Enfin, ultime geste, elle retire le cordon noir de son chapeau de feutre et le remplace par un ruban vert, couleur que Camille Desmoulins avait choisie en signe d’espoir dans les jardins du palais-Royal. Geste symbolique certes, mais il n’est pas innocent qu’elle utilise son corps et les ornements à sa disposition.
Du reste, le matin de son procès, elle demande à la concierge de la prison un carré de linon, du fil et des aiguilles pour confectionner un bonnet et retoucher sa robe et son fichu. Et que penser de son attitude à la Conciergerie, lorsqu’un élève de David vient faire son portrait ? Car c’est son dernier vœu, se faire peindre ! Elle semble flattée, se recoiffe, ajuste sa robe, se lève de temps à autre pour donner son avis et rectifier le tracé d’u sourcil… Toute mort oubliée, elle se veut parfaite, elle qui, sa vie durant, ignora sa jeunesse, son charme et sa beauté, auxquels n’est pas insensible Montané, le président du Tribunal. Beauté inutile : aucun homme ne fait impression sur elle, ses pensées sont ailleurs. L’autopsie révèle bien entendu sa virginité.
Réservée et timide, « elle ne cherchait ni à plaire, ni à briller », note encore Mme de Maromme. Et cependant, elle séduit de nombreux prétendants ; ils ne l’intéressent que dans la mesure où elle peut avoir avec eux des discussions d’ordre politique. Elle se veut honnête et n’éprouve que répulsion pour ces désirs humains, trop humains. Elle avoue une seule faiblesse, sa gourmandise : tout enfant, elle se goinfrait de volaille à la cuisine.
5/ Pourquoi Marat ?
Un problème d’importance se pose : pourquoi précisément Marat ? Simplement parce qu’elle ne connaît véritablement que lui, tant est grande la diffusion en province comme à Paris de L’Ami du Peuple. Le valet de Mme de Bretteville, Augustin Leclerc, qu’elle apprécie car il s’intéresse à la politique et participe aux séances des clubs, lui fait lire les articles de Marat dès septembre 1791, le journal étant né le 16 septembre 1789. Charlotte pressent en lui un élément dangereux et comprend qu’il utilise la pauvreté et la souffrance d’une population victime du despotisme depuis des siècles pour servir sa propre cause, et non celle de l’humanité. Fin psychologue, il dirige la colère du peuple révolté qui boit ses paroles et la transforme en une rage meurtrière. Qu’on en juge : « Quand un homme manque de tout, il a le droit d’arracher à un autre le superflu dont il regorge, que dis-je, il a le droit de lui arracher le nécessaire et plutôt que de périr de faim, il a le droit de l’égorger et de dévorer sa chair palpitante. » Ou encore : « Personne plus que moi n’abhorre l’effusion du sang mais pour en empêcher qu’on en verse à flots, je vous presse d’en verser quelques gouttes. » Lors de la prise des Tuileries le 10 août 1792, il déclare que 270 000 têtes doivent être coupées au nom de la liberté.
Amie de Barbaroux, Charlotte est d’abord proche de la presse girondine modérée qui voit en Marat un « monstre altéré de sang, méchant de caractère, féroce par instinct » ; elle-même l’appelle « le fauve ».
Le procès de Louis XVI déchaîne les passions. Charlotte espère que les députés se rachèteront car le régicide serait une légitimation des massacres de septembre 1792 où on atteint les sommets de l’horreur : du 2 au 5 septembre, 1 200 personnes sont exécutées dans les prisons parisiennes et Charlotte tombe en prières. Elle rejoint ici l’opinion de Manon Roland. Marat demande un vote à haute voix ; nul n’ose se compromettre. Charlotte apprend la mort du roi deux jours après son exécution. Elle écrit alors à Rose Fougeron de Fayot, rencontrée chez Mme de Bretteville : « Voilà donc notre pauvre France livrée aux misérables qui nous ont déjà fait tant de mal […]. Je frémis d’horreur et d’indignation […]. Tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté l’ont assassinée ; ce ne sont que des bourreaux. Pleurons sur le sort de notre pauvre France ! » Elle n’accorde plus de crédit aux Girondins qu’elle juge désormais trop modérés. Ce n’est pas en jouant la carte de la modération qu’on se débarrassera des Montagnards et de Marat. Naïvement, elle voudrait exclure de l’Assemblée ces hommes qui parlent au nom des Français ; après, on y verrait plus clair et on pourrait restaurer la religion. En somme, elle veut asseoir la démocratie selon les bonnes recettes des temps anciens.
On note ici dans sa pensée un idéal irréalisable curieusement allié à une clairvoyance incontestable de la situation politique et de l’avenir. Elle écrit par exemple à une amie d’enfance : « Je ne déteste pas notre roi, au contraire, parce qu’il est plein de bonnes intentions, mais, comme vous me l’avez dit vous-même, l’enfer aussi est plein de bonnes intentions et ce n’en est pas moins l‘enfer […]. Sa faiblesse fait son malheur et aussi le nôtre […]. Les amis du roi le perdront, je vous le dis, parce que le roi n’a pas le courage de renvoyer ses mauvais conseillers. » En prenant l’exemple de Tarquin de Rome, elle prédit la trahison de Philippe-Égalité au procès du roi. Et, bien entendu, elle reproche à ce dernier d’avoir signé une Constitution qui disloquera l’Eglise et justifiera l’assassinat des prêtres réfractaires.
Son insouciance et son enthousiasme des débuts sont brisés par les excès de la Révolution. Passionnée par ses idées, elle est incapable de faire la part des choses entre sa vie privée et le sort de la France, et prend sa décision. Charlotte ne se reconnaît pas dans cette société où l’on veut contraindre les femmes à rester au foyer pour se consacrer aux tâches ménagères. Ne vient-on pas de guillotiner Théroigne de Méricourt, « l’Amazone rouge » ?
6/ Paris
 Avant son départ qu’elle prépare soigneusement (elle demande son passeport le 8 avril et un visa pour Paris le 23), elle relit Xénophon, Platon, Socrate et surtout Aristote qui officialise le tyrannicide « dans la logique du droit naturel » (Platon, Éthique, III, I). Elle trouve une justification à son acte dans la religion : « Le meurtre du tyran est légitime tant que ce dernier n’a pas acquis un juste titre », écrit Saint-Thomas d’Aquin. Elle ne parle à personne de son départ, encore moins de son but. Un contemporain note : « Nul ne la poussa à son dessein et nul n’en reçut confidence. Une fois sa résolution arrêtée, toute délicatesse féminine, tout retour sur soi-même, toute affection de la famille s’éteignent devant une telle perspective. Son cœur, si humain et si doux se revêtit alors comme d’une armure qui la rendit inaccessible à tous les sentiments étrangers à son projet. Calme, forte, résignée, une fois convaincue que le coup qu’elle allait frapper ferait tomber un joug odieux et ranimerait ses concitoyens à des idées plus généreuses, elle ne jeta pas un seul regard de pitié sur elle-même et ne donna pas une larme à l’effroyable fin qu’elle se préparait ; elle fut sans faiblesse, comme sans remords. Elle oublia sa jeunesse, sa beauté, la douleur qu’elle allait causer à ses parents, à ses amis, et le danger auquel elle les exposait […] ; la victime était marquée et le sacrifice devait s’accomplir. »
Avant son départ qu’elle prépare soigneusement (elle demande son passeport le 8 avril et un visa pour Paris le 23), elle relit Xénophon, Platon, Socrate et surtout Aristote qui officialise le tyrannicide « dans la logique du droit naturel » (Platon, Éthique, III, I). Elle trouve une justification à son acte dans la religion : « Le meurtre du tyran est légitime tant que ce dernier n’a pas acquis un juste titre », écrit Saint-Thomas d’Aquin. Elle ne parle à personne de son départ, encore moins de son but. Un contemporain note : « Nul ne la poussa à son dessein et nul n’en reçut confidence. Une fois sa résolution arrêtée, toute délicatesse féminine, tout retour sur soi-même, toute affection de la famille s’éteignent devant une telle perspective. Son cœur, si humain et si doux se revêtit alors comme d’une armure qui la rendit inaccessible à tous les sentiments étrangers à son projet. Calme, forte, résignée, une fois convaincue que le coup qu’elle allait frapper ferait tomber un joug odieux et ranimerait ses concitoyens à des idées plus généreuses, elle ne jeta pas un seul regard de pitié sur elle-même et ne donna pas une larme à l’effroyable fin qu’elle se préparait ; elle fut sans faiblesse, comme sans remords. Elle oublia sa jeunesse, sa beauté, la douleur qu’elle allait causer à ses parents, à ses amis, et le danger auquel elle les exposait […] ; la victime était marquée et le sacrifice devait s’accomplir. »
Elle prévoit son départ pour le 8 juillet, le décale d’un jour, écrit une dernière missive au député Barbaroux : « Adieu, mon cher député, je pars demain pour Paris, je veux voir les tyrans en face. » À son père, elle écrit qu’elle émigre en Angleterre afin qu’il ne s’inquiète pas et grimpe enfin, le mardi 9 juillet, dans la « turgotine », cette diligence que l’on doit à Turgot depuis 1775 et qui peut accueillir quatre à huit personnes, tirée par six à huit chevaux, à la caisse très étroite et suspendue à des ressorts, ce qui en fait un moyen de locomotion rapide : deux lieues à l’heure… Durant le voyage, elle ne cherche pas à se mettre en valeur bien qu’elle séduise un ou deux voyageurs ; elle reste silencieuse sur la situation calamiteuse de la France, ne voulant pas que, plus tard, on puisse l’associer à un parti politique quelconque.
La diligence arrive le jeudi 11 juillet vers onze heures du matin dans la cour des Messageries. Après quarante-cinq heures de voyage et sous une température de trente degrés, elle cherche un hôtel convenable ; ce sera celui « de la Providence », le bien nommé… Dans le registre, on peut lire : « Le 11 juillet – Demoiselle Marie Corday du Département Calvados – Chambre 4 pour 5 nuits – 7 livres. » On imagine l’ambiance parisienne, les préparatifs pour la Fête Nationale et Charlotte, seule, qui se renseigne sur le domicile de Marat. En effet, elle ne sait rien de lui, ignore qu’il n’est pas en bonne santé – en fait, il est en phase terminale de sa maladie et serait mort quelques mois plus tard de son eczéma scrofuleux, variante de la tuberculose – et l’imagine présent à toutes les séances de la Convention : c’est là qu’elle pense commettre le meurtre. Elle apprend donc qu’il est malade et ne bouge pas de chez lui. A l’Hôtel de la Providence, elle rédige son Adresse aux Français, véritable testament politique où elle justifie son geste. Mais elle ne comprend pas que derrière Marat, des dizaines de candidats attendent leur tout pour prendre le pouvoir. C’est ainsi que Manon Roland parle d’une « femme étonnante, mais faute de bien connaître l’état des choses, elle a mal choisi son temps et sa victime. » Charlotte sous-estime l’importance de Danton et de Robespierre et s’illusionne : « Je veux que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens, que ma tête portée dans Paris soit un signe de ralliement pour tous les amis des lois, que la Montagne chancelante voie sa perte écrite avec mon sang et que je sois leur dernière victime. » Et cette ultime phrase : « Je vous ai montré le chemin. » Quelle erreur ! La Terreur se profile : 22 938 personnes vont mourir. Mais elle reste persuadée d’être investie d’une mission sacrée et l’on comprend que son avocat, Chauveau-Lagarde (l’avocat de Marie-Antoinette, de Brissot et de Mme Élisabeth) ait tenté de la faire passer pour folle.
À l’aube du dernier jour, le 13 juillet, elle se rend dès sept heures du matin au Palais-Royal (appelé Palais de la Révolution depuis septembre 1792), entre chez le coutelier Badin aux alentours de huit heures, achète un modeste couteau de cuisine pointu et fin, de « grandeur ordinaire » ; la lame mesure cinq pouces (13, 83 centimètres) ; elle le paie 40 sols avec la gaine en cuir. Elle dira plus tard qu’elle n’acheta pas de poignard afin de ne pas se faire remarquer.
Elle se rend une première fois chez Marat dans la matinée, entre onze heures et onze heures trente, mais on refuse de la recevoir. Elle a alors l’idée de lui écrire une lettre qui sera distribuée par la petite poste avant six heures : « Je viens de Caen. Votre amour pour la patrie doit vous faire désirer de connaître les complots que l’on y médite, j’attends votre réponse. » Elle ne signe pas et ne laisse pas d’adresse, appâtant sa proie. Elle retourne donc chez Marat, parvient jusqu’à lui en dépit de l’hostilité de deux servantes et l’atteint – par hasard – en plein cœur dans sa baignoire. Il est sept heures trente du soir.
On l’arrête tout de suite, on lui lit le procès-verbal sur place dans la nuit du 13 au 14 ; elle apporte des précisions et des rectifications. Hébert écrit le lendemain du 14 juillet dans Le Père Duchesne : « Elle est allée en prison aussi tranquillement qu’à un bal. » Charlotte, en effet, porte une attention particulière à l’image qu’elle veut laisser à la postérité et adopte une attitude froide, distante et hautaine.
Cependant, alors qu’on l’emmène vers la prison de l’Abbaye, elle redoute d’être massacrée et « tombe en faiblesse », dit le député Drouot – l’homme de Varennes -. Elle semble étonnée que le peuple écoute les représentants de la loi qu’elle imaginait sans aucun pouvoir face à un peuple sanguinaire et incontrôlable et dont elle se faisait une représentation caricaturale : encore une fois, il faut noter sa perception faussée et pas vraiment objective des événements, influencée par ses lectures. La voilà soulagée de se retrouver en prison où attendent trois cents futures victimes : « Ah ! Je respire, je craignais bien de ne pas arriver jusqu’ici et que le peuple ne me mît en pièces, j’en serai quitte pour la guillotine et c’est une mort bien douce. » Charlotte a droit à une cellule particulière et s’en glorifie. On la transfère à la Conciergerie le 16 juillet vers dix heures du matin.
Lors de l’instruction du procès, Charlotte répond d’une manière claire et précise, n’hésite jamais, se tient droite et reste calme, telle une icône pour la postérité. Elle avoue tout, avec un sens de l’à-propos qui déstabilise même Fouquier-Tinville. On veut le nom de ses complices mais elle n’en a point, ce qui surprend Montané, le président du Tribunal, qui s’exclame : « Mais enfin Madame, une personne de votre sexe et de votre âge ne peut pas être déterminée à faire un voyage à Paris pour y assassiner un homme qu’elle ne connaît pas ! » Il a raison. Dans son Adresse aux Français, Charlotte, consciente de sa jeunesse, écrit : « Je joins mon extrait de baptême pour montrer ce que peut la plus faible main conduite par un entier dévouement. » Et l’on pressent peut-être ici la « folie » de Charlotte, une idée fixe poussée jusqu’au bout dans ses ultimes conséquences, une exaltation du fanatisme politique. Il est intéressant de relever, dans le compte-rendu du procès, sa propre définition de l’anarchie : sont anarchistes « ceux qui cherchent à détruire toutes les lois pour établir leur autorité. » A Montané, sensible à son charme et qui réclame ses complices, elle rétorque : « C’est mal connaître le cœur humain, il est plus facile d’exécuter un tel projet d’après sa propre haine que d’après celle des autres. »
Nous sommes le 17 juillet, l’exécution est prévue pour la fin de l’après-midi. De retour dans sa cellule, elle termine une lettre à Barbaroux : « Si quelques amis demandaient communication de cette lettre, je vous prie de ne la refuser à personne. » Elle sait que ses écrits seront gardés, étudiés et retranscrits, se montrant toujours soucieuse de la postérité. Elle écrit une dernière lettre à son père, lui rappelant ce vers de Corneille : « Le crime fait la honte et non point l’échafaud. » On vient terminer son portrait, elle coupe elle-même une mèche de cheveux qu’elle remet au peintre. Samson la revêt de la chemise rouge des parricides – un représentant du peuple étant considéré comme le père de la patrie – et décrètera plus tard : « Depuis le chevalier de la Barre, je n’avais pas rencontré tant de courage pour mourir. »
Et Charlotte devient l’actrice principale d’un spectacle qui va durer une heure trente, lors d’un voyage effroyable sous la pluie et les huées de la populace en furie, choquée de son attitude fière et de son sourire, mais également subjuguée. Un témoin raconte : « On eût dit une statue tant son beau visage était calme […]. Je fus pendant huit jours au moins amoureux de Charlotte Corday. »
Sur l’échafaud, ses mouvements ont « cet abandon voluptueux et décent qui est au-dessus de la beauté », souligne un journaliste de la Chronique de Paris. Le couperet tombe à dix-huit heures trente. Son corps est jeté dans la fosse commune n°5, entre celle de Louis XVI (n°4) et de Philippe-Égalité (n°6), compagnie fort symbolique et ironie du destin.
Charlotte est une ardente héroïne de la Révolution et non pas une royaliste illuminée, comme on l’a cru pendant deux siècles, en dépit des travaux des historiens : les légendes sont tenaces !
Sources :
Charlotte Corday, Martial Debriffe, Éditions France-Empire, 2005.
La Mort de Marat, Jacques Guilaumou, Éditions Complexe, 1989.
Remarque
Dans ses Portraits littéraires, à propos de Corneille, Sainte-Beuve écrit : « Charlotte Corday était arrière-petite-fille d'une des filles de Pierre Corneille. » Il précise en note : « D'autres font d'elle seulement une arrière-petite-nièce du grand tragique : il y a des doutes et même il y a eu des procès sur cette généalogie. »
Ode à Charlotte Corday (André Chénier)
Ode à Charlotte Corday
À Charlotte Corday
« Quoi ! tandis que partout, ou sincères ou feintes,
Des lâches, des pervers, les larmes et les plaintes
Consacrent leur Marat parmi les immortels,
Et que, prêtre orgueilleux de cette idole vile,
Des fanges du Parnasse un impudent reptile
Vomit un hymne infâme au pied de ses autels ;
*
La vérité se tait ! Dans sa bouche glacée,
Des liens de la peur sa langue embarrassée
Dérobe un juste hommage aux exploits glorieux !
Vivre est-il donc si doux ? De quel prix est la vie,
Quand, sous un joug honteux, la pensée asservie,
Tremblante, au fond du cœur, se cache à tous les yeux ?
*
Non, non. Je ne veux point t'honorer en silence,
Toi qui crus par ta mort ressusciter la France
Et dévouas tes jours à punir des forfaits.
Le glaive arma ton bras, fille grande et sublime,
Pour faire honte aux dieux, pour réparer leur crime,
Quand d'un homme à ce monstre ils donnèrent les traits.
*
Le noir serpent, sorti de sa caverne impure,
A donc vu rompre enfin sous ta main ferme et sûre
Le venimeux tissu de ses jours abhorrés !
Aux entrailles du tigre, à ses dents homicides,
Tu vins redemander et les membres livides
Et le sang des humains qu'il avait dévorés !
*
Son œil mourant t'a vue, en ta superbe joie,
Féliciter ton bras et contempler ta proie.
Ton regard lui disait : « Va, tyran furieux,
Va, cours frayer la route aux tyrans tes complices.
Te baigner dans le sang fut tes seules délices,
Baigne-toi dans le tien et reconnais des dieux. »
*
La Grèce, ô fille illustre ! admirant ton courage,
Épuiserait Paros pour placer ton image
Auprès d'Harmodius, auprès de son ami ;
Et des chœurs sur ta tombe, en une sainte ivresse,
Chanteraient Némésis, la tardive déesse,
Qui frappe le méchant sur son trône endormi.
*
Mais la France à la hache abandonne ta tête.
C'est au monstre égorgé qu'on prépare une fête
Parmi ses compagnons, tous dignes de son sort.
Oh ! quel noble dédain fit sourire ta bouche,
Quand un brigand, vengeur de ce brigand farouche,
Crut te faire pâlir, aux menaces de mort !
*
C'est lui qui dut pâlir, et tes juges sinistres,
Et notre affreux sénat et ses affreux ministres,
Quand, à leur tribunal, sans crainte et sans appui,
Ta douceur, ton langage et simple et magnanime
Leur apprit qu'en effet, tout puissant qu'est le crime,
Qui renonce à la vie est plus puissant que lui.
*
Longtemps, sous les dehors d'une allégresse aimable,
Dans ses détours profonds ton âme impénétrable
Avait tenu cachés les destins du pervers.
Ainsi, dans le secret amassant la tempête,
Rit un beau ciel d'azur, qui cependant s'apprête
A foudroyer les monts, à soulever les mers.
*
Belle, jeune, brillante, aux bourreaux amenée,
Tu semblais t'avancer sur le char d'hyménée ;
Ton front resta paisible et ton regard serein.
Calme sur l'échafaud, tu méprisas la rage
D'un peuple abject, servile et fécond en outrage,
Et qui se croit encore et libre et souverain.
*
La vertu seule est libre. Honneur de notre histoire,
Notre immortel opprobre y vit avec ta gloire ;
Seule, tu fus un homme, et vengeas les humains !
Et nous, eunuques vils, troupeau lâche et sans âme,
Nous savons répéter quelques plaintes de femme ;
Mais le fer pèserait à nos débiles mains.
*
Un scélérat de moins rampe dans cette fange.
La Vertu t'applaudit ; de sa mâle louange
Entends, belle héroïne, entends l'auguste voix.
Ô Vertu, le poignard, seul espoir de la terre,
Est ton arme sacrée, alors que le tonnerre
Laisse régner le crime et te vend à ses lois. »
* * *
A table
Charlotte Corday a été honorée (…) par un dessert à la crème glacée par le chef Charles Ranhofer du restaurant Delmonico’s à New-York.
Date de dernière mise à jour : 01/08/2023