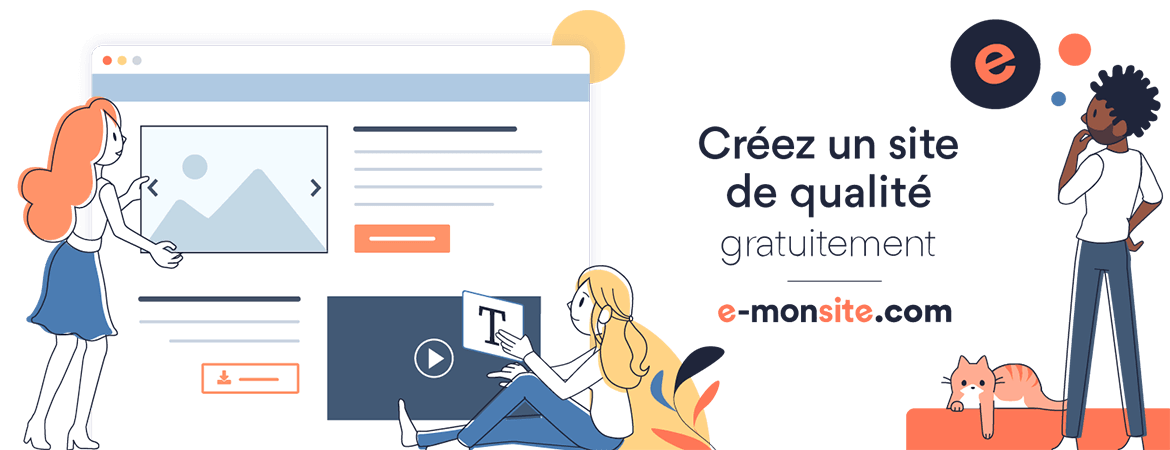Salons de Diderot
À propos des Salons
L’Académie royale de peinture et de sculpture expose tous les deux ans des œuvres françaises au Louvre, entendant ainsi rivaliser (à juste titre) avec les œuvres italiennes et flamandes. Le salon s’ouvre généralement le jour de la Saint-Louis (le 25 août) et dure de quatre à six semaines. Le peuple n’est autorisé à y venir que le dimanche, le reste de la semaine étant réservé aux nobles et aux bourgeois. Diderot, toujours impécunieux, écrit ses Salons, première tentative de critique esthétique, qui sera reprise au siècle suivant par Baudelaire.
Contre Boucher
Dans ses Salons, Diderot tonne contre les scènes libertines alors fort à la mode. Il s'en prend régulièrement à Boucher et à son gendre Baudouin, coupables selon lui de complaisance grivoise. Pour lui, ces peintres accumulent objets et corps, les réduisant à la quantité, à la confusion, au pêle-mêle et au tapage. Il apprécie ce qu'il appelle le peinture « honnête » et écrit dans le salon de 1767 :
« Artistes, si vous êtes jaloux de la durée de vos ouvrages, je vous conseille de vous en tenir aux sujets honnêtes. Tout ce qui prêche aux hommes la dépravation est fait pour être détruit, et d’autant plus sûrement que l’ouvrage sera plus parfait. Il ne subsiste presque plus aucune de ces infâmes et belles estampes que le Carrache a composées d’après l’impur Arétin. » [Plusieurs séries de gravures érotiques ont été associées aux sonnets de l’Arétin. Ces recueils ont été diffusés et réimprimés clandestinement à travers l’Europe.]
Dans son Salon de 1765, Diderot écrit à propos de Boucher : « Je ne sais que dire de cet homme-ci. La dégradation du goût, de la couleur, de la composition, des caractères, de l'expression, du dessin a suivi pas à pas la dépravation des mœurs. Que voulez-vous que cet artiste jette sur la toile ? Ce qu'il a dans l'imagination. Et que peut avoir dans l'imagination un homme qui passe sa vie avec les prostituées du plus bas étage ? La grâce de ses Bergères est la grâce de la Favart[1] dans Rose et Colas ; celle de ses déesses est empruntée de la Deschamps[2][...]. Il y a trop de mines, trop de petites mines, de manière, d'affèterie pour un art sévère. Il a beau me les montrer nues, je leur vois toujours le rouge, les mouches, les pompons et toutes les fanfioles[3] de la toilette... »
Il n'empêche... Mme Necker apprécie les analyses de Diderot et lui écrit : « Je continue à m'amuser infiniment de la lecture de votre Salon : je n'aime la peinture qu'en poésie ; et c'est ainsi que vous avez su nous traduire tous les ouvrages, même les plus communs, de nos peintres modernes. »
Exemple : « Angélique et Médor » (Salon de 1765)
Contexte : Dans son poème épique Le Roland furieux (1516), L’Arioste raconte les aventures de Roland ou plutôt ses mésaventures : il revient d’Orient avec Angélique mais celle-ci rencontre Médor, un soldat sarrazin qu’elle épouse. Boucher prend cette histoire comme sujet de son tableau Angélique et Médor (1765).
Diderot en fait le compte-rendu dans son Salon de 1765 :
« Il a plu au peintre d’appeler cela Angélique et Médor mais ce sera tout ce qu’il me plaira. Je défie qu’on me montre quoi que ce soit qui caractérise la scène et désigne les personnages[4]. Eh mordieu ! il n’y avait qu’à se laisser mener par le poète. Comme le lieu de son aventure est plus beau, plus grand, plus pittoresque et mieux choisi ! C’est un antre rustique, c’est un lieu retiré, c’est le séjour de l’ombre et du silence. C’est là que, loin de tout importun, on peut rendre un amant heureux, et non pas en plein jour, en pleine campagne, sur un coussin. [...]
Cela n’a pas le sens commun ; petite composition de boudoir. Et puis ni pieds, ni mains, ni vérité, ni couleur, et toujours du persil sur les arbres. [..] Dessin rond, mou et chairs flasques. »
On sait que Diderot n’aime pas Boucher mais cette fois, il n’a pas tort.
[1] La Favart
[2] La Deschamps (1730-1764) était une courtisane célèbre qui tomba dans la misère. Une gazette en 1764 caractérise la Deschamps comme « notre Laïs [courtisane grecque] moderne, si fameuse par ses débauches, par son luxe et par le prix excessif qu'elle mettait à ses faveurs. » (Benabou, La Prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle, Perrin, 1987).
[3] Fanfreluches.
[4] Effectivement, rien dans cette toile ne permet de comprendre la référence littéraire au poème.
La nudité en peinture selon Diderot
À propos d'une toile de Carle van Loo, Diderot écrit en 1763 : « Une figure toute nue n'est point indécente. Placez un linge entre la main de la Vénus de Médicis et la partie de son corps que cette main veut nous dérober, et vous aurez fait d'une Vénus pudique une Vénus lascive. »
Diderot évoque souvent la nudité grecque « naturelle » dans ses Essais sur la peinture dont l'équivalent parisien serait la nudité des baigneurs sur les berges de la Seine, combattue par les autorités. Il écrit à Sophie Volland en juillet 1762 : « Un jour que j'étais au bain parmi un grand nombre de jeunes gens, j'en remarquai un d'une beauté surprenante et je ne pus m'empêcher de m'approcher de lui. »
Dans le Salon de 1761, à propos d'une toile de Hallé, il note : « Nous ne voyons jamais le nu. La religion et le climat s'y opposent. Il n'en est pas de nous ainsi que des Anciens qui avaient des bains, des gymnases, peu d'idées de la pudeur, des dieux et des déesses faits d'après des modèles humains, un climat chaud, un culte libertin. »
Plus tard, dans les Pensées détachées sur la peinture, il écrit : « Je ne suis pas un capucin ; j'avoue cependant que je sacrifierais volontiers le plaisir de voir de belles nudités, si je pouvais hâter le moment où la peinture et la sculpture plus décentes et plus morales songeront à concourir avec les autres beaux-arts à inspirer la vertu et à épurer les mœurs. Il me semble que j'ai assez vu de tétons et de fesses ; ces objets séduisants contrarient l'émotion de l'âme par le trouble qu'ils jettent dans les sens. » Et aussi : « Lorsque le vêtement d'un peuple est mesquin, l'art doit laisser là le costume. Que voulez-vous que fasse un statuaire de vos vestes, de vos culottes et de vos rangées de boutons ? N'est-ce pas encore une belle chose à imiter qu'une perruque de palais ou de faculté ? Il est une Vénus dont ni M. Larcher ni, je crois, l'abbé de La Chaux[1]n'ont parlé, c'est Vénus Mammosa, la Vénus aux grosses mamelles, la seule à qui les écoles flamandes et hollandaises ont sacrifié. Les Grâces compagnes de Vénus Uranie sont vêtues (ci-contre), les Grâces compagnes de Vénus déesse de la volupté[2] sont nues. Vêtement de trois sortes de femmes romaines : la stola blanche pour les femmes distinguées ; la stola noire pour les affranchies ; et la robe bigarrée pour les femmes du commun. Je ne ferai jamais un grand reproche à l'artiste d'ignorer ou de négliger ces distinctions gênantes. »
Diderot et Greuze
À Boucher, Diderot préfère Greuze et son pathétisme moralisateur et surtout Chardin - ce dernier étant par ailleurs le peintre préféré du roi de Prusse, Frédéric II - qui choisit peu d'objets, isole une femme - ou un enfant -, lui accordant toute son attention et l'entourant de silence pour en suggérer la beauté profonde.
Il apprécie également Joseph Vernet, ses marines, la série des ports de France commandée par le roi, ses ciels et ses montagnes. Il décrit dans le salon de 1767 les « sites » de la Promenade Vernet qui sont aujourd'hui pour la plupart perdus ou introuvables. On connaît la relative pauvreté de Diderot. Toutefois, il a acheté une petite toile de Vernet pour décorer son bureau.
À propos de La Cruche cassée
Diderot aime le pathétisme moralisateur de Greuze mais s'agit-il vraiment d'une cruche ?... La jeune fille relève sa jupe, la voilà bien triste... Plutôt qu'une cruche, ne vient-elle pas davantage de perdre sa vertu ?
La question reste non résolue...
Deux versions de L'Oiseau mort
On dispose de deux versions de L'Oiseau mort, celle de 1759 et celle de 1765.
Version de 1759
Dans ses Salons, Diderot commenta la version de 1765 de L’Oiseau mort, mais voici celle de 1759. Qu’en dire, qu’en aurait-il dit ? Supposons qu’il ait pris des notes devant le tableau exposé dans le salon carré du Louvre[1], écrivant fiévreusement à la mine de plomb sur son écritoire portatif...
* très jeune fille pulpeuse au visage bien dessiné, aux joues roses, aux longs cheveux roux. Bouche charmante, moue enfantine prête au baiser. Attitude pleine de lascivité et de volupté. Épaule dénudée soulignée par la lumière, chemise à moitié agrafée, bras potelé. Semble sortir du lit.
* se penche au-dessus d’un oiseau gisant sur une petite table, la tête pendante et les ailes ouvertes.
* sa main se tend vers le petit corps ambigu : oiseau ou jeune fille offerte ?... (jeunes filles de Greuze mêlent toujours des airs d’innocence et d’érotisme[2] )
* la main n‘ose pas toucher la chair de l’oiseau encore frémissant (de quelles voluptés ?)
* autre chose donc que le chagrin dû à la perte d’un oiseau (mais de sa virginité ?)
Version de 1765
Voici un extrait de son commentaire de 1765 qui justifie peut-être nos remarques ci-dessus, un peu osées :
« Mais, petite, votre douleur est bien profonde, bien réfléchie ! Que signifie cet air rêveur et mélancolique ? Quoi ! Pour un oiseau ! Vous ne pleurez pas. Vous êtes affligée, et la pensée accompagne votre affliction. Çà, petite, ouvrez-moi votre cœur : parlez-moi vrai ; est-ce bien la mort de cet oiseau qui vous retire si fortement et si tristement en vous-même ?... Vous baissez les yeux ; vous ne me répondez pas. Vos pleurs sont prêts à couler. Je ne suis pas père ; je ne suis ni indiscret, ni sévère...
Eh bien ! je le conçois ; il vous aimait, il vous le jurait, et le jurait depuis longtemps. Il souffrait tant : le moyen de voir souffrir ce qu’on aime ?... Et laissez-moi continuer ; pourquoi me fermer la bouche de votre main ? Ce matin-là, par malheur votre mère était absente. Il vint ; vous étiez seule : il était si beau, si passionné, si tendre, si charmant ! il avait tant d’amour dans les yeux ! tant de vérité dans les expressions ! il disait de ces mots qui vont si droit à l’âme, et en les disant il était à vos genoux : cela se conçoit encore. Il tenait une de vos mains ; de temps en temps vous y sentiez la chaleur de quelques larmes qui tombaient de ses yeux et qui coulaient le long de vos bras. Votre mère ne revenait toujours point. Ce n’est pas votre faute ; c’est la faute de votre mère... Mais voilà-t-il pas que vous pleurez... Mais ce que je vous en dis n’est pas pour vous faire pleurer. Et pourquoi pleurer ? Il vous a promis ; il ne manquera à rien de ce qu’il vous a promis. Quand on a été assez heureux pour rencontrer un enfant charmant comme vous, pour s’y attacher, pour lui plaire ; c’est pour toute la vie... – Et mon oiseau ?... – Vous souriez. (Ah ! mon ami, qu’elle était belle ! ah ! si vous l’aviez vue sourire et pleurer !) Je continuai. « Eh bien ! votre oiseau ! Quand on s’oublie soi-même, se souvient-on de son oiseau ? Lorsque l’heure du retour de votre mère approcha, celui que vous aimez s’en alla. Qu’il était heureux, content, transporté ! qu’il eut de peine à s’arracher d’auprès de vous !... Comme vous me regardez ! Je sais tout cela. Combien il se leva et se rassit de fois ! combien il vous dit, redit adieu sans s’en aller ! combien de fois il sortit et rentra ! Je viens de le voir chez son père : il est d’une gaieté charmante, d’une gaieté qu’ils partagent tous, sans pouvoir s’en défendre... – Et ma mère ?... – Votre mère ? à peine fut-il parti, qu’elle rentra : elle vous trouva rêveuse, comme vous l’étiez tout à l’heure. On l’est toujours comme cela. Votre mère vous parlait, et vous n’entendiez pas ce qu’elle vous disait ; elle vous commandait une chose, et vous en faisiez une autre. Quelques pleurs se présentaient au bord de vos paupières ; ou vous les reteniez, ou vous détourniez la tête pour les essuyer furtivement. Vos distractions continues impatientèrent votre mère ; elle vous gronda, et ce vous fut une occasion de pleurer sans contrainte et de soulager votre cœur... Continuerai-je ? Je crains que ce que je vais dire ne renouvelle votre peine. Vous le voulez ?... Eh bien ! votre bonne mère se reprocha de vous avoir contristée ; elle s’approcha de vous, elle vous prit les mains, elle vous baisa le front et les joues, et vous en pleurâtes bien davantage. Votre tête se pencha sur elle, et votre visage, que la rougeur commençait à colorer, tenez, tout comme le voilà qui se colore, alla se cacher dans son sein. Combien cette mère vous dit de choses douces ! et combien ces choses douces vous faisaient de mal ! Cependant votre serin avait beau chanter, vous avertir, vous appeler, battre des ailes, se plaindre de votre oubli ; vous ne le voyiez point, vous ne l’entendiez point : vous étiez à d’autres pensées. Son eau ni la graine, ne furent point renouvelées ; et ce matin, l’oiseau n’était plus... Vous me regardez encore ; est-ce qu’il me reste encore quelque chose à dire ? Ah ! j’entends ; cet oiseau, c’est lui qui vous l’avait donné : eh bien ! il en retrouvera un autre aussi beau... Ce n’est pas tout encore : vos yeux se fixent sur moi, et s’affligent ; qu’y a-t-il donc encore ? Parlez ; je ne saurais vous deviner... – Et si la mort de cet oiseau n’était que le présage ! Que ferais-je ? que deviendrais-je ? S’il était ingrat... – Quelle folie ! Ne craignez rien : cela ne sera pas, cela ne se peut... » Mais, mon ami, ne riez-vous pas, vous, d’entendre un grave personnage s’amuser à consoler un enfant en peinture de la perte de son oiseau, de la perte de tout ce qu’il vous plaira ? Mais aussi voyez donc qu’elle est belle ! Qu’elle est intéressante ! Je n’aime point à affliger ; malgré cela il ne me déplairait pas trop d’être la cause de sa peine.
Le sujet de ce petit poème est si fin, que beaucoup de personnes ne l’ont pas entendu ; ils ont cru que cette jeune fille ne pleurait que son serin. Greuze a déjà peint une fois le même sujet ; il a placé devant une glace fêlée une grande fille en satin blanc, pénétrée d’une profonde mélancolie. Ne pensez-vous pas qu’il y aurait autant de bêtise à attribuer les pleurs de la jeune fille de ce Salon à la perte d’un oiseau, que la mélancolie de la jeune fille du Salon précédent à son miroir cassé ? Cet enfant pleure autre chose, vous dis-je... »
Dans le Salon de 1765, Diderot admire deux esquisses de Greuze, Le Fils ingrat et Le Mauvais fils puni. Son esthétique se caractérise ici par le goût du pathétique moralisateur et l’émotion facile. Son imagination se donne libre cours et l’ensemble paraît surinvesti de sens.
Que dit-il des personnages féminins qui animent les tableaux ?
« ... Le bon vieillard [...] fait effort pour se lever ; mais une de ses filles, à genoux devant lui, le retient par les basques de son habit. Le jeune libertin est entouré de l’aînée de ses sœurs, de sa mère et d’un de ses petits frères. Sa mère le tient embrassé par le corps ; le brutal cherche à s’en débarrasser et la repose du pied. Cette mère a l’air accablé désolé ; la sœur aînée s’est interposée entre son frère et son père ; la mère et la sœur semblent, par leur attitude, chercher à les cacher l’un à l’autre. Celle-ci a saisi son frère par son habit, et lui dit, par la manière dont elle le tire : « Malheureux, que fais-tu ? Tu repousses ta mère, tu menaces ton père ; mets-toi à genoux et demande pardon... »
« ... La fille aînée, assis dans le vieux confessionnal[3] de cuir, a le corps renversé en arrière, dans l’attitude du désespoir, une main portée à sa tempe, et l’autre élevée et tenant encore le crucifix qu’elle a fait baiser à son père. [...] La cadette, placée entre la fenêtre et le lit, ne saurait se persuader qu’elle n’a plus de père : elle est penchée vers lui ; elle semble chercher ses derniers regards ; elle soulève un de ses bras, et sa bouche entrouverte crie : « Mon père, mon père ! est-ce que vous n’entendez plus ? » La pauvre mère est debout, vers la porte, le dos contre le mur, désolée, et ses genoux se dérobant sous elle. [...] Il [le fils ingrat] a perdu la jambe dont il a repoussé sa mère[4] [...] Il entre. C’est sa mère qui le reçoit. Elle se tait ; mais les bras tendus vers le cadavre lui disent : « Tiens, vois, regarde ; voilà l’état où tu l‘as mis. » [...] A ce livre placé sur une table, devant cette fille aînée, je devine qu’elle a été chargée, la pauvre malheureuse ! de la fonction douloureuse de réciter les prières des agonisants. [...]
Je ne crois pas que la mère ait l’action vraie du moment ; il me semble que pour se dérober à elle-même la vue de son fils et celle du cadavre de son époux, elle a dû [aurait dû] porter une de ses mains sur ses yeux, et de l’autre montrer à l’enfant ingrat le cadavre de son père. On n’en aurait pas moins aperçu sur le reste de son visage toute la violence de sa douleur ; et la figure en eût été plus simple et plus pathétique encore... [...]
Avec tout cela, le goût [du public] est si misérable, si petit, que peut-être ces deux esquisses ne seront jamais peintes ; et que, si elles ont peintes, Boucher aura plus tôt vendu cinquante de ses indécentes et plates marionnettes que Greuze ces deux sublimes tableaux. »
Remarque : les tableaux définitifs diffèrent de ces esquisses.
L'Accordée de village
« ... Le peintre a donné à la fiancée une figure charmante, décente et réservée. Elle est vêtue à merveille. Ce tablier de toile blanc fait on ne peut mieux. Il y a un peu de luxe dans sa garniture ; mais c'est un jour de fiançailles. Il faut voir comme les plis de tous les vêtements de cette figure et des autres sont vrais ! Cette fille charmante n'est point droite, mais il y a une légère et molle inflexion dans toute sa figure et dans tous ses membres, qui la remplit de grâce et de vérité. Elle est jolie vraiment, et très jolie. Une gorge faite au tour qu'on ne voit point du tout. Mais je gage qu'il n'y a rien là qui la relève, et que cela se soutient tout seul. Plus à son fiancé, et elle n'eût pas été assez décente, plus à sa mère ou à son père, et elle eût été fausse. Elle a le bras à demi passé sous celui de son futur époux, et le bout de ses doigts tombe et appuie doucement sur sa main ; c'est la seule marque de tendresse qu'elle lui donne, et peut-être sans le savoir elle-même. C'est une idée délicate du peintre... »
En guise de conclusion
À l’article « Encyclopédie » de l’Encyclopédie, Diderot évoque l’histoire d’un homme désireux de posséder le portrait de sa maîtresse. Il charge cent peintres d’en faire le tableau à partir de la description écrite qu’il leur avait donnée. Cet homme reçut « cent portraits, qui tous ressemblent à sa description, et dont aucun ne ressemble à un autre, ni à sa maîtresse. »
« Tel est l’obstacle, l'enjeu et la magnificence de toute peinture », écrit Michel Delon.
Opinion de Heine sur la peinture française
Voici un jugement un peu sévère d’Heinrich Heine concernant la peinture en France au 18e siècle :
« Elle [la peinture] produit un effet déplaisant aves son badinage glacial et ses petits spectacles fanés dans l'enclos d'un boudoir où une jolie créature pomponnée allongée sur un sofa s'évente avec un air frivole. Favart, avec ses Eglés et Zulmés, est plus vrai que Watteau et Boucher avec leurs bergères coquettes et leurs abbés idylliques… Les peintres ont été les hommes de cette époque qui prirent le moins de part à ce qui se préparait en France. L'éclatement de la Révolution les a surpris en déshabillé. »
(Heinrich Heine, De la France)
* * *
Date de dernière mise à jour : 23/10/2019