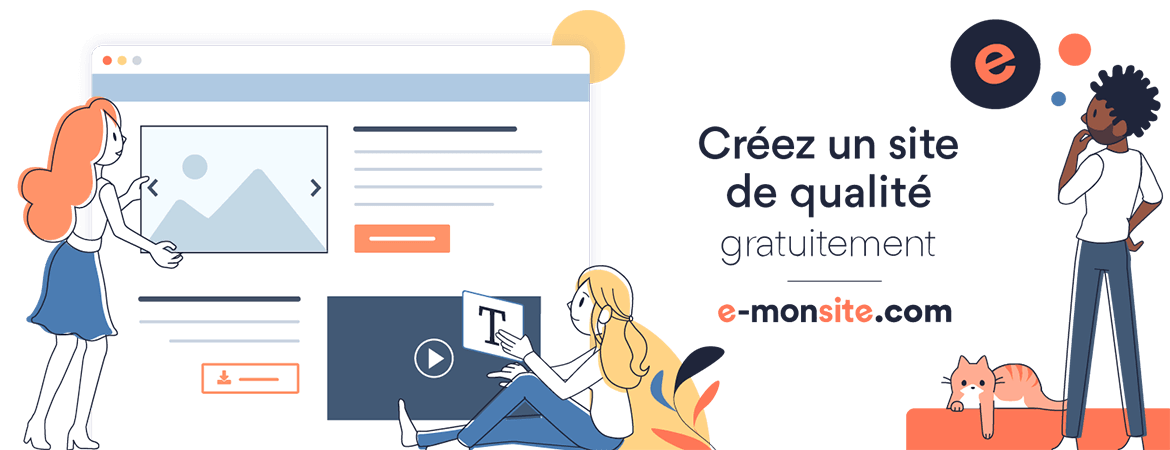La Vie de Marianne
La Vie de Marianne ou du roman précieux au roman de mœurs
 Résumé
Résumé
Un carrosse est attaqué. Une orpheline de deux ans échappe au massacre, est recueillie par des protecteurs bienveillants qui meurent alors qu’elle est encore adolescence. Elle devient apprentie lingère à Paris et reçoit d’un vieux dévot des visites trop pressantes (2). Elle s’enfuit et fait la rencontre providentielle d’un noble et beau jeune home, Valville. Certes, la mère de Valville éprouve pour elle une bienveillance attendrie mas la famille, craignant une mésalliance, enlève Marianne. Délivrée, elle doit affronter l’infidélité du jeune homme. Ici s’arrête l’histoire que nous conte, bien des années après, Marianne devenue comtesse.
Du roman précieux au roman de mœurs
On discerne la persistance de la tradition précieuse du siècle précédent : il plane un mystère romanesque sur la naissance de Marianne ; elle connaît de nombreuses aventures et des fortunes diverses ; le récit se perd parfois dans d’innombrables méandres et subtilités psychologiques qu’affectionne Marivaux ; sur l’intrigue principale se greffent des épisodes secondaires ; soudain, un rebondissement inattendu réveille l’intérêt du lecteur. L’univers où évoluent les héros est conventionnel : il s’agit de la France du temps où les mœurs sont prises sur le vif. L’auteur dessine des scènes de la vie parisienne pittoresque et variées, parfois même franchement réalistes.
Thèmes majeurs
* Les dangers du monde : la société est rude, l’aristocratie inconséquente (Valville), méprisante, libertine et corrompue. Quant au clergé, il est constitué d’abbés mondains, recruteurs sans scrupules, faisant preuve de la « vanité du prêcheur ». Face à la roublardise et à la confusion des uns et des autres, Marianne ne s’indigne pas mais reste lucide. Exposée aux tentations de la capitale, Marianne en apprécie les séductions mais reste vertueuses et sensible quoique la vie mondaine l’attire invinciblement. Elle se distingue par sa fierté et son énergie et Mme Dorsin – autre femme remarquable -, se montre fort spirituelle et anticonformiste : il semble que Marivaux ait dépeint Mme de Tencin sous ses traits : « Il n’était point question de rangs ni d’états chez elle ; personne ne s’y souvenait du plus ou du moins d’importance qu’il avait ; c’étaient les hommes qui parlaient à des hommes, entre qui seulement les meilleures raisons l’emportaient sur les plus faibles ; rien que cela. […] C’étaient comme des intelligences entre lesquelles il ne s’agissait plus de titres que le hasard leur avait donnés ici-bas, et qui ne croyaient pas que leurs fonctions fortuites dussent plus humilier les uns qu’enorgueillir les autres. Voilà comme on l’entendait chez Madame Dorsin ; voilà ce qu’on devenait avec elle, par l‘impression qu’on recevait de cette façon de penser raisonnable et philosophe que je vous ai dit qu’elle avait, et qui faisait que tout le monde était philosophe aussi. »
* Les mouvements du cœur : on trouve ici la naissance, l’aveu et le triomphe de l’amour. Marivaux analyse avant tout les « mouvements » qui précèdent, installent ou infléchissent le sentiment amoureux. Il semble moins intéressé par l’amour passionné ou tendre : en cela, on peut rapprocher le roman de ses pièces dramatiques. Le roman restant inachevé, peut-on y voir la preuve que l’amour ne conduit nulle part ? Une autre interprétation est possible : ce ne sont pas les péripéties qui intéressent l’auteur mais l’analyse psychologique, l’intrigue n’étant que son prétexte.
Écriture
- autobiographie imaginaire, féminine et imaginée par un homme. Le récit est écrit par Marianne comme un passe-temps, dans une retraite proche du vide parfait. La narratrice vieillie porte sur la jeune fille un regard ironique, détaché ou complice.
- style simple et naturel, vif et enjoué, parfois minutieux lorsqu’il s’agit de décrire les méandres du sentiment amoureux.
- les dialogues sont importants : ils servent de transition entre le récit et le commentaire. On retrouve ici l’art du dramaturge.
- Marivaux manie l’art du « glissement » : le récit glisse vers le commentaire d’expérience personnelle, puis vers l’analyse générale, grâce à l’organisation temporelle (passé simple du récit, passé composé nostalgique, imparfait du passé incertain, présent du commentaire) et au jeu des pronoms : le « je » de la narration et du personnage que Marianne a été devient parfois celui de l’auteur ou se trouve remplacé par un « on » ou même un « vous » ambigu.
_ _ _
Notes
(1) La Vie de Marianne était au programme de l'agrégation de Lettres 2015.
(2) Dans La Vie de Marianne, Monsieur de Climal, silhouette qui passe, évoque le Tartuffe de Molière mais en plus élégant : c’est un gentilhomme qui parle très bien en utilisant cette langue nuancée et souple de la piété feinte et de la corruption.
Au Bac 2008
L’extrait suivant de La Vie de Marianne fut soumis en 2008 à l’E.A.F. (série L) dans le cadre de l’objet d’étude « Le roman et ses personnages ; visions de l’homme et du monde ».
[Nous sommes au début du roman.]
« Avant que de donner cette histoire au public, il faut lui apprendre comment je l'ai trouvée.
Il y a six mois que j'achetai une maison de campagne à quelques lieues de Rennes, qui, depuis trente ans, a passé successivement entre les mains de cinq ou six personnes. J'ai voulu faire changer quelque chose à la disposition du premier appartement, et dans une armoire pratiquée dans l'enfoncement d'un mur, on y a trouvé un manuscrit en plusieurs cahiers contenant l'histoire qu'on va lire, et le tout d'une écriture de femme. On me l'apporta ; je le lus avec deux de mes amis qui étaient chez moi, et qui depuis ce jour-là n'ont cessé de me dire qu'il fallait le faire imprimer : je le veux bien, d'autant plus que cette histoire n’intéresse [1] personne. Nous voyons par la date que nous avons trouvée à la fin du manuscrit, qu'il y a quarante ans qu'il est écrit ; nous avons changé le nom de deux personnes dont il y est parlé, et qui sont mortes. Ce qui y est dit d'elles est pourtant très indifférent ; mais n'importe : il est toujours mieux de supprimer leurs noms.
Voilà tout ce que j'avais à dire : ce petit préambule m'a paru nécessaire, et je l'ai fait du mieux que j'ai pu, car je ne suis point auteur, et jamais on n'imprimera de moi que cette vingtaine de lignes-ci.
Passons maintenant à l'histoire. C'est une femme qui raconte sa vie ; nous ne savons qui elle était. C'est la Vie de Marianne ; c'est ainsi qu'elle se nomme elle-même au commencement de son histoire ; elle prend ensuite le titre de comtesse ; elle parle à une de ses amies dont le nom est en blanc, et puis c'est tout.
Quand je [2] vous ai fait le récit de quelques accidents de ma vie, je ne m'attendais pas, ma chère amie, que vous me prieriez de vous la donner toute entière, et d'en faire un livre à imprimer. Il est vrai que l'histoire en est particulière, mais je la gâterai, si je l'écris ; car où voulez-vous que je prenne un style ?
II est vrai que dans le monde on m'a trouvé de l'esprit ; mais, ma chère, je crois que cet esprit-là n'est bon qu'à être dit, et qu'il ne vaudra rien à être lu.
Nous autres jolies femmes, car j'ai été de ce nombre, personne n'a plus d'esprit que nous, quand nous en avons un peu : les hommes ne savent plus alors la valeur de ce que nous disons ; en nous écoutant parler, ils nous regardent, et ce que nous disons profite de ce qu'ils voient.
J'ai vu une jolie femme dont la conversation passait pour un enchantement, personne au monde ne s'exprimait comme elle ; c'était la vivacité, c'était la finesse même qui parlait : les connaisseurs n'y pouvaient tenir de plaisir. La petite vérole lui vint, elle en resta extrêmement marquée : quand la pauvre femme reparut, ce n'était plus qu'une babillarde incommode. Voyez combien auparavant elle avait emprunté d'esprit de son visage ! Il se pourrait bien faire que le mien m'en eût prêté aussi dans le temps qu'on m'en trouvait beaucoup. Je me souviens de mes yeux de ce temps-là, et je crois qu'ils avaient plus d'esprit que moi.
Combien de fois me suis-je surprise à dire des choses qui auraient eu bien de la peine à passer toutes seules ! Sans le jeu d'une physionomie friponne qui les accompagnait, on ne m'aurait pas applaudie comme on faisait, et si une petite vérole était venue réduire cela à ce que cela valait, franchement, je pense que j'y aurais perdu beaucoup.
Il n'y a pas plus d'un mois, par exemple, que vous me parliez encore d'un certain jour (et il y a douze ans que ce jour est passé) où, dans un repas, on se récria tant sur ma vivacité ; eh bien ! en conscience, je n'étais qu'une étourdie. Croiriez-vous que je l'ai été souvent exprès, pour voir jusqu'où va la duperie des hommes avec nous ? Tout me réussissait, et je vous assure que dans la bouche d'une laide, mes folies auraient paru dignes des Petites-Maisons [3] : et peut-être que j'avais besoin d'être aimable dans tout ce que je disais de mieux. Car à cette heure que mes agréments sont passés, je vois qu'on me trouve un esprit assez ordinaire, et cependant je suis plus contente de moi que je ne l'ai jamais été. Mais enfin, puisque vous voulez que j'écrive mon histoire, et que c'est une chose que vous demandez à mon amitié, soyez satisfaite : j'aime encore mieux vous ennuyer que de vous refuser.
Au reste, je parlais tout à l'heure de style, je ne sais pas seulement ce que c'est. Comment fait-on pour en avoir un ? Celui que je vois dans les livres, est-ce le bon ? Pourquoi donc est-ce qu'il me déplaît tant le plus souvent ? Celui de mes lettres vous paraît-il passable ?
J'écrirai ceci de même.
N'oubliez pas que vous m'avez promis de ne jamais dire qui je suis ; je ne veux être connue que de vous.
Il y a quinze ans que je ne savais pas encore si le sang d'où je sortais était noble ou non, si j'étais bâtarde ou légitime. Ce début paraît annoncer un roman : ce n'en est pourtant pas un que je raconte ; je dis la vérité comme je l'ai apprise de ceux qui m'ont élevée. »
_ _ _
Notes
[1] Ne met en jeu aucune personne vivante.
[2] Ici commence le récit de Marianne.
[3] Hôpital parisien, lieu d'internement pour malades mentaux.
Enfance de Marianne : court extrait à expliquer
[Née de parents inconnus et adoptée par le curé du village, la jeune narratrice Marianne fait l’objet de toutes les rumeurs.]
« ... Le curé, qui, quoique curé de village, avait beaucoup d’esprit, et était un homme de très bonne famille, disait souvent que, dans tout ce que ces dames avaient alors fait pour moi, il ne leur avait jamais entendu prononcer le mot de charité ; c’est que c’était un mot trop dur, et qui blessait la mignardise des sentiments qu’elles avaient.
Aussi, quand elles parlaient de moi, elles ne disaient point cette petite fille ; c’était toujours cette aimable enfant.
Était-il question de mes parents, c’était des étrangers, et sans difficulté de la première condition de leur pays ; il n’était pas possible que cela fût autrement ; on le savait comme si on l’avait vu : il courait là-dessus un petit raisonnement que chacune d’elles avait grossi de sa pensée et qu’ensuite elles croyaient comme si elles ne l’avaient pas fait elles-mêmes... »
Pistes de lecture
* s’assurer de bien comprendre le sens des mots vieillis ou inusités de nos jours tels que esprit, mignardise, de la première condition.
* Analyser les différentes formes de discours rapporté et s’interroger sur ce qu’apporte cette variété au texte.
* A partir des rumeurs colportées, on peut dresser un portrait de ces dames. Lequel ? Replacer dans le contexte historique (province, 18e siècle, condition sociale).
* Problématique possible : construction des personnages à travers leurs paroles.
Un autre passage important
Voilà Marianne placée chez une lingère à Paris. Avec ses goûts raffinés – qui laissent penser à une naissance noble -, Marianne n’est guère faite pour le négoce. Marivaux analyse avec subtilité ses impressions pénibles dans un milieu qui n’est pas le sien, où tout la blesse, et le secret instinct qui l’oriente vers la haute société. Le contraste est frappant entre le raffinement de Marianne et la bonhomie cordiale mais un peu vulgaire de la lingère.
« Cette marchande, il faut que je vous la nomme pour la facilité de l'histoire. Elle s'appelait Mme Dutour ; c'était une veuve qui, je pense, n'avait pas plus de trente ans ; une grosse réjouie qui, à vue d'œil, paraissait la meilleure femme du monde ; aussi l'était-elle. Son domestique était composé d'un petit garçon de six ou sept ans qui était son fils, d'une servante, et d'une nommée Mlle Toinon, sa fille de boutique.
Quand je serais tombée des nues, je n'aurais pas été plus étourdie que je l'étais ; les personnes qui ont du sentiment sont bien plus abattues que d'autres dans de certaines occasions, parce que tout ce qui leur arrive les pénètre ; il y a une tristesse stupide qui les prend, et qui me prit : Mme Dutour fit de son mieux pour me tirer de cet état-là.
Allons, mademoiselle Marianne, me disait-elle (car elle avait demandé mon nom), vous êtes avec de bonnes gens, ne vous chagrinez point, j'aime qu'on soit gaie ; qu'avez-vous qui vous fâche ? Est-ce que vous vous déplaisez ici ? Moi, dès que je vous ai vue, j'ai pris de l'amitié pour vous ; tenez, voilà Toinon qui est une bonne enfant, faites connaissance ensemble. Et c'était en soupant qu'elle me tenait ce discours, à quoi je ne répondais que par une inclination de tête et avec une physionomie dont la douceur remerciait sans que je parlasse. Quelquefois, je m'encourageais jusqu'à dire : Vous avez bien de la bonté ; mais, en vérité, j'étais déplacée, et je n'étais pas faite pour être là. Je sentais, dans la franchise de cette femme-là, quelque chose de grossier qui me rebutait.
Je n'avais pourtant encore vécu qu'avec mon curé et sa sœur[1], et ce n'était pas des gens du monde, il s'en fallait bien ; mais je ne leur avais vu que des manières simples et non pas grossières : leurs discours étaient unis et sensés ; d'honnêtes gens vivants médiocrement pouvaient parler comme ils parlaient, et je n'aurais rien imaginé de mieux, si je n'avais jamais vu autre chose : au lieu qu'avec ces gens-ci, je n'étais pas contente, je leur trouvais un jargon, un ton brusque qui blessait ma délicatesse. Je me disais déjà que dans le monde, il fallait qu'il y eût quelque chose qui valait mieux que cela ; je soupirais après, j'étais triste d'être privée de ce mieux que je ne connaissais pas. Dites-moi d'où cela venait ? Où est-ce que j'avais pris mes délicatesses ? Étaient-elles dans mon sang ? cela se pourrait bien ; venaient-elles du séjour que j'avais fait à Paris ? cela se pourrait encore : il y a des âmes perçantes à qui il n'en faut pas beaucoup montrer pour les instruire, et qui, sur le peu qu'elles voient, soupçonnent tout d'un coup tout ce qu'elles pourraient voir.
La mienne avait le sentiment bien subtil, je vous assure, surtout dans les choses de sa vocation, comme était le monde. Je ne connaissais personne à Paris, je n'en avais vu que les rues, mais dans ces rues il y avait des personnes de toutes espèces, il y avait des carrosses, et dans ces carrosses un monde qui m'était très nouveau, mais point étranger. Et sans doute, il y avait en moi un goût naturel qui n'attendait que ces objets-là pour s'y prendre, de sorte que, quand je les voyais, c'était comme si j'avais rencontré ce que je cherchais.
Vous jugez bien qu'avec ces dispositions, Mme Dutour ne me convenait point, non plus que Mlle Toinon, qui était une grande fille qui se redressait toujours, et qui maniait sa toile avec tout le jugement et toute la décence [2] possible ; elle y était toute entière, et son esprit ne passait pas son aune.
Pour moi, j'étais si gauche à ce métier-là, que je l'impatientais à tout moment. Il fallait voir de quel air elle me reprenait, avec quelle fierté de savoir elle corrigeait ma maladresse : et ce qui est plaisant, c'est que l'effet ordinaire de ces corrections, c'était de me rendre encore plus maladroite, parce que j'en devenais plus dégoûtée. »
_ _ _
Notes
[1] Qui l’avaient recueillie.
[2] Dans le sens de compétence.
Une âme généreuse
Dans la quatrième partie de l’ouvrage, Marianne estime que son devoir est de dissuader Valville (fils de Mme de Miran – ici présente -, promis à un riche mariage mais tombé amoureux d’elle) de l’épouser. Cette scène est caractéristique de la sensibilité du 18e siècle, c’est-à-dire la réflexion constante et lucide sur l’émotion éprouvée. Sentiment et raison se partagent le texte qui relève du registre argumentatif auquel se mêle une bonne dose de pathétique. Les larmes abondent : le siècle les aime... Ajoutons que la décision de Marianne suppose une certaine hiérarchie des valeurs entre les droits et les devoirs de l’individu. La jeune fille (comme celles de son temps) n’a pas droit au bonheur.
Marianne a commencé par rappeler la modestie de sa condition. Puis :
« Comment pouvez-vous espérer que je consente à un amour qui vous attirerait le blâme de tout le monde, qui vous brouillerait avec toute une famille, avec tous vos amis, avec tous les gens qui vous estiment, et avec moi aussi ? Car quel repentir n’auriez-vous pas, quand vous ne m’aimeriez plus, et que vous vous trouveriez le mari d’une femme qui serait moquée, que personne ne voudrait voir, et qui ne vous aurait apporté que du malheur et de la honte ? Encore n’est-ce rien que tout ce que je dis là, ajoutai-je avec un attendrissement qui me fit pleurer À présent que je suis si obligée à Mme de Miran, quelle méchante créature ne serais-je pas si je vous épousais ? Pourriez-vous sentir autre chose pour moi que de l’horreur, si j’en étais capable ? Y aurait-il rien de si abominable que moi sur la terre, surtout dans l’occurrence où je sais que vous êtes. Car je suis informée de tout : ma mère me vint voir hier à son ordinaire, elle était triste. Je lui demandai ce qu’elle avait, elle me dit que son fils la chagrinait ; je l’écoutais sans m’attendre que je serais mêlées là-dedans. Elle me dit aussi qu’elle avait toujours été fort contente de ce fils, mais qu’elle ne le reconnaissait plus depuis qu’il avait vu une certaine jeune fille ; là-dessus, elle me conta notre histoire, et cette jeune fille qui vous dérange, qui fait que vous manquez à votre parole, qui afflige aujourd’hui ma mère, qui lui a ôté le bon cœur et la tendresse de son fils, il se trouve que c’est moi, Monsieur, que c’est cette pensionnaire qu’elle fait vivre et qu’elle accable de bienfaits.
Après cela, Monsieur, voyez, avec l’honneur, avec la probité, avec le cœur estimable tendre et généreux que vous avez coutume d’avoir, voyez si vous souhaitez encore que je vous aime, et si vous-même vous auriez le courage d’aimer un monstre comme j’en serais un, si j’écoutais votre amour. Non, Monsieur, vous êtes touché de ce que je vous apprends ; vous pleurez, mais ce n’est plus que de tendresse pour ma mère, et que de pitié pour moi. Non, ma mère, vous ne serez plus ni triste ni inquiète ; M. de Valville ne voudra pas que je sois davantage le sujet de votre chagrin : c’est une douleur qu’il ne fera pas à moi-même. Je suis bien sûre qu’il ne troublera plus le plaisir que vous avez à me secourir ; il y sera sensible, au contraire, il voudra y avoir part, il m’aimera encore, mais comme vous l‘aimez. Il épousera la demoiselle en question ; il l’épousera à cause de lui-même qui le doit, à cause de vous qui lui avez procuré ce parti pour son bien, et à cause de moi qui l’en conjure comme de la seule marque qu’il peut me donner que je lui ai été véritablement chère. C’est une consolation qu’il ne refusera pas à une fille qui ne saurait être à lui, mais qui ne sera jamais à personne, et qui de son côté ne refuse pas de lui dire que si elle avait été riche et son égale, elle avait si bonne opinion de lui qu’elle l’aurait préférée à tous les hommes du monde ; c’est une consolation que je veux bien lui donner à mon tour, et je n’y ai pas de regret, pourvu qu’il vous contente.
Je m’arrêtai alors et me mis à essuyer les pleurs que je versais. Valville, toujours sa tête baissée, et plongé dans une profonde rêverie, fut quelque temps sans répondre. Mme de Miran le regardait et attendait, la larme à l’œil, qu’il parlât. Enfin, il rompit le silence et, s’adressant à ma bienfaitrice :
Ma mère, lui dit-il, vous voyez ce que c’est que Marianne ; mettez-vous à ma place ; jugez de mon cœur par le vôtre. Ai-je eu tort de l’aimer ? me sera-t-il possible de ne l’aimer plus ? Ce qu’elle vient de me dire est-il propre à me détacher d’elle ? Que de vertus, ma mère, et il faut que je la quitte ! Vous le voulez, elle m’en prie, et je la quitterai : j’en épouserai une autre, je serai malheureux, j’y consens, mais je ne le serai pas longtemps.
Ses pleurs coulèrent après ce peu de mots ; il ne les retint plus ; ils attendrirent Mme de Miran, qui pleura comme lui et qui ne sut que dire ; nous nous taisions tous trois, on n’entendait que des soupirs.
Eh ! Seigneur, m’écriai-je avec amour, avec douleur, avec mille mouvements confus que je ne saurais expliquer, eh ! mon Dieu, Madame, pourquoi m’avez-vous rencontrée ? Je suis au désespoir d’être au monde, et je prie le ciel de m’en retirer. Hélas, me dit tristement Valville, de quoi vous plaignez-vous ? Ne vous ai-je pas dit que je vous quitte ?
Oui, vous me quittez, lui répondis-je, mais en me le disant, vous désolez ma mère, vous la faites mourir, vous la menacez d’être malheureux, et vous voulez qu’elle se console, vous demandez de quoi nous avons à nous plaindre ! Eh ! qu’exigez-vous de plus que ce que je vous ai dit ? Quand on est généreux, qu’on est raisonnable, n’y a-t-il pas des choses auxquelles il faut se rendre ? Eh bien ! vous ne m’épouserez pas ; mais c’est Dieu qui ne l’a pas permis ; mais je n’épouserai personne, et vous me serez toujours cher, Monsieur. Vous ne me perdrez point, je ne vous perds pas non plus : je serai religieuse ; mais ce sera à Paris, et nous nous verrons quelquefois, nous aurons tous deux la même mère, vous serez mon frère, mon bienfaiteur, le seul ami que j’aurai sur la terre, le seul homme que j’y aurai estimé, et que je n’oublierai jamais. »
[Mme de Miran, bouleversée, consentirait bien au mariage mais elle se heurte à l'hostilité de toute sa famille. Nous ignorerons toujours si, dans la pensée de Marivaux, si le mariage doit avoir lieu car il a laissé le roman inachevé. Mme Riccoboni écrira la suite : voir infra].
Critiques de La Vie de Marianne (Marivaux)
La Vie de Marianne, dont la publication se prolonge sur des années (cf. supra), ne fait pas l’unanimité. « Nous avons jusqu’ici environ un mois de la vie de Marianne ; si elle a vécu longtemps et si les circonstances de sa vie sont toujours exposées avec la même prolixité, il sera peut-être difficile que la vie d’un homme puisse suffire à lire la sienne », note l’abbé Desfontaines [1].
Marianne prend son temps : « Je suis insupportable avec mes réflexions ». Voire ! Ce qui l’intéresse, c’est moins le plaisir de révéler ou revivre son histoire que celui de la commenter ou de moraliser. Desfontaines, toujours lui, écrit : « Marianne a bien de l’esprit, mais elle a du babil et du jargon ; elle conte bien, mais elle moralise trop. […] Elles s‘interrompt fréquemment pour se jeter sans nécessité dans des raisonnements abstraits. »
Marivaux s’insurge dans les colonnes de sa gazette, Pour ou Contre : « Ceux qui savent que le cœur a son analyse comme l’esprit, et que les sentiments sont aussi capables de variété et de diversité que les pensées, ne seront pas surpris qu’un écrivain, qui s’attache à développer aussi exactement les facultés du cœur que Descartes, Malebranche, celles de l’esprit, conduise quelquefois le lecteur par des voies qui lui semblent nouvelles, et qu’il emploie pour s’exprimer des termes et des figures aussi extraordinaires que ses découvertes. »
Dans Le Cabinet du philosophe (Sixième feuille, « Du style », 1734) Marivaux (auquel on reproche le style trop précieux et maniéré, confondant ainsi l’auteur et le langage de Marianne écrit :
« Il semble que dans ce monde il ne soit question que de mots, point de pensées. Cependant ce n’est point dans les mots qu’un auteur qui sait bien sa langue à tort ou raison. [...] L’homme qui pense beaucoup approfondit les sujets qu’il traite : il les pénètre, il y remarque des choses d’une extrême finesse, que tout le monde sentira quand il les aura dites ; mais qui, en tout temps, n’ont été remarquées que de très peu de de gens ; et il ne pourra assurément les exprimer que par un assemblage d’idées et de mots très rarement vus ensemble [...] Si Montaigne avait vécu de nos jours , que de critiques n’eût-on pas fait de son style ! Car il ne parlait ni français, ni allemand ni breton, ni suisse. Il pensait, il s’exprimait au gré d’une âme singulière et fine. Montaigne est mort, on lui rend justice ; c’est cette singularité d’esprit, et conséquemment de style, qui fait aujourd’hui son mérite [...] Qu’on me montre un auteur célèbre qui ait approfondi l’âme, et qui dans les peintures qu’il fait de nous et de nos passions, n’ait pas le style un peu singulier ? »
Ceci dit, Marianne avoue elle-même que « son esprit ne laisse rien passer à son cœur. » Ses sentiments ne sont jamais simples : « C’était un mélange de trouble, de plaisir, de peur. […] Un mélange de plaisir et de confusion, voilà mon état. »
_ _ _
Notes
[1] Après la lecture de la sixième partie. Il y en a onze, et Mme Riccoboni écrira la douzième et dernière (cf. supra)
* * *
Date de dernière mise à jour : 30/04/2021