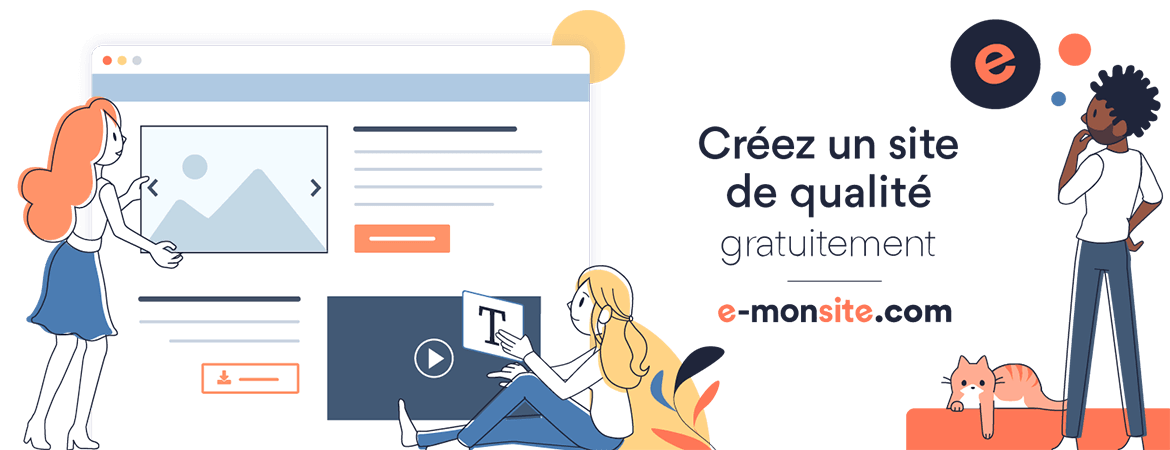Sentiment de la nature
Rôle de Rousseau ?
 Bien entendu, le sentiment de la nature existait au siècle précédent, et pas uniquement chez quelques isolés comme La Fontaine, Boileau ou Mme de Sévigné. Ce n’est pas Rousseau et sa Nouvelle Héloïse qui ont donné à ses contemporains le goût de la nature. Avant 1761 (date de parution du roman), les maisons de campagne, villégiatures et promenades autour de Paris se multiplient. Toutefois, Rousseau contribue à cet engouement.
Bien entendu, le sentiment de la nature existait au siècle précédent, et pas uniquement chez quelques isolés comme La Fontaine, Boileau ou Mme de Sévigné. Ce n’est pas Rousseau et sa Nouvelle Héloïse qui ont donné à ses contemporains le goût de la nature. Avant 1761 (date de parution du roman), les maisons de campagne, villégiatures et promenades autour de Paris se multiplient. Toutefois, Rousseau contribue à cet engouement.
On associe les notions de nature, simplicité et vertu.
Le goût évolue : on passe des jardins de Le Nôtre à la française du 17e siècle aux jardins à l’anglaise où la nature n’est plus domestiquée. On apprécie également les jardins exotiques sur le modèle de la Chine. Après 1770 surgissent les « folies » à Monceau, Bagatelle ou Ermenonville.
L’abbé Delille définit et compare les jardins à l'anglaise et à la française dans son poème sur les jardins (1781) :
Les Jardins
« Deux genres, dès longtemps ambitieux rivaux,
Se disputent nos vœux. L’un à nos yeux présente
D’un dessin régulier l’ordonnance imposante,
Donne aux arbres des lois, aux ondes des entraves.
L’autre, de la nature amant respectueux,
L’orne sans la garder et fait naître avec art
Les beautés du désordre et même du hasard.
Chacun d’eux a ses droits ; n’excluons l’un ni l’autre.
Je ne décide point entre Kent et Le Nôtre. »
Mais Rousseau introduit une nouveauté : la montagne. Bientôt, des voyageurs fervents de Saint-Preux et Julie partent sur les traces des deux amants. On découvre le lac de Genève, le Valais, la vallée de Lauterbrunnen, Grindelwald. On multiplie les guides et les itinéraires, les auberges sont pleines et les voyages de noces se font souvent en Suisse. Après la beauté des Alpes suisses, l’engouement pour les Pyrénées commencera peu avant la Révolution.
Dans un registre lyrique, Rousseau écrit dans les Rêveries du promeneur solitaire : « Quand le soir approchait je descendais des cimes de l’île et j’allais volontiers m’asseoir au bord du lac sur la grève dans quelque asile caché ; là le bruit des vagues et l’agitation de l’eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation la plongeaient dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m’en fusse aperçu. Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléaient aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisaient pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. »
À travers la littérature, ce sentiment de la nature va tenir une place de plus en plus importante : on se lasse des œuvres où les paysannes sont vêtues de soie ou de velours et portent des bijoux. Mme Favart joue Bastien et Bastienne avec des sabots et, pour tout bijou, une croix en or au cou.
On lit la traduction des Alpes de Haller, et les poèmes de Gessner. On lit sans sourciller le mot « cruche », impensable un demi-siècle plus tôt. Le style noble, académique, classique a tendance à disparaître. Delille se loue dans son poème des Jardins, de pouvoir employer le mot de « vache » (et non celui de génisse comme le voulait Boileau) et de « fumier. » Pourtant, les romantiques du siècle suivant le considèreront comme le modèle de la poésie académique et le rejetteront.
Par ailleurs, on trouve une influence du roman gothique anglais, plus sombre, avec Walpole, Young et ses Nuits, Ossian et le Werther de Goethe. Tombeaux et ruines n’effraient plus.
 On retrouve cette tendance en peinture, avec les tableaux de Vernet dont Diderot, dans ses Salons, donne des commentaires exaltés : tempêtes, clairs de lune sur des rivages hérissés de rochers, gorges sauvages, arbres tourmentés et torrents furieux. Les ruines d’Hubert Robert font sensation.
On retrouve cette tendance en peinture, avec les tableaux de Vernet dont Diderot, dans ses Salons, donne des commentaires exaltés : tempêtes, clairs de lune sur des rivages hérissés de rochers, gorges sauvages, arbres tourmentés et torrents furieux. Les ruines d’Hubert Robert font sensation.
La nature exotique, du moins comme on se l’imagine, est représentée par Paul et Virginie, qui connaît un grand succès.
On va plus loin : Rousseau, dans son Discours sur les sciences et les arts et sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, prétend démontrer que l’homme n’a été heureux qu’à l’état de nature, avant le commencement de la civilisation, dans un âge d’or pastoral. Mais cet idéal du bon sauvage n’est évidemment qu’une utopie. On retrouve cette vie idyllique dans les premières œuvres de Chateaubriand, Atala et Les Natchez. Cet idéal s’oppose à celui des Encyclopédistes qui assurent que le bonheur naît du progrès matériel et de la civilisation.
Chateaubriand écrit dans René (1802) « Nous aimions à gravir les coteaux ensemble, à voguer sur le lac, à parcourir les bois à la chute des feuilles : promenades dont le souvenir remplit encore mon âme de délices. Ô illusions de l’enfance et de la patrie, ne perdez-vous jamais vos douceurs ? » Et, plus loin : « Comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j’éprouvais dans mes promenades ? Les sons que rendent les passions dans le vide d’un cœur solitaire ressemblent au murmure que les vents et les eaux font entendre dans le silence d’un désert ; on en jouit, mais on ne peut les peindre. L’automne me surprit au milieu de ces incertitudes : j’entrai avec ravissement dans le mois des tempêtes. Tantôt j’aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu des vents, des nuages et des fantômes ; tantôt j’enviais jusqu’au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses mains à l’humble feu de broussailles qu’il avait allumé au coin d’un bois. J’écoutais ses chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans tout pays le chant naturel de l’homme est triste, lors même qu’il exprime le bonheur. Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, et où nous sommes forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré aux soupirs. Le jour, je m’égarais sur de grandes bruyères terminées par des forêts. Qu’il fallait peu de chose à ma rêverie ! […] « Levez-vous vite, orages désirés qui devez emporter René dans les espaces d’une autre vie ! » Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté, et comme possédé par le démon de mon cœur. »
Convenons toutefois que Rousseau, avec l’Émile, fait quelques dégâts : on lâche les enfants à l’air libre, on ne leur apprend rien, ils ne suivent aucune discipline. Mais dans l’ensemble, on garde son bon sens. On retient par exemple qu’une mère doit nourrir son enfant (Marie-Antoinette elle-même voulut sacrifier un temps à cette mode), on fait construire des chaumières et des fermes dans les parcs comme à Trianon ou à Rambouillet (sa laiterie est réputée) et on se promène davantage selon les conseils du docteur suisse Tronchin et on invente même le verbe « tronchiner ». Le docteur Tronchin recommande aux dames de la bonne société de s’aérer, de se donner du mouvement, c’est-à-dire d’aller au bout du jardin : comment aller plus loin en effet perchée sur des mules de satin aux talons de six pouces, encombrée de paniers si larges qu’il faut les replier pour passer les portes, et écrasée sous des coiffures de deux pieds dans lesquelles on glisse des fleurs avec leur vases ou des oiseaux avec leur cage ?
Linné et ses plantes érotiques
« Il [Carl von Linné, chef de file de la botanique moderne] décrit ses travaux dans Systema naturae, un opuscule qui fit scandale en 1735. Non pas que le sexe des plantes y soit mis en valeur, mais parce que l'auteur, qui voulait vulgariser sa théorie, comparait les fleurs à des « maisons » où se retrouvaient « mari », les organes mâles, et « femme », les organes femelles. Au passage, pour rendre son discours compréhensible par tous, il attribuait aux plantes les mœurs tels qu'ils étaient peints dans les sociétés humaines [...] Concrètement, une plante qui présenterait un style unique et six étamines (c'est le cas du Lis) appartiendrait à la classe du Hexandria et à l'ordre des Monogynia... Autrement dit, la femme a dans son lit six amants ! [...] Linné n'y allait pas par quatre chemins, attribuant aux fleurs les pires turpitudes sexuelles, décrivant les situations les plus osées et les orgies les plus scandaleuses. Très vite, le système de Linné sera taxé de « système lubrique » ou, plus sobrement, de puéril. Certains de ses détracteurs n'hésitant pas à parler de « répugnante prostitution » et « d'immoralités » innommables. Malgré ces polémiques, les « mariages » de Linné sont si efficaces, sa classification si fonctionnelle, qu'elle est adoptée dans toute l'Europe dès 1740 ! »
Sources : L'Herbier érotique, Bernard Bertrand, Plume de carotte, 2005.
Remarque
Au 18e siècle, érotique n'a pas le sens actuel. Un poème érotique par exemple est simplement un poème d'amour. Sébastien Mercier (voir son Tableau de Paris) publie ainsi en 1793 Philédon et Prothumie, poème érotique. Au chapitre 65 du Tableau de Paris, il se plaint de ce que la poésie érotique devienne licencieuse.
Poème sur Les Jardins ou l'art d'embellir les paysages (Delille, 1782)
 Les quatre chants de ce poème didactique (poésie descriptive), Les Jardins ou l'Art d'embellir les paysages (Delille), célèbrent les charmes d’une nature modelée par l’homme : jardins façonnés, décorations florales et cascades, rochers et jeux de lumières, espaces vivants où se déroulent des scènes bucoliques, amoureuses ou solennelles. Structure raide et souci encyclopédique n’enlèvent pas les qualités de l’ouvrage : sensibilité, nostalgie, fluidité et beauté fugace des choses proposent un renouveau dans l’alliance fragile entre nature, imaginaire et civilisation. Le sens de la nature le rapproche de Bernardin de Saint-Pierre et on sent chez Delille un effort pour passer de la description à la suggestion de l’émotion qui fera les beaux jours du romantisme de Lamartine (« Le Vallon » ou « Le Lac »).
Les quatre chants de ce poème didactique (poésie descriptive), Les Jardins ou l'Art d'embellir les paysages (Delille), célèbrent les charmes d’une nature modelée par l’homme : jardins façonnés, décorations florales et cascades, rochers et jeux de lumières, espaces vivants où se déroulent des scènes bucoliques, amoureuses ou solennelles. Structure raide et souci encyclopédique n’enlèvent pas les qualités de l’ouvrage : sensibilité, nostalgie, fluidité et beauté fugace des choses proposent un renouveau dans l’alliance fragile entre nature, imaginaire et civilisation. Le sens de la nature le rapproche de Bernardin de Saint-Pierre et on sent chez Delille un effort pour passer de la description à la suggestion de l’émotion qui fera les beaux jours du romantisme de Lamartine (« Le Vallon » ou « Le Lac »).
Le sujet répond à la vogue des jardins anglais de Fragonard et à la volonté de diriger la nature dont s‘inspire la Julie de La Nouvelle Héloïse (Rousseau) quand elle réalise avec « L’Élysée » un parc selon son cœur.
Mme Geoffrin le découvre et Voltaire le protège. On voit en lui le Virgile du siècle quand il publie en vers des Géorgiques (1770). Sous l’Empire, il fera figure de maître incontesté du néo-classicisme avec son épopée L’Imagination qui ouvre au sensualisme la poésie philosophique. On pense à Milton.
Extrait du chant II, parfois titré « Charme de l’Automne »
Des conseils au jardinier, Delille passe à l’évocation des belles teintes de l’automne, puis se laisse envahir par la mélancolie de la saison.
« ... Ainsi que les couleurs et les formes amies,
Connaissez les couleurs, les formes ennemies.
Le frêne aux longs rameaux dans les airs élancés,
Repousserait le saule aux longs rameaux baissés ;
Le vert du peuplier combat celui du chêne :
Mais l’art industrieux peut adoucir leur haine,
Et, de leur union médiateur heureux,
Un arbre mitoyen les concilie entre eux.
Ainsi, par une teinte avec art assortie,
Vernet de deux couleurs éteint l’antipathie.
Tu connus ce secret, ô toi (1) dont le coteau,
Dont la verte colline offre un si doux tableau,
Qui, des bois par degrés nuançant la verdure,
Surpassa Le Lorrain et vainquis la nature.
Observez comme lui tous ces différents verts,
Plus sombres ou plus gais, plus foncés ou plus clairs.
Remarquez-les surtout, lorsque le pâle automne,
Près de la voir flétrir, embellit sa couronne :
Que de variété ! que de pompe et d’éclat !
Le pourpre, l’orangé, l’opale, l’incarnat,
De leurs riches couleurs étalent l’abondance.
Hélas ! tout cet éclat marque leur décadence.
Tel est le sort commun. Bientôt les aquilons
Des dépouilles des bois vont joncher les vallons
De moment en moment la feuille sur la terre
En tombant interrompt le rêveur solitaire.
Mais ces ruines même ont pour moi des attraits.
Là, si mon cœur nourrit quelques profonds regrets,
Si quelque souvenir vint rouvrir ma blessure,
J’aime à mêler mon deuil au deuil de la nature ;
De ces bois desséchés, de ces rameaux flétris,
Seul, errant, je me plais à fouler les débris.
Ils sont passés les jours d’ivresse et de folie :
Viens, je me livre à toi, tendre mélancolie ;
Viens, non le front chargé des nuages affreux
Dont marche enveloppé le chagrin ténébreux,
Mais l’œil demi-voilé, mais telle qu’en automne
À travers des vapeurs un jour plus doux rayonne ;
Viens, le regard pensif, le front calme, et les yeux
Tout prêts à s’humecter de pleurs délicieux... »
Notes
(1) Hommage au duc d’Harcourt, pour son jardin de la Colline, près de Caen.
Extrait du chant III, parfois titré « Jeux d’eau »
Fraîches, vivantes et variée dans leurs jeux, les eaux sont l’âme des jardins. On peut préférer sans doute la spontanéité de Ronsard lorsqu’il chantait la fontaine Bellerie mais, dans le cadre étroit d’une nature asservie par l’homme, Delille traduit assez bien des impressions agréables. Il parle ici des jets d’eau.
« ... Persuadez aux yeux que d’un coup de baguette
Une Fée, en passant, s’est fait cette retraite.
Tel j’ai vu de Saint-Cloud le bocage enchanteur ;
L’œil de son jet hardi mesure la hauteur ;
Aux eaux qui sur les eaux retombent et bondissent,
Les bassins, les bosquets, les grottes applaudissent ;
Le gazon est plus vert, l’air plus frais ; les oiseaux
S’animent au doux bruit de la chute des eaux,
Et les bois inclinant leurs têtes arrosées,
Semblent s’épanouir à ces douces rosées.
Plus simple, plus champêtre, et non moins belle aux yeux,
La cascade ornera de plus sauvages lieux.
De près est admirée, et de loin entendue
Cette eau toujours tombante et toujours suspendue ;
Variée, imposante, elle anime à la fois
Les rochers et la terre, et les eaux et les bois.
Employez donc cet art ; mais loin l’architecture
De ces tristes gradins, où, tombant en mesure,
D’un mouvement égal les flots précipités
Jusque dans leur fureur marchent à pas comptés (1).
La variété seule a le droit de vous plaire.
La cascade d’ailleurs a plus d’un caractère.
Il faut choisir. Tantôt d’un cours tumultueux
L’eau se précipitant dans son lit tortueux
Court, tombe et rejaillit, retombe, écume et gronde ;
Tantôt avec lenteur développant son onde,
Sans colère, sans bruit, un ruisseau doux et pur
S’épanche, se déploie en un voile d’azur.
L’œil aime à contempler ces frais amphithéâtres,
Et l’or des feux du jour sur les nappes bleuâtres,
Et le noir des rochers, et le vert des roseaux,
Et l’éclat argenté de l’écume des eaux.
Consultez donc l’effet que votre art veut produire ;
Et ces flots, toujours prompts à se laisser conduire,
Vont vous offrir, plus lents ou plus impétueux,
Des tableaux gais ou fiers, grands ou voluptueux ;
Tableaux toujours puissants ! Eh ! qui n’a pas de l’onde
Éprouvé sur son cœur l’impression profonde ?... »
_ _ _
(1) Delille souhaite que le jardinier imite la nature au lieu de lui substituer un ordre géométrique.
Remarque : Baudelaire traite Delille de « misérable auteur des Jardins. » On s'en serait douté ! On ignore ce qu'il pouvait penser de ces vers écrits par le cardinal de Bernis (élu à l'Académie Française à 29 ans), tout à fait exemplaires de la poésie maniérée de ce temps :
« L'amour est un enfant, mon maître.
Il l'est aussi du berger et du roi.
Il est fait comme vous, il pense comme moi,
Mais il est plus hardi peut-être... »
On sait par contre que Voltaire surnommait Bernis « Babet la Bouquetière »...
Remarque sur la poésie du 18e siècle
D'une manière générale, on a pu parler, pour le 18e siècle, de poésie emprisonnée, le 18e siècle restant celui de la philosophie. A ce propos, Jean Tortel écrit dans Un certain 17e siècle :
« Au 18e siècle, la poésie continue celle du 17e et, à force de durer, elle se répète et s’exténue. La faute en est sans doute à la révérence des poètes pour la manière de dire classique qu’ils prennent pour modèle indépassable. Ce qui est tout à fait contradictoire avec l’essence même de ce siècle instable et secoué de multiples soubresauts : ainsi, le langage poétique figé s’oppose à la pensée, à la morale et à la parole nouvelles qui aboutiront à la Révolution. Mais la poésie ne changera pas pour autant. Cependant, on tente d’accéder par les vers à des sujets nouveaux, en phase avec les nouvelles connaissances scientifiques, comme Boufflers dans Le Libre Arbitre ou Delille dans Les Trois Règnes de la Nature. Comme dit Chénier : « Sur des pensers nouveaux, faisons des vers antiques. » Boileau et Racine restent des modèles indépassables. Respect des poncifs, souci d’élégance et de politesse chez ces poètes qui fréquentent les salons de la bonne société où l’on est avant tout respectueux du bon usage.
C’est sans doute à Chateaubriand (après Rousseau notamment) et à son « Levez-vous, orages désirés » que l’on doit le déferlement de la sensibilité, de l’imagination, du souvenir, de la perte de soi, du rêve, de la nature et de la solitude qui caractérisent le romantisme du siècle suivant.
Mais, au 18e, ce n’est pas le dessèchement des esprits qui est en cause : pourquoi affecterait-il le langage et non la peinture (Watteau, Chardin et d’autres) ou la musique (Couperin, Rameau, etc.) ? Rousseau bien sûr, mais aussi Diderot, l’évolution du drame et la comédie larmoyante indiquent l’envahissement de la sensibilité : ce qu’on appelle le « préromantisme » remonte à 1750 environ. »
Gil Blas vertueux, amoureux d’une vie champêtre. Le Sage proche de Rousseau ?
 L’Histoire de Gil Blas de Santillane, publiée de 1715 à 1735, composée sur le modèle espagnol est le genre même du roman picaresque, pratiqué en Espagne depuis la fin du 16e siècle. Il s’agit de narrer les multiples et divertissantes aventures d’un picaro, vaurien sympathique, pauvre hère dont l’injustice sociale fait un fripon, mais capable de bonnes actions. Candide ou cynique, berné ou fripon, valet ou confident du premier ministre ? Le Sage s’intéresse surtout aux milieux sociaux qu’il traverse, à leurs mœurs, à leurs travers et à leurs vices : brigands, cour, palais de l’archevêque, noblesse, clergé, médecins, homes de lettres, comédiens, valets. Bien entendu sous couvert de couleur locale espagnole, Le Sage fait la satire de la société française de la Régence. Notons également l’importance qu’il accorde aux détails matériels, d’où un certain réalisme truculent et son souci de décrire, plutôt que des caractères (comme La Bruyère) des individus.
L’Histoire de Gil Blas de Santillane, publiée de 1715 à 1735, composée sur le modèle espagnol est le genre même du roman picaresque, pratiqué en Espagne depuis la fin du 16e siècle. Il s’agit de narrer les multiples et divertissantes aventures d’un picaro, vaurien sympathique, pauvre hère dont l’injustice sociale fait un fripon, mais capable de bonnes actions. Candide ou cynique, berné ou fripon, valet ou confident du premier ministre ? Le Sage s’intéresse surtout aux milieux sociaux qu’il traverse, à leurs mœurs, à leurs travers et à leurs vices : brigands, cour, palais de l’archevêque, noblesse, clergé, médecins, homes de lettres, comédiens, valets. Bien entendu sous couvert de couleur locale espagnole, Le Sage fait la satire de la société française de la Régence. Notons également l’importance qu’il accorde aux détails matériels, d’où un certain réalisme truculent et son souci de décrire, plutôt que des caractères (comme La Bruyère) des individus.
Son premier acte de brigand (après être entré dans la troupe de Raphaël) est un acte de vertu qui pourrait passer pour héroïque. Avec ses compagnons, dans un bois, au milieu de la nuit, il délivre le comte de Polan et sa fille des mains de dangereux bandits. Une action généreuse qui changera complètement la destinée de Gil Blas, désormais sous la protection du comte. Mais il faut d’abord qu’il sorte de la carrière de voleur. Ce qu’il fait.
Il devient l’intendant de don Alphonse de Leyva, son compagnon de route, qui vient par hasard de retrouver ses parents et d’épouser Séraphine, la fille du comte.
Après maintes aventures et une longue maladie, il déclare : « Je me proposai plutôt d’acheter une chaumière et d’y aller vivre en philosophe. »
Cette chaumière, surprenante dans l‘œuvre de Lesage, en modifie la perspective : nous quittons le roman picaresque pour une « bergerie ». Gil Blas a certes vieilli mais les mœurs ont changé : on se lasse des plaisirs de la ville et le rêve idyllique de Rousseau n’est pas loin. On pense, en lisant ces propos de Gil Blas, à la Nouvelle Héloïse.
Tout en cheminant avec Scipion vers Madrid, il s’explique : « Je me suis formé, des agréments de la vie champêtre, une idée qui m’enchante, qui m’en fait jouir par avance. Il me semble déjà que je vois l’émail des prairies, que j’entends chanter les rossignols et murmurer les ruisseaux ; tantôt je crois prendre le divertissement de la chasse et tantôt celui de la pêche. Imagine-toi, mon ami, tous les différents plaisirs qui nous attendent dans la solitude et tu en seras charmé comme moi. À l’égard de notre nourriture, a plus simple sera la meilleure. Un morceau de pain pourra nous contenter ; quand nous serons pressés de la faim, nous le mangerons avec un appétit qui nous le fera trouver excellent. La volupté n’est pas dans la bonté des aliments exquis, elle est tout en nous, et cela est si vrai, que les repas les plus délicieux ne sont pas ceux où je vois régner la délicatesse et l’abondance. La frugalité est une source de délices merveilleuses pour la santé. »
Il faut dire que Scipion, en entendant ces paroles, fait un peu la grimace et il accepte très bien la solitude à condition d’y amener un bon cuisinier. Gil Blas, converti à la frugalité de la vie champêtre, s’en va donc vivre avec Scipion, non pas dans une chaumière, mais dans le château de Lirias, que lui donne Alphonse de Leyva, reconnaissant. Gil Blas épouse la fille de son fermier tandis que Scipion retrouve sa femme qu’il avait perdue depuis quinze ans, et se réconcilie avec elle.
Mais rien n’est fini, tout recommence. Gil Blas perd sa femme et, pour se consoler de son veuvage, revient à la Cour.
Après diverses péripéties, il entre à Lirias où, dès son arrivée, il fait le même jour deux mariages. Il donne la fille de Scipion à un seigneur du voisinage, et il épouse lui-même la sœur de ce seigneur, mettant dans la corbeille de noces les lettres patentes de noblesse que le roi vient de lui octroyer pour ses bons et loyaux services.
Gil Blas, gentilhomme, est tout fier de ce triomphe qu’il a remporté sur la société. Le roman s’achève ainsi : « Il y a déjà trios ans, ami lecteur, que je mène une vie délicieuse avec des personnes si chères ; pour comble de satisfaction, le Ciel a daigné m’accorder deux enfants dont l’éducation va devenir l’amusement de mes vieux jours. » Là encore, on songe à Rousseau et à son Émile.
* * *
Date de dernière mise à jour : 13/12/2019