Christine de Suède, reine savante
Biographie
 Christine de Suède apparaît comme un personnage complexe : entière, quasiment frénétique dans ses engouements, ni belle ni élégante… Amoureuse des lettres et des arts, elle désirait transformer Stockholm en une Athènes brillante consacrée aux fêtes et aux études. Elle y fit venir Descartes qui, arrivé en octobre 1649, passa des heures à s’entretenir avec elle dans des salles glacées, prit froid et mourut le 11 février 1650.
Christine de Suède apparaît comme un personnage complexe : entière, quasiment frénétique dans ses engouements, ni belle ni élégante… Amoureuse des lettres et des arts, elle désirait transformer Stockholm en une Athènes brillante consacrée aux fêtes et aux études. Elle y fit venir Descartes qui, arrivé en octobre 1649, passa des heures à s’entretenir avec elle dans des salles glacées, prit froid et mourut le 11 février 1650.
Comme Richelieu, elle créa une académie littéraire on ne figurait d'ailleurs aucun de ses compatriotes et où l'on s'entretenait... en latin. Elle écrit ses lettres en français, qu'elle manie fort bien.
La Suède (après le traité de paix signé par Gustave-Adolphe en 1631) apparaît comme une des deux grandes puissances dirigeantes de l'Europe (l'autre étant la France), et c'est à elle que revient, pour une large part, le rôle de diffuser la culture française au XVIIe siècle. Les principales familles du royaume élèvent leurs enfants à la française, dans le culte de la langue et des lettres françaises. Cette élite annonce la civilisation européenne dont vont se réclamer les grands personnages du XVIIIe siècle.
En 1683, Iphigénie (qui date seulement de 1674) est représentée à Stockholm. En 1699, sur l'invitation de la cour, une troupe de comédiens français gagne la Suède et y joue nos grands dramaturges, Racine en particulier, en français bien entendu que le public cultivé comprend (et parle) parfaitement.
Mais revenons-en à Christine : issue d’une famille où l’on comptait de nombreux malades mentaux, habituée depuis l’âge de six ans à se considérer comme le chef du second royaume de l’Europe, Christine, selon les préceptes paternels, fut élevée comme un bourreau de travail : les leçons commençaient à six heures du matin pour finir à six heures du soir. A ce compte, elle devint – monstrueusement – savante, dédaignant les femmes coquettes et leur médiocrité intellectuelle et s’habillant souvent en homme. On lui prête d’ailleurs des mœurs saphiques. Elle fut reçue à la cour de France où elle laissa un souvenir pour le moins… surprenant. Mlle de Scudéry fit son « portrait ».
Elle prit en horreur le luthéranisme sévère qui lui paraissait le fait d’une nation encore barbare et fut attirée par le soleil et l’allégresse du Sud, admirant les « papistes », subissant le prestige de la littérature française, recherchant l’estime et le commerce des écrivains français. Convertie au catholicisme, elle renonça solennellement au trône après un règne de neuf ans (1645-1654).
Elle s’expatria à Rome où elle mena une vie assez agitée.
Voyage de Descartes en Suède : hésitations
 La reine Christine invite Descartes en Suède. Dans la première lettre du 31 mars 1649, Descartes fait part à Chanut[1] de ses sentiments « officiels ».
La reine Christine invite Descartes en Suède. Dans la première lettre du 31 mars 1649, Descartes fait part à Chanut[1] de ses sentiments « officiels ».
« … J’ai tant de vénération pour les hautes et rares qualités de cette princesse que les moindres de ses volontés sont des commandements très absolus à mon regard : c’est pourquoi je ne mets point ce voyage en délibération, je me résous seulement à obéir. Mais, pour ce que vos ne me prescrivez aucun temps, et que vous ne le proposez que comme une promenade dont je pourrais être de retour dans cet été, j’ai pensé qu’il serait malaisé que je pusse donner grande satisfaction à Sa Majesté en si peu de temps, et qu’elle aura peut-être plus agréable que je prenne mes mesures plus longues et fasse mon compte de passer l’hiver à Stockholm. De quoi je tirerai un avantage que j’avoue être considérable à un homme qui n’est plus jeune[2], et qu’une retraite de vingt ans a entièrement désaccoutumé de la fatigue ; c’est qu’il ne sera pont nécessaire que je me mettre en chemin au commencement du printemps, ni à la fin de l’automne, et que je pourrai prendre la saison la plus sûre et la plus commode qui sera, je crois, vers le milieu de l’été ; outre que j’espère avoir cependant le loisir de mettre ordre à quelques affaires qui m’importent. […] Au reste, je ne sais en quels termes je vous puis remercier de toutes les offres qu’il vous plaît me faire, jusques à me vouloir même loger chez vous… »
Mais il écrit une deuxième lettre le même jour où, cette fois, il est plus franc :
« … J’ai réservé pour celle-ci [cette lettre] ce que je pensais n’être pas besoin qu’elle [la reine] vît, à savoir, que j’ai beaucoup plus de difficulté à me résoudre à ce voyage, que je ne me serais moi-même imaginé. Ce n’est pas que je n’aie un très grand désir de rendre service à cette princesse. J’ai tant de créances à vos paroles et vous me l’avez représentée avec des mœurs et un esprit que j’admire et estime si fort, qu’encore qu’elle ne serait point en la haute fortune où elle est, et n’aurait qu’une naissance commune, si seulement j’osais espérer que mon voyage lui fût utile, j’en voudrais entreprendre un plus long et plus difficile que celui de Suède, pour avoir l‘honneur de lui offrir tout ce que je puis contribuer pour satisfaire à son désir. Mais l’expérience m’a enseigné que, même entre les personnes de très bon esprit, et qui ont un grand désir de savoir, il n’y en a que fort peu qui se puissent donner le loisir d’entrer en mes pensées, en sorte que je n’ai pas sujet de l’espérer d’une reine qui a une infinité d’autres occupations. L’expérience m’a aussi enseigné que, bien que mes opinions surprennent d’abord, à cause qu’elles sont fort différentes des vulgaires, toutefois, après qu’on les a comprises, on les trouve si simples et si conformes au sens commun, qu’on cesse entièrement de les admirer et par même moyen d’en faire cas, à cause que le naturel des hommes est tel, qu’ils n’estiment que les choses qui leur laissent de l’admiration et qu’ils ne possèdent pas tout à fait. […]
Au reste, il semble que la fortune est jalouse de ce que je n’ai jamais rien voulu attendre d’elle, et que j’ai tâché de conduire ma vie en telle sorte qu’elle n‘eût sur moi aucun pouvoir ; car elle ne manque jamais de me désobliger, sitôt qu’elle en peut avoir quelque occasion. Je l’ai éprouvé en tous les trois voyages que j’ai faits en France, depuis que je me suis retiré en ce pays, mais particulièrement au dernier, qui m‘avait été commandé comme de la part du Roi[3]. Et pour me convier à la faire, on m’avait envoyé des lettres en parchemin, et fort bien scellées, qui contenaient des éloges plus grands que je n’en méritais, et le don d’une pension assez honnête. Et de plus, par des lettres particulières de ceux qui m‘envoyaient celles du Roi, on me promettait beaucoup plus que cela, sitôt que je serais arrivé. […] Mais ce qui m’a le plus dégoûté, c’est qu’aucun d’eux [ceux qui l’ont appelé] n’a témoigné vouloir connaître autre chose de moi que mon visage ; en sorte que j’ai sujet de croire qu’ils me voulaient seulement avoir en France comme un éléphant ou une panthère, à case de la rareté, et non point pout être utile à quelque chose.
Je n’imagine rien de pareil au lieu où vous êtres ; mais les mauvais succès de tous les voyages que j’ai faits depuis vingt ans, me font craindre qu’il ne me reste plus, pour celui-ci, que de trouver en chemin des voleurs qui me dépouillent, ou un naufrage qui m’ôte la vie[4]. Toutefois cela ne me retiendra pas, si vous jugez que cette incomparable Reine continue dans le désir d’examiner mes opinions et qu’elle en puisse prendre le loisir ; je serai ravi d’être si heureux que de lui pouvoir rendre service. Mais si cela n’est pas, et qu’elle ait seulement eu quelque curiosité qui lui soit maintenant passée, je vous supplie et vous conjure de faire en sorte que, sans lui déplaire, je puisse être dispensé de ce voyage… »
En septembre 1649, il se rend toutefois en Suède, ce « pays des ours, entre des rochers et des glaces. » Accueilli à la cour, il donne des leçons de philosophie à Christine (dès cinq heures du matin) et compose un ballet destiné à célébrer le traité de Westphalie, La Naissance de la Paix. Il meurt le 11 février 1650, suite à un refroidissement (congestion pulmonaire).
La Gazette d'Anvers annonce sa mort en ces termes : « En Suède un sot vient de mourir, qui disait qu'il pourrait vivre aussi longtemps qu'il voulait. »
Ses manuscrits sont transmis à son ami Clerselier qui publiera trois volumes de ses Lettres (1656, 1659 et 1667).
_________
[1] Ambassadeur de France à Stockholm et ami de Descartes.
[2] Né le 31 mars 1596, Descartes a alors 53 ans.
[3] Louis XIII.
[4] Descartes ne croit pas si bien dire. En effet, il mourra à Stockholm le 11 février 1650.
Lettre de Descartes à Christine de Suède sur le souverain bien (20 novembre 1647)
Madame,
« J’ai appris de M. Chanut[1] qu’il plaît à Votre Majesté que j’aie l’honneur de lui exposer l’opinion que j’ai touchant le Souverain Bien, considéré au sens que les philosophes anciens en ont parlé ; et je tiens ce commandement pour une si grande faveur que le désir que j’ai d’y obéir me détourne de toute autre pensée, et fait que, sans excuser mon insuffisance, je mettrai ici, en peu de mots, tout ce que je pourrai savoir sur cette matière.
On peut considérer la bonté de chaque chose en elle-même, sans la rapporter à autrui, auquel sens il est évident que c’est Dieu qui est le souverain bien, pour ce qu’il est incomparablement plus parfait que les créatures ; mais on peut aussi la rapporter à nous, et en ce sens, je ne vois rien que nous devions estimer bien, sinon ce qui nous appartient en quelque façon, et qui est tel, que c’est perfection pour nous de l’avoir. Ainsi les philosophes anciens qui, n’étant point éclairés de la lumière de la foi, ne savaient rien de la béatitude surnaturelle, ne considéraient que les biens que nous pouvons posséder en cette vie ; et c’était entre ceux-là qu’ils cherchaient lequel était le souverain ; c’est-à-dire le principal et le plus grand.
Mais, afin que je le puisse déterminer, je considère que nous devons estimer biens, à notre égard, que ceux que nous possédons, ou bien que nous avons pouvoir d’acquérir. Et cela posé, il me semble que le souverain bien de tous les hommes ensemble est un amas ou un assemblage de tous les biens, tant de l’âme que du corps et de la fortune, qui peuvent être en quelques hommes ; mais que celui d’un chacun en particulier est tout autre chose, et qu’il ne consiste qu’en une ferme volonté de bien faire, et au contentement qu’elle produit. Dont la raison est que je ne remarque aucun autre bien qui me semble si grand, ni qui soit entièrement au pouvoir d’un chacun. Car, pour les biens du corps et de la fortune, ils ne dépendent point absolument de nous ; et ceux de l’âme se rapportent tous à deux chefs qui sont, l’un de connaître, et l’autre de vouloir ce qui est bon ; mais la connaissance est souvent au-delà de nos forces ; c’est pourquoi il ne reste que notre volonté, dont nous puissions absolument disposer. Et je ne vois point qu’il soit possible d’en disposer mieux, que si l’on a toujours une ferme et constante résolution de faire exactement toutes les choses que l’on jugera être les meilleures, et d’employer toutes les forces de son esprit à les bien connaître.
Et par ce moyen je pense accorder les deux plus contraires et plus célèbres opinions des anciens, à savoir celle de Zénon[2], qui l’a mis en la vertu ou en l’honneur, et celle d’Épicure[3], qui l’a mis au contentement, auquel il a donné le nom de volupté. Car, comme tous les vices ne viennent que de l’incertitude et de la faiblesse qui suit l’ignorance, et qui fait naître les repentirs ; ainsi la vertu ne consiste qu’en la résolution et la vigueur avec laquelle on se porte à faire les choses qu’on croit être bonnes, pourvu que cette vigueur ne vienne pas d’opiniâtreté, mais de ce qu’on sait les avoir autant examinées, qu’on en a moralement de pouvoir. Et bien que ce qu’on fait alors puisse être mauvais, on est assuré néanmoins qu’on fait son devoir ; au lieu que, si on exécute quelque action de vertu, et que cependant on pense mal faire, ou bien qu’on néglige de savoir ce qui en est, on n’agit pas en homme vertueux. Pour ce qui est de l’honneur et de la louange, on les attribue souvent aux autres biens de la fortune ; mais, pour ce que je m’assure que Votre Majesté fait plus d’état de sa vertu que de sa couronne, je ne craindrai point ici de dire qu’il ne me semble pas qu’il y ait rien que cette vertu qu’on ait juste raison de louer. Tous les autres biens méritent seulement d’être estimés, et non point d’être honorés ou loués, si ce n’est en tant qu’on présuppose qu’ils sont acquis ou obtenue de Dieu par le bon usage du libre arbitre. Car l’honneur et la louange est une espèce de récompense, et il n’y a rien que ce qui dépend de la volonté, qu’on ait sujet de récompenser ou de punir.
Il me reste encore ici à prouver que c’est de ce bon usage du libre arbitre, que vient le plus grand et le plus solide contentement de la vie ; ce qui me semble n’être pas difficile, pour ce que, considérant avec soin en quoi consiste la volupté ou le plaisir, et généralement toutes les sortes de contentement qu’on peut avoir, je remarque, en premier lieu, qu’il n’y en a aucun qui ne soit entièrement en l’âme, bien que plusieurs dépendent du corps ; de même que c’est aussi l’âme qui voit, bien que ce soit par l’entremise des yeux. Puis je remarque qu’il n’y a rien qui puisse donner du contentement à l’âme, sinon l’opinion qu’elle a de posséder quelque bien, et que souvent cette opinion n’est en elle qu’une représentation fort confuse, et même que son union avec le corps est cause qu’elle se représente ordinairement certains biens incomparablement plus grands qu’ils ne sont ; mais que, si elle connaissait distinctement leur juste valeur, son contentement serait toujours proportionné à la grandeur du bien dont il procéderait. Je remarque aussi que la grandeur d’un bien, à notre égard, ne doit pas seulement être mesurée par la valeur de la chose en quoi il consiste, mais principalement aussi par la façon dont il se rapporte à nous ; et qu’outre que le libre arbitre est de soi la chose la plus noble qui puisse être en nous, d’autant qu’il nous rend en quelque façon pareils à Dieu et semble nous exempter de lui être sujets, et que, par conséquent, son bon usage est le plus grand de tous nos biens, il est aussi celui qui est le plus proprement nôtre et qui nous importe le plus, d’où il suit que ce n’est que de lui que nos plus grands contentements peuvent procéder. Aussi voit-on, par exemple, que le repos d’esprit et la satisfaction intérieure que sentent en eux-mêmes ceux qui savent qu’ils ne manquent jamais à faire leur mieux, tant pour connaître le bien que pour l‘acquérir, est un plaisir sans comparaison plus doux, plus durable et plus solide que tous ceux qui viennent d’ailleurs.
J’omets encore ici beaucoup d’autres choses, pour ce que, me représentant le nombre des affaires qui se rencontrent en la conduite d’un grand royaume, et dont Votre Majesté prend elle-même les soins, je n’ose lui demander plus longue audience. Mais j’envoie à M. Chanut quelques écrits[4], où j’ai mis mes sentiments plus au long touchant la même matière, afin que, s’il plaît à Votre Majesté de les voir, il m’oblige de les lui présenter, et que cela aide à témoigner avec combien de zèle et de dévotion, je suis,
Madame,
De Votre Majesté
Le très humble et très obéissant serviteur,
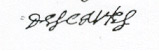
Sources : « La reine Christine, par l’intermédiaire de Chanut, souhaite connaître la doctrine morale de Descartes, cette dernière morale qui vient d’atteindre sa forme définitive dans la correspondance avec Élisabeth [Élisabeth de Bohême, princesse Palatine, à ne pas confondre avec Madame, belle-sœur de Louis XIV] et va trouver sa formulation en traité dans les Passions de l’âme. Comment la satisfaire, sinon en lui communiquant les lettres mêmes où cette morale s’est constituée […] ? Mais ces lettres sont privées. Rien ne garantit que la reine se réjouira de recevoir en guise de manuel ce qui fut écrit pour une autre, ou que cette autre acceptera de voir communiquer ce qui fut son secret […] » écrit Jean-Marie Beyssade dans son Introduction à la Correspondance avec Élisabeth et autres lettres (Flammarion, 1989). Cette lettre de Descartes provient de cette édition.
[1] Chanut, ami de Descartes, est ambassadeur de France en Suède.
[2] Zénon de Citium, philosophe grec (335-264 av. J.-C.), fonda le stoïcisme. Pour lui, le souverain bien réside dans la vertu.
[3] Épicure, philosophe grec (341-270 av. J.-C.), fait consister le souverain bien dans le plaisir. Sa physique atomiste est renouvelée au 17e siècle par les gassendistes (voir Gassendi).
[4] Le traité des Passions de l’âme et six lettres à la princesse Élisabeth.
Lettre de Descartes à Christine de Suède du 26 février 1649
Madame,
« S’il arrivait qu’un lettre me fût envoyée du ciel et que je la visse descendre des nues, je ne serais pas davantage surpris et ne la pourrais recevoir avec plus de respect et de vénération que j’ai reçu celle qu’il a plu à Votre Majesté de l’écrire. Mais je me reconnais si peu digne des remerciements qu’elle contient, que je ne les puis accepter que comme une faveur et une grâce, dont je demeure tellement redevable que je ne m’en saurai jamais dégager. L’honneur que j’avais ci-devant reçu d’être interrogé, de la part de Votre Majesté, par M. Chanut touchant le Souverain Bien, ne m’avait que trop payé de la réponse que j’avais faite. Et depuis, ayant appris par lui que cette réponse avait été favorablement reçu, cela m’avait si fort obligé, que je ne pouvais pas espérer ni souhaiter rien de plus pour si peu de choses ; particulièrement d’une princesse que Dieu a mise en si haut lieu, qui est environnée de tant d’affaires très importantes, dont elle prend elle-même les soins, et de qui les moindres actions peuvent tant pour le bien général de toute la terre, que tous ceux qui aiment la vertu se doivent estimer très heureux, lorsqu’ils peuvent avoir l’occasion de lui rendre quelque service. Et pour ce qu’en fais particulièrement profession d’être de ce nombre, j’ose ici protester à Votre Majesté qu’elle ne me saurait rien commander de si difficile, que je ne sois toujours prêt de faite tout mon possible pour l’exécuter ; et que si j’étais né Suédois ou Finlandais (1), je ne pourrais être avec plus de zèle, ni plus parfaitement que je suis,… [etc.] »
(1) Suède et Finlande font alors partie du même royaume.
Lettre à Chanut du même jour
Suite à la lettre à Christine de Suède sur le souverain bien en date du 20 novembre 1647, Descartes écrit à son ami Chanut (ambassadeur de France à Stockholm) le 26 février 1649, le même jour donc qu'à la reine :
Monsieur,
« Vous avez grande raison de penser que j’ai beaucoup plus de sujet d’admirer qu’une reine, perpétuellement agissante dans les affaires, se soit souvenue, après plusieurs mois[1] d’une lettre que j’avais eu l’honneur de lui écrire, et qu’elle ait pris la peine d’y répondre, que non pas qu’elle n’y ait point répondu plus tôt. J’ai été surpris de voir qu’elle écrit si nettement et si facilement en français ; toute notre nation lui en est très obligée et il me semble que cette princesse est bien plus créée à l’image de Dieu que le reste des hommes, d’autant qu’elle peut étendre ses soins à plus grand nombre de diverses occupations en même temps. […]
Mais encore que j’aie reçu, comme une faveur nullement méritée, la lettre que cette incomparable princesse a daigné m’écrire, et que j’admire qu’elle en ait pris la peine, je n‘admire pas en même façon qu’elle veuille prendre celle de lire le livre de mes Principes[2], à cause que je me persuade qu’il contient plusieurs vérités qu’on trouverait difficilement ailleurs. On peut dire que ce ne sont que des vérités de peu d’importance, touchant des matières de physique, qui semblent n’avoir rien de commun avec ce que doit savoir une reine. Mais, d’autant que l’esprit de celle-ci est capable de tout, et que ces vérités de physique font partie des fondements de la plus haute et plus parfaite morale, j’ose espérer qu’elle aura de la satisfaction de les connaître. Je serais ravi d’apprendre qu’elle vous eût choisi, avec M. Franshemius (sic)[3], pour la soulager en cette étude… »
[1] Lettre du 20 novembre 1647.
[2] Principes de la philosophie, publiés en latin à Amsterdam en juillet 1644 et publiés à Paris en français à en 1647.
[3] Johann Freinsheim, dit Freinshemius, originaire d’Ulm, philologue, professeur de politique et d‘éloquence à l’université d’Upsal en 1642. Il y fait une conférence sur le souverain bien en présence de la reine Christine le 17 septembre 1647, dont il devient le bibliothécaire et l’historiographe en 1647.
La reine Christine de Suède et La Rochefoucauld
En 1656, La Rochefoucauld fréquente la reine Christine de Suède, de passage à Paris. Vraisemblablement, il la connaît assez mal.
Qu’en dit-il dans ses Réflexions diverses (qui suivent ses Maximes) ?
« La reine de Suède, en paix dans ses États et avec ses voisins, aimée de ses sujets, respectée des étrangers, jeune et sans dévotion, a quitté volontairement son royaume et s’est réduite à une vie privée. Le roi de Pologne, de la même maison que la reine de Suède, s’est démis aussi de la royauté, par la seule lassitude d’être roi. » (17 – « Des événements de ce siècle »).
Il écrit sur la reine le sonnet suivant, découvert au 20e siècle :
Cessez, peuple du Nord, d’admirer la victoire
De Gustave indompté, qui d’une illustre ardeur
Aux guerriers allemands imprimant la terreur,
Finit ses jours heureux dans le champ de la gloire.
*
L’admirable Christine ornera mieux l’histoire.
Le mépris étonnant qu’elle a pour la grandeur
Des plus fiers conquérants efface la splendeur,
Et de son Père même obscurcit la mémoire.
*
Si Gustave a rangé des Princes sous ses lois,
De ses propres sujets Christine fait des Rois,
Il a pris des États et sa fille les donne.
*
Il s'est acquis un sceptre, elle quitte le sien
Et montre à l'univers, en laissant la couronne,
Qu'on peut régner partout en ne possédant rien.
Princesse pour le moins barbare, elle fait assassiner au château de Fontainebleau, le 10 novembre 1657, son grand écuyer et favori, Monadelschi, dans la Galerie des Cerfs. Elle dit alors à Mazarin : « Nous autres, gens du Nord, sommes un peu farouches et naturellement peu craintifs. [...] Je trouve beaucoup moins de difficultés à étrangler les gens qu'à les craindre. Pour l'action que j'ai faite avec Monaldeschi, je vous dis que si je ne l'avais pas faite, je ne me coucherais pas ce soir sans l'avoir faite, et je n'ai nulle raison de m'en repentir, mais j'en ai plus de cent mille d'en être ravie. Voilà mes sentiments sur ce sujet. »
Visite de la reine à l’Académie française
Un certain Olivier Patru écrit cette missive à M. d’Ablancourt[1]
« ... Il faut que je vous entretienne de la visite que la Reine de Suède[2] a faite à l’Académie il y eut lundi dernier quinze jours. Tu sauras donc qu’on ne fut averti que vers les huit à neuf heures du matin du dessein de cette princesse, tellement que quelques-uns de nos Messieurs n’en purent avoir l’avis [...] Nous étions quinze ou seize en tout [...]
La salle[3] où on reçut la princesse est fort belle. Il y avait au milieu une table tirée des deux bouts, couverte d’un tapis de velours bleu, avec une grande crépine[4] d’or et d’argent. Au bout d’en haut, il y avait un fauteuil de velours noir, avec un clinquant d’or large de quatre doigts, et, tout autour de la table, des chaises à dos de tapisserie. M. le Chancelier[5] oublia à faire mettre dans cette salle le portrait de la princesse, qu’elle a donné à la Compagnie. Sur les cinq heures, un valet de pied de la princesse vint savoir si la Compagnie était assemblée. À un moment de là, un autre valet de pied, mais du Roi, vint dire à M. le Chancelier que la Reine de Suède était au bout de la rue, et presque aussitôt on vit son carrosse entrer das la cour. M. le Chancelier, suivi de la Compagnie, l’alla recevoir au carrosse [...]
D’abord quelle fut entrée dans le lieu où on la devait recevoir, elle s’approcha du feu et parla à M. le Chancelier assez bas [...] Nous étions tous découverts et M. le Chancelier comme nous. Après que nous eûmes pris nos places, le Directeur[6] se leva, et nous avec lui. M. le Chancelier demeura assis. Le Directeur fit son compliment, mais si bas, que personne ne l’entendit : car il était tout courbé, et il n’y avait que la princesse et M. le Chancelier au plus qui pussent l’entendre [...] Après le compliment fit, nous nous rassîmes : le Directeur dit à la princesse qu’il avait fait un traité de la Douleur, pour ajouter à ses Caractères des Passions, et que si Sa Majesté l’avait agréable, il lui en lirait le premier chapitre. « Fort volontiers », dit-elle. Il le lut, et après l’avoir lu, il dit à la princesse qu’il n’en lirait pas davantage de peu de l’ennuyer. « Point du tout, dit-elle, car je m’imagine que le reste ressemble à ce que vous venez de lire. » Ensuite M. de Mézeray dit que M. Cotin avait quelques vers que Sa Majesté trouverait sans doute fort beaux, et que si elle l’avait agréable, on les lui lirait. M. Cotin prit aussitôt ses vers et les lut. Ils étaient fort beaux [...]
Ensuite le Directeur dit à la Reine que l’exercice ordinaire de la Compagnie était de travailler au dictionnaire, en attendant grammaire, rhétorique, etc., et que, si Sa Majesté l’avait agréable, on lui en lirait un cahier. « Fort volontiers », dit-elle. M. de Mézeray lut donc le mot de jeu, où, entre autres façons proverbiales, il y avait : Jeux de princes, qui ne plaisent qu’à ceux qui les font, pour dire une malignité ou une violence faite par quelqu’un qui est en puissance. Elle se mit à rire [...] Après que le mot jeu eut été lu, et après environ une heure de temps, la princesse, qui voyait qu’il n’y avait plus rien à lire, se leva, fit une révérence à la Compagnie, et s’en alla comme elle était venue... »
Remarque : Lors de son abdication, Voltaire dit en substance qu’elle aimait mieux converser avec des savants que régner sur un peuple uniquement guerrier.
[1] Académicien, auteur de traductions d’auteurs grecs et latins, que leur élégance et leur inexactitude ont fait appeler « les belles infidèles ». Ce terme est resté pour certaine traductions.
[2] La reine vint deux fois en France après son abdication (1654), en 1656 et en 1657-1658. C’est au cours de ce second voyage, en mars 1658, alors qu’elle venait de faire assassiner à Fontainebleau son favori Monaldeschi (!), qu’elle fit cette visite à l’Académie.
[3] L’Académie se réunissait depuis la mort de Richelieu chez le chancelier Séguier, son protecteur.
[4] Sorte de frange très ouvragée.
[5] Séguier.
[6] Le Directeur de l’Académie était Martin Cureau de la Chambre (1594-1669), médecin du roi, académicien, auteur de plusieurs ouvrages de morale : Les Caractères des passions (1640-1662, 5 vol.), L’Art de connaître les hommes (1659-1667).
* * *
Date de dernière mise à jour : 23/04/2020
