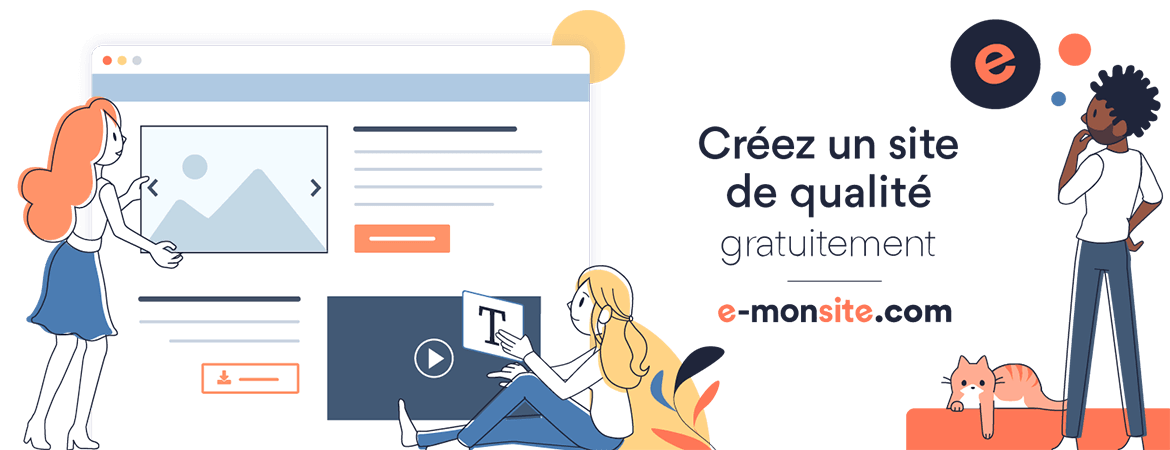Jugements sur Phèdre
1/ Sur l’ensemble de la tragédie
- Contre tous ses adversaires, Phèdre, dès l’origine, a trouvé en Boileau un défenseur enthousiaste. Dans son Épître VII, « A Racine, sur l’utilité des ennemis », il écrit dès 1677 :
« Le Parnasse français, ennobli par ta veine,
Contre tous ces complots saura te maintenir
Et soulever pour toi l’équitable avenir.
Et qui, voyant un jour la douleur vertueuse
De Phèdre, malgré soi, perfide, incestueuse,
D’un si noble travail, justement étonné,
Ne bénira d’abord le siècle fortuné
Qui, rendu plus fameux par tes illustres veilles,
Vit naître sous ta main ces pompeuses merveilles ! »
Boileau, Épître VII (1677)
- Très vite, la renommée de Phèdre s’est établie, et elle ne s’est plus démentie jusqu’à nos jours. Cette pièce reste à nos yeux le modèle même de la tragédie racinienne et de la tragédie classique en général. C’est ce que montre un critique du 20e siècle, Jean Rousset, en y étudiant l’utilisation du temps :
« L’auteur classique ne présente qu’un point de l’action, il l’épure de tout événement. L’auteur baroque présente l‘événement lui-même, c’est-à-dire un développement, une suite de points successifs ; il introduit le temps et par suite l’espace dans son œuvre. Racine élimine le temps, il l’empêche de travailler à l’intérieur de l’œuvre. La passion de Phèdre ne se développe pas, elle éclate ; elle n’a plus à se former ou à mûrir. Elle est parvenue au plus haut degré de maturation ; elle n’a pas non plus à se transformer ou à dépérir, elle ne peut que faire le vide autour d’elle. Le temps n’est pourtant pas absent de la pièce classique, mais il opère antérieurement à la tragédie, il s’accumule sur son seuil. La tragédie racinienne se nourrit de passé, d’un passé monstrueusement amassé et tendu à éclater ; lorsqu’il est sur le point d’éclater, c’est alors que commence la pièce. Ce passé trop lourd, trop riche, déborde dans les aveux, les confidences, les rappels qui ouvrent les premiers actes, où il fait voir bien autre chose que des récits destinés à nous mettre au courant ; c’est ce bassin des années profondes qui se débonde et dont l’énergie est telle qu’elle suffit à donner à toute la pièce son vertigineux mouvement. »
Jean Rousset, La Littérature de l’âge baroque (1954).
2/ Sur Hippolyte et Aricie
- Jusqu’à nos jours, cependant, certains aspects de la tragédie ont fait l’objet de réserves. D’abord et surtout les personnages d’Hippolyte et d’Aricie, et leur intrigue amoureuse. C’est ainsi que Fénelon déclare dans sa Lettre à l’Académie en 1714[1] (Chapitre VI) :
« Racine a fait un double spectacle, en joignent à Phèdre furieuse Hippolyte soupirant, contre son vrai caractère. Il fallait laisser Phèdre toute seule dans sa fureur. L’action aurait été unique, courte, vive et rapide. Mais il a été entraîné par le torrent ; il a cédé au goût des pièces romanesques, qui avaient prévalu. La mode du bel esprit faisait mettre de l’amour partout. »
- Auguste Wilhelm Schlegel, spécialiste allemand du théâtre tragique et esprit volontiers dogmatique, renchérit avec outrance :
« Racine nous donne à la place du véritable Hippolyte, un prince fort bien élevé, fort poli, observant toutes les convenances, rempli de sentiments honnêtes, respectueusement amoureux, mais du reste insignifiant, sans élan et sans originalité. Ses manières et même ses sentiments ne le distinguent en rien des autres princes galants de Racine. »
A. W. Schlegel, Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d’Euripide (1807).
- François Mauriac, quant à lui, rapproche la passion d’Hippolyte de celle de Phèdre : même caractère obsessionnel de l’une et de l’autre, même caractère coupable, aurait-il pu ajouter :
« La face exténuée de Phèdre attire toute la lumière ; à l’entour, des ombres s’agitent. Les mots brûlants d’Hippolyte à Aricie (« Présente je vous fuis, absente, je vous trouve ») se semblent pas lui appartenir, il les a dérobés à Phèdre. »
François Mauriac, Vie de Jean Racine, (1928).
- Aricie de même a longtemps trouvé des censeurs ironiques comme Voltaire :
« Croirait-on qu’on peut, entre une reine incestueuses et un père qui devient parricide, introduire une jeune amoureuse, dédaignant de subjuguer un amant qui ait déjà d’autres maîtresses et mettant sa gloire à triompher de l’austérité d’un homme qui n’a jamais rien aimé ? C’est pourtant ce qu’Aricie ose dire dans le sujet tragique de Phèdre. Mais elle le dit dans des vers si séducteurs, qu’on lui pardonne ces sentiments d’une coquette de comédie. »
Voltaire, Dictionnaire philosophique, article « Style » (1763).
- En revanche, le critique Jean Pommier, la défend vigoureusement :
« Quand la princesse aimée d’Hippolyte est traitée de « petite sotte », quand on lui prête une « candeur » et des « demi-teintes ternes et douceâtres », je me sens d’humeur à écrire une Apologie pour Aricie, pour ce personnage sans passé que Racine n’a pas reçu de la tradition : comment croire qu’à cette neuve argile il n’ait su donner une âme intéressante ? »
Jean Pommier, Aspects de Racine (1954).
3/ Sur le personnage de Phèdre
- Il est certain qu’Hippolyte et Aricie, comme tous les autres personnages de la pièce, pâlissent singulièrement devant Phèdre. Paul Valéry a poussé cette idée jusqu’au bout :
« Tous, moins la reine : le misérable Hippolyte, à peine fracassé sur la rive retentissante, le Théramène aussitôt son rapport déclamé, le Thésée, Aricie, Œnone et Neptune lui-même, l’Invisible, se fondent au plus vite dans leur absence : ils n’ont cessé de faire semblant d’être, n’ayant été que pour servir le principal dessein de l’auteur. Ils ne vivent que le temps d’exciter les ardeurs et les fureurs, les remords et les transes d’une femme. Ils s’emploient à lui faire tirer de son sein racinien les plus nobles accents de concupiscence et de remords que sa passion ait inspirés. Ils ne survivent pas, mais Elle survit. L’œuvre se réduit dans le souvenir à un monologue, et passe en moi de l’état dramatique initial à l’état lyrique pur. »
Paul Valéry, Variétés V (1945).
- Le chant lyrique des tourments de Phèdre est d’autant plus prenant qu’il est varié, complexe, chargé depuis les temps légendaires jusqu’à nos jours d’un poids d’histoire prodigieux :
« Phèdre est à la fois, selon une fine observation de Jules Lemaître, la contemporaine du Minotaure, d’Euripide, de Sénèque, de Racine, la nôtre peut-être : histoire à plusieurs plans, géographie à plusieurs fonds ; la tragédie de Racine nous invite à parcourir le plus long registre d’humanité. »
Pierre Moreau, Racine (1956).
- Ce qui frappe d’abord dans ce personnage, c’est l’intensité extrême qu’y atteint la peinture de la passion :
« L’amour y dépassant une limite respectée jusque-là, sauf dans le cas d’Oreste, tombe nettement dans le morbide. Phèdre, à la lettre, se meurt d’amour. De Vénus nous suivons les œuvres suppliciantes, et l’expression peut s’appliquer à toutes les victimes de Racine. Ce théâtre unique nous offre un groupe, oserais-je le dire, « d’écorchés » psychologiques, où nous pouvons suivre les jeux terribles de la passion, comme les étudient, sur des « écorchés » physiologiques, suivent le jeu des muscles et des tendons. »
Gonzague Truc, Le Cas Racine (1921).
4/ Sur la poésie
- Mais à se laisser fasciner ainsi par le réalisme de la pièce, on risque de n’en plus goûter la poésie profonde :
« Il n’est pas de pièce où Racine ait atteint un plus fort degré de réalisme ; là sa psychologie confine à la physiologie, - et vous conviendrez que les souvenirs de la Crète avec son Labyrinthe, et les allusions à la descente de Thésée aux Enfers, et le monstre incohérent trop bien décrit par Théramène ne parviennent pas à se fondre harmonieusement avec la peinture si hardie d’une passion vraie. »
Charles-Marie des Granges, Histoire de la littérature française (1925).
- Pourtant, la poésie de Phèdre ne suscite d’ordinaire guère de réserves :
« Phèdre a une poésie plus prestigieuse encore : on ne saurait citer tous les vers qui créent, autour de cette dure étude de passion, une sorte d’atmosphère fabuleuse, enveloppant Phèdre de tout un cortège de merveilleuses ou de terribles légendes, et nous donnant la sensation puissante des temps mythologiques. »
Gustave Lanson, Histoire de la littérature française (1898).
- André Gide aussi s’enthousiasme dans son Journal :
« Phèdre, que je relis aussitôt après Iphigénie, reste incomparablement plus belle. Das Phèdre soudain, je sens Racine qui se commet lui-même, se livre et m’engage avec lui. Quels vers ! Quelles suites de vers ! Y eut-il jamais, dans aucune langue humaine, rien de plus beau ? »
André Gide, Journal, 15 février 1934.
- Et l’on ne peut s’empêcher de supposer que Paul Claudel pensait à Phèdre dans ces lignes que rapporte Daniel-Rops :
« Je trouve toujours l’alexandrin assommant, insoutenable ; il me fait penser à une palissade interminable dont l’alternance de vides et de pleins est insoutenable à l’œil. Et cependant je fais plus qu’admettre que l’alexandrin chez Racine, j’y applaudis des deux mains. C’était l’engin adéquat dont il avait besoin. »
Daniel-Rops, Claudel, tel que je l’ai connu (1957).
5/ Sur le récit de Théramène
- Mais le point où la méconnaissance de la poésie racinienne a mis le plus de constance à s’exercer reste le fameux récit de Théramène. Dès 1677, Subligny écrivait :
« Il me semble que la nature même ne veut pas qu’un père qui apprend la mort d’un fils si chéri et qu’il commence à croire innocent, écoute toutes ces descriptions inutiles avec tant de patience et de tranquillité. »
Subligny, Dissertation sur les tragédies de Phèdre et Hippolyte (1677).
- Et, quelques années plus tard, Fénelon lui fait écho :
« Rien n’est moins naturel que la narration de la mort d’Hippolyte à la fin de la tragédie de Phèdre. Théramène, qui vient pour apprendre à Thésée le mort funeste de son fils, devrai ne dire que ces deux mots et manquer même de force pour les prononcer distinctement : « Hippolyte est mort. Un monstre envoyé du fond de la mer par la colère des dieux l’a fait périr. Je l’ai vu. » Un tel homme, saisi, éperdu, sans haleine, peut-il s’amuser à faire la description la plus pompeuse et la plus fleurie de la figure du dragon ? »
Fénelon, Lettre à l’Académie (1714).
La polémique se poursuit.
- Dumarsais (Des tropes)
« L’hypotypose est un mot grec qui signifie image, tableau. C’est lorsque, dans les descriptions, on peint les faits dont on parle comme si ce qu’on dit était actuellement devant les yeux : on montre, pour ainsi dire, ce qu’on ne fait que raconter ; on donne en quelque sorte l’original pour la copie, les objets pour des tableaux. Vous trouverez un bel exemple dans le récit de la mort d’Hippolyte :
Extrait
« ... Cependant, sur le dos de la plaine liquide,
S’élève à gros bouillons une montagne humide ;
L’onde approche, se brise, et vomit à nos yeux,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.
Son front large est armé de cornes menaçantes ;
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes ;
Indomptable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux.
Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage,
La terre s’en émeut, l’air en est infecté ;
Le flot qui l’apporta recule épouvanté... »
Ce dernier vers a paru affecté ; on a dit que les flots de la mer allaient et venaient sans le motif de l’épouvante, et que, dans une occasion aussi triste que celle de la mort d’un fils, il ne convenait point de badiner avec une fiction aussi peu naturelle. »
- La Motte (Discours sur la poésie)
« Les poètes tragiques même qui s’abandonnent quelquefois à l’enflure, doivent toujours être en garde contre l’excès de l’expression [...] Racine n’a presque jamais passé ces bornes, que dans quelques descriptions où il a affecté d’être poète : comme dans celle de la mort d’Hippolyte, où l’on croit plutôt entendre l’auteur que le personnage qu’il fait parler. Corneille sort aussi quelquefois de cette vraisemblance [...] Ce vers de Racine, Le flot qui l’apporta recule épouvanté, est excessif dans la bouche de Théramène. On est choqué de voir un homme accable de douleur, si recherché dans se termes, et si attentif à sa description. Mais ce même vers serait beau dans une ode, parce que c’est le poète qui y parle, qu’il y fait profession de peindre, qu’on ne lui suppose point de passion violente qui partage son attention , et qu’on sent bien enfin, quand il se sert d’une expression outrée, qu’il le fait à dessein, pour suppléer par l’exagération de l’image, à l’absence de la chose même. »
- Boileau (Réflexion critiques) est un des rares à défendre Racine.
« Monsieur de La Motte, mon confrère à l’Académie française, n’a donc pas raison en son Traité de l’Ode, lorsqu’il accuse l’illustre monsieur Racine de s’être exprimé avec trop de hardiesse dans sa tragédie de Phèdre, où le gouverneur d’Hippolyte, faisant la peinture du monstre effroyable que Neptune avait envoyé pour effrayer les chevaux de ce jeune et malheureux prince, se sert de cette hyperbole Le flot qui l’apporta recule épouvanté puisqu’il n’y a personne qui ne soit obligé de tomber d’accord que cette hyperbole passerait même dans la prose, à la faveur d’un pour ainsi dire, ou d’un si j’ose ainsi parler. [...] Monsieur Racine a entièrement cause gagnée : pouvait-il employer la hardiesse de sa métaphore dans une circonstance plus considérable et plus sublime que dans l’effroyable arrivée de ce monstre, ni au milieu d’une passion plus vive que celle qu’il donne à cet infortuné gouverneur d’Hippolyte, qu’il représente plein d‘une horreur et d’une consternation que, par son récit, il communique en quelque sorte aux spectateurs mêmes, de sorte que, par l’émotion qu’il leur cause, il ne les laisse pas en état de songer à le chicaner sur l’audace des figures ? Aussi a-t-on remarqué que toutes les fois qu’on joue la tragédie de Phèdre, bien loin qu’on paraisse choqué de ce vers, Le flot qui l’apporta recule épouvanté, on y fait une espèce d’exclamation ; marque incontestable qu’il y a là du vrai sublime. »
- Voltaire, mais pour des raisons que nous ne partagerions peut-être pas volontiers, a pris résolument la défense de ce morceau célèbre :
« Qui voudrait même qu’on en retranchât quatre vers ? Ce n’est pas là une vaine description d’une tempête inutile à la pièce ; ce n’est pas là une amplification mal écrite ; c’est la diction la plus pure et la plus touchante ; enfin, c’est Racine. »
6/ Sur la signification de l’œuvre
- Laissons toutefois de côté cette tirade, qui reste comme un défi permanent à l’acteur et au lecteur, pour les obliger à poser et à résoudre le problème du réalisme poétique de la tragédie racinienne. Venons-en à l’essentiel : quelle est la signification profonde de cette pièce ? Qu’a voulu faire Racine ? Une fois encore, c’est au personnage de Phèdre qu’il nous faut revenir ; païenne ou chrétienne ? La question a été bien souvent posée. Chateaubriand, le premier, y a fait une réponse vigoureuse :
« Le cri le plus énergique que la passion ait jamais fait entendre est peut-être celui-ci : « Hélas ! du crime affreux dont la honte me suit / Jamais mon triste cœur n’a recueilli le fruit. » Il y a là-dedans un mélange des sens et de l’âme, de désespoir et de fureur amoureuse, qui passe toute expression. Cette femme qui se consolerait d’une éternité de souffrances, si elle avait joui d’un instant de bonheur, cette femme n’est pas dans le caractère antique ; c’est la chrétienne réprouvée, c’est la pécheresse tombée vivante dans les mains de Dieu ; son mal est celui du damné. »
Chateaubriand, Génie du christianisme (1802).
- Lemaître arrive à la même conclusion :
« Quelle œuvre singulière que Phèdre, quand on y regarde d’un peu près ! La femme de Thésée est sans doute une malade, en proie à l’une de ces passions inéluctables qui troublent la raison, oppriment la volonté et vous coulent leur poison jusqu’aux moelles. Mais Phèdre est aussi une conscience infiniment tendre et délicate ; Phèdre est une chrétienne qui connaît très bien qu’elle perd son âme ; elle sent le prix de cette chasteté qu’elle offense ; elle est torturée de remords ; elle a peur des jugements de Dieu ; elle a peur de l’enfer. Victime d’une fatalité qu’elle porte dans son corps ardent et dans le sang de ses veines, pas un instant elle ne consent au crime. Le poète s’est appliqué à accumuler en sa faveur les circonstances atténuantes. Elle ne laisse deviner sa passion à Hippolyte que lorsque la nouvelle de la mort de Thésée a ôté à cet amour son caractère criminel ; et cet aveu lui échappe dans un accès de délire halluciné. Plus tard, c’est la nourrice qui accuse Hippolyte ; Phèdre la laisse faire, mais elle n’a plus sa tête et ne respire qu’à peine. Pourtant elle allait se dénoncer, lorsqu’elle apprend qu’elle avait une rivale ; et sa raison part de nouveau. Enfin, elle se punit en buvant du poison et vient, avant de mourir, se confesser publiquement ; et le mot sur lequel son dernier soupir s’exhale est celui de « pureté ».
Jules Lemaître, Impressions de théâtre, Première série (17 mai 1886).
- Et dans le même sens, enfin, François Mauriac va plus loin encore. Non seulement Phèdre est chrétienne, mais elles apparient au christianisme le plus terrible, à celui des rudes maîtres du jeune Racine : le jansénisme :
« Nous aimons Phèdre pour ses moments d’humilité. Elly ne se défend pas ; elle connaît son opprobre ; l’étale aux pieds mêmes d’Hippolyte. L’excès de sa misère nous apparait surtout lorsque lui ayant décrit son triste corps qui a langui, qui a séché dans les feux, dans les larmes, elle ne peut se retenir de crier à l’être qui est sa vie (rien de plus déchirant n’est jamais sorti d’une bouche humaine[1]) : « Il suffit de tes yeux pour t’en persuader, / Si tes yeux un moment pouvaient me regarder. » Prodigieuse lucidité. Où cette nouvelle Hermione, cette dernière incarnation de Roxane, a-t-elle appris à se connaître ? Hermione n’erre plus en aveugle dans le palais de Pyrrhus. Roxane est sortie du sérail obscur. Sous les traits de Phèdre, elles entrent en pleine lumière et soutiennent en frémissant la vue du soleil sacré. « Il faut aller jusqu’à l’horreur quand on se connaît », écrit Bossuet au maréchal de Bellefonds. Phèdre va jusqu’à cette horreur. Elle est fille des dieux, fille du ciel ; elle le sait, de cette même science qui était celle de Racine dans le temps où il l’a mise au monde. Lui aussi, dès qu’il a commencé de balbutier, ce fut pour adorer le Père qui est au ciel ; et à travers tous les désordres où sa jeunesse l’engagea, il ne perdit point le souvenir de son affiliation divine. Dans le pire abaissement, le chrétien se connaît comme le fils de Dieu.
Mais Phèdre ignore le Dieu qui nous aime d’un amour infini. Son cœur malade ne peut se tourner vers ce juge dont elle n’attend rien qu’un supplice nouveau propre à châtier son crime. Aucune goutte de sang n’a été versée pour cette âme. Elle est de ces misérables que les maîtres du petit Racine frustrent sereinement du bénéfice de la Rédemption. Ils avaient une pire croyance : ils ne doutaient pas que le Dieu tout-puissant ait voulu aveugler et perdre telles de ses créatures. Leur Divinité rejoignait le fatum : un Destin qui ne serait pas aveugle, terriblement attentif au contraire à la perte des âmes réprouvées dès avant leur naissance.
François Mauriac, La Vie de Jean Racine (1928).
- Après ces positions extrêmes, c’est un rappel à la modération et à la prudence que nous donne Jean Pommier :
« Il semble qu’on ait oublié la prudence, quand on a, pendant si longtemps, expliqué Phèdre par le jansénisme de son auteur. Non seulement les passages cités à l’appui viennent le plus souvent de l’Antiquité, mais on ne peut même dire que cette imitation suppose et dénonce des affinités significatives. Rien de plus commun chez les écrivains contemporains de Racine qu’une faute commise malgré soi. Au point qu’on se demande, en rapprochant Phèdre de ce canon de l’époque, si Racine ne s’est pas plus éloigné de soi dans cette création que dans d’autres, celle d’une Roxane par exemple. On résisterait moins à l’évidence si cette pièce, née presque au zénith de la maturité, on ne la colorait des rayons du couchant. Que Racine soit mort après Phèdre, à qui l’idée viendrait-elle de rattacher à l’enseignement de Port-Royal celle de ses tragédies qui, à certains égards, est la plus païenne de toutes ?
Jean Pommier, Aspects de Racine (1954).
- Moins polémique et paradoxal, Sainte-Beuve se contente de poser en des termes philosophiques généraux le problème toujours vivant de Phèdre, celui de la liberté :
« L’expression de l’antique fatalité dans cette pièce se rapproche déjà bien sensiblement de celle qu’admet un rigoureux christianisme. La faiblesse et l’entraînement de notre misérable nature n’ont jamais été mis plus à nu. Il y a déjà, si l’on ose dire, un commencement de vérité religieuse dans une vérité humaine si profondément révélée, si vivement arrachée de ses ténèbres mythologiques. La doctrine de la grâce se sent toute voisine de là ; notre volonté même et nos conseils sont à la merci de Dieu ; nous sommes libres, nous le sentons, et nous croyons l’être, et portant il y a nombre de cas où nous sommes poussés : terrible mystère ! Phèdre, avec sa douleur vertueuse, pourrait être ajoutée dans le traité du Libre arbitre de Bossuet comme preuve que souvent on agit contre son désir, qu’on désire contre sa volonté qu’on veut malgré soi : « Que dis-je ? Cet aveu que je viens de faire, / Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ? »
Sainte-Beuve, Port-Royal, tome VI, (1859).
- Et c’est cette même idée que, plus près de nous, développe Antoine Adam dans son Histoire de la littérature française au 17e siècle :
« Certains ont voulu faire de Phèdre une tragédie chrétienne. Mais il fallait être Chateaubriand pour voir dans la fille de Pasiphaé une âme façonnée par le christianisme. Ce n’est pas la grâce seulement qui a manqué à cette femme malheureuse. Les dieux, les dieux cruels ont voulu son crime et sa damnation : « Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle / De séduire le cœur d’une simple mortelle... ».
Tragédie janséniste, dirait-on plutôt. Mais le plus pessimiste des augustiniens aurait-il osé pousser si loin l’image d’une divinité acharnée à la perte de ses créatures ? Et n’est-il pas significatif que de tous les vers de la tragédie, ceux qui pourraient nous paraître les plus visiblement inspirés par le jansénisme soient précisément la traduction d’un développement de Sénèque ?
Certes, nous comprenons bien que Racine n’a pas davantage voulu restituer, avec une exactitude d’historien, la théologie des anciens Grecs. Jules Lemaître a dit avec raison : « Ce n’est pas vers Minos qu’elle crie. » Mais il a eu tort d’ajouter que c’était donc vers le Dieu de Racine. Car le Dieu qui fait peser la terreur sur le palais de Trézène, ce n’est pas celui de la théodicée catholique. C’est le nom que nous donnons à cette présence en nous d’une force qui nous est étrangère, qui nous dépasse, et nos accable. Ce sont les servitudes de l’hérédité, c’est le poids de nos ancêtres qui continuent de vivre en nous et nous dictent notre conduite, de ces « revenants » dont Ibsen a dit, dans un chef-d’œuvre, l’obscure tyrannie. Ce sang qui coule dans nos veines, nous ne nous le sommes pas donné. Ces impulsions qui nous font agir, nous y obéissons sans les connaître. Cette découverte de l’inhumain qui est en l’homme, c’est la découverte du tragique. C’est elle, et non pas une orthodoxie religieuse, qui donne son sens au chef-d’œuvre.
- Que sa propre expérience de la vie a guidé Racine vers ces sommets de l’art tragique, Antoine Adam le réaffirme contre tous les paradoxes « à la Giraudoux ». Phèdre est faite de la chair de Racine :
« Racine avait, en écrivant Phèdre, retrouvé l’esprit de la tragédie antique. Il avait retrouvé le tragique. De cette découverte, il n’est pas douteux qu’une expérience personnelle ait été la condition nécessaire, et l’on admire ces critiques qui ne veulent voir dans sa pièce qu’une abstraite création de l’art, Racine a vu le gouffre où certaines vies risquent de s’enfoncer, et il n’a pu le voir qu’en lui-même. Déjà Britannicus et Bajazet avaient laissé deviner une connaissance intime et terrifiante du péché. Elle éclate dans Phèdre avec toute sa force.
Mais à cette expérience, Racine a su donner dans Phèdre une expression qui nous bouleverse parce qu’il en a dégagé la valeur universelle, si bien que sa pièce, ce n’est pas son propre drame, mais le drame de l’humanité aux prises avec les puissances du mal. Cette Phèdre dont les genoux se dérobent, et qui s’avance comme une somnambule, c’est le poids de notre destin qu’elle porte et qui l’écrase.
- Enfin, le même critique, dans les lignes suivantes tirées du même ouvrage, esquisse, à partir du texte même et de ce sens qu’il a pour nous, ce que pourrait être de nos jours une mise en scène de Phèdre :
« Si nous voulons sentir dans toute sa beauté ce chef-d’œuvre le pus admirable de Racine et sans doute de toute notre littérature, nous devons le représenter tel que le poète l’a conçu. Tout effort pour en accentuer l’aspect de vérité crue et brutale, le défigure, comme aussi bien le déformerait une interprétation qui n’y voudrait reconnaître qu’une œuvre de pure poésie. Nous n’avons même pas le droit d’ignorer les trop rares indications qui nous sont parvenues sur la plus ancienne mise en scène. « Théâtre est un palais voûté », note le décorateur de l’Hôtel de Bourgogne, et l’indication éclaire un vers de la tragédie : « Il me semble déjà que ces murs, que ces voûtes... »
On devine une atmosphère de silence lourd, le poids des masses du vieux palais, une lumière qui n’y pénètre qu’avec peine et qui éclairera que peu à peu les personnages du drame sacré. C’est dans cette pénombre hostile que s’élèvent leurs voix. Ils récitent plutôt qu’ils ne disent leurs aveux et leurs terreurs. Leur débit lent, leur accent monotone font penser à un culte rendu aux dieux infernaux. »
Antoine Adam, Histoire de la littérature française au 17e siècle, tome IV, (1954)
* * *
Date de dernière mise à jour : 30/04/2021