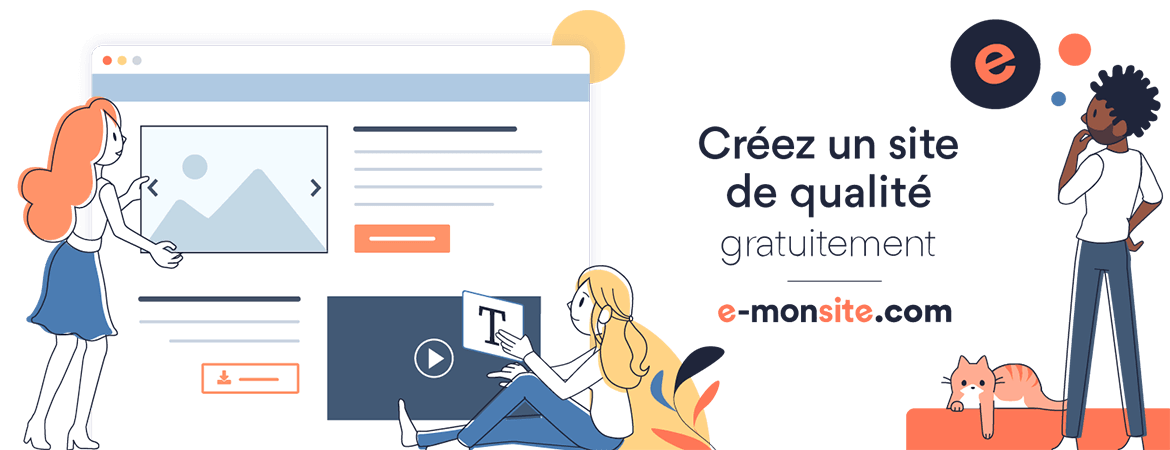Intérêt de Phèdre
Outre ses qualités formelles, Phèdre, parmi les autres pièces se Racine, présente un intérêt particulier à deux points de vue : pour la connaissance de l’auteur d’abord, pour l’importance du problème métaphysique et moral ensuite.
1/ Phèdre et Racine
Depuis le succès d’Andromaque, en dix ans, Racine a produit avec une régularité parfaite huit chefs-d’œuvre la pièce de Phèdre arrive au terme de cette longue et triomphale série. Pourtant, après Phèdre, Racine abandonne définitivement le théâtre. Quand il y reviendra, treize ans plus tard pour Esther, c’est dans des conditions et pour des raisons si particulières qu’on peut voir en Phèdre la dernière pièce de Racine, d’un certain Racine au moins. Abandon du théâtre, réconciliation avec Port-Royal et avec Dieu, retour par le mariage à une vie régulière les bouleversements dans la vie de Racine sont à cette époque si importants qu’ils nous imposent de chercher si Phèdre déjà ne les préparait ou même ne les expliquait pas. La thèse contraire a été soutenue avec rigueur. Il est certain que l’on peut trouver dans les tragédies antérieures de Racine, et surtout dans les sources latines et grecques de Phèdre, la raison de tout ce qui paraît être nouveau dans cette pièce. Mais, très vite, c’est au personnage de l’héroïne que se réduit le problème. De quelle nature est la fatalité qui accable Phèdre ? Le fatum antique ne recouvre-t-il pas la prédestination janséniste ? Phèdre est-elle païenne ou chrétienne ?
Il faut d’abord considérer que la réconciliation de Racine avec Port-Royal ne s’est pas faite aussi brusquement qu’on l’a dit souvent, mais par étapes, qu’au moment où Phèdre est écrite, c’est pratiquement chose faite depuis deux ou trois ans. Phèdre, plus que la dernière pièce de Racine, avant sa conversion serait donc bien plutôt la première pièce de Racine sur le chemin du retour total à Dieu[1]. Voilà pourquoi l’atmosphère de Phèdre est beaucoup plus religieuse que celle des pièces précédentes. Mais il y a plus : Racine lui-même, dans sa Préface, souligne ce que sa pièce a d’exceptionnel : « Je n’en ai point fait où la vertu soit plus mise en jour que dans celle-ci [...] Les faiblesses de l’amour y passent pour de vraies faiblesses [...] ; et le vice y est peint partout avec des couleurs qui en font connaître et haïr la difformité. C’est peut-être un moyen de réconcilier la tragédie avec quantité de personnes célèbres par leur piété et par leur doctrine [...] ». Dans cette dernière phrase, l’allusion est claire : c‘est avec Port-Royal que Racine veut se réconcilier, et il présente ouvertement Phèdre comme un premier pas fait par lui dans cette direction. Sans doute dut-on le juger insuffisant, puisqu’il fallut que Racine abandonnât tout à fait le théâtre, mais le désir de revenir à ses anciens maîtres est manifeste, et il est dès lors tout à fait normal que Phèdre en porte les marques.
Le fait le plus notable est d’abord la présence constante des dieux. L’attribuer à la couleur locale, à l’atmosphère antique dans laquelle Racine se serait plus profondément plongé paraît insuffisant. Car la question est justement de savoir pourquoi à ce moment-là plus qu’à un autre il découvre le divin chez les auteurs anciens. Il y avait autant de dieux dans la légende d’Oreste ou de sa sœur sacrifiée. Pourquoi, dans Andromaque et dans Iphigénie, sont-ils si effacés ? C’est qu’en 1676, la personnalité de Racine s’est déjà profondément modifiée. Hermione et Pyrrhus se déchiraient sous un ciel vide, dans un monde sans dieux, malgré les quelques vers d’Oreste sur la force du destin ; quoi de plus païen aussi que le monde de Britannicus et de Mithridate ? Et quelle atmosphère plus religieuse, en revanche, que celle de Phèdre, où deux puissances divines opposées – le bien et le mal – se disputent l’héroïne ? Que les marques multiples de ces forces, que tous les noms des dieux de la mythologie ne nous leurrent pas : jamais Racine n’avait écrit de pièce moins païenne, au sens moderne du mot.
Le personnage de Phèdre nous en donne une preuve supplémentaire. Il y a chez elle un sens aigu de la faute. Il est sans doute lié à la nature de son amour, mais pourquoi le dernier grand amour profane décrit par Racine est-il justement un désir incestueux ? Pourquoi a-t-il choisi ce sujet ? Et, si Phèdre évalue aussi pleinement sa faute, c’est avant tout parce que, comme un instinct irrépressible, vit en elle une conscience morale que Racine n’avait donnée ni à Hermione ni à Roxane. À tel point que les vers 1291-1292 mis à part (et ils n’en sont que plus bouleversants de vérité), partout ailleurs Phèdre manifeste un repentir de sa faute qui fait d’elle une chrétienne digne du pardon : une véritable chrétienne car sa conscience morale n’a pas pour point d’appui un idéal humain ; le vocabulaire qu’elle emploie est net ; ce sont les mots souillure, innocence, pureté qui reviennent sans cesse (voir le vers 1238). Seul son suicide final la rejette en apparence hors de l’univers religieux. Encore faut-il considérer que justement dans ce monde antique, Phèdre ne peut avoir aucun espoir de renaître par la grâce d’un rédempteur ; c’est une chrétienne d’avant le Christ : et peut-être Racine, lui non plus, ne l’avait-il pas encore trouvé lorsqu’il écrivait sa pièce. De toute façon, même dans son suicide, Phèdre reste émouvante et digne d’être sauvée.
Phèdre est donc pour Racine une étape essentielle. Non tant à cause de la cabale, incident extérieur qui n’a pu jouer un rôle décisif dans le changement de Racine, mais parce que le texte même de la pièce manifeste une évolution profonde de son univers. Sa conversion est proche.
2/ Phèdre et nous
Pour nous, Phèdre au-delà de la réussite des vers, de la construction dramatique et de l’étude psychologique, pose avec force, comme les grandes tragédies, le problème fondamental de l’homme : celui de sa liberté. L’héroïne est tout entière agie par des puissances obscures ; elle est quasiment déterminée. Que ce soit par les dieux, que ce soit par son hérédité, ou que les premiers utilisent la seconde, le résultat est le même : il lui est impossible d’échapper au « monstre », à sa faute. Et pourtant, tout en le sachant, jusqu’au bout, elle ne cesse, en se proclamant coupable, de se sentir responsable, de croire à sa liberté : das le désastre total, la suprême affirmation de cette liberté, elle la verra dans son suicide. C’est, si l’on veut, le problème de la prédestination au 17e siècle, mais c’est aussi celui du déterminisme au 19e siècle, chez Zola par exemple. Qu’elle soit d’ordre spirituel ou matériel, s’il y a une force donnée, antérieure, qui explique l’homme, où donc est sa liberté ? Elle est, - au milieu de la plus grande honte, Phèdre nous le crie – dans le sentiment même que nous en avons, et ce n’est pas la plus mauvaise des réponses qu’on ait faites.