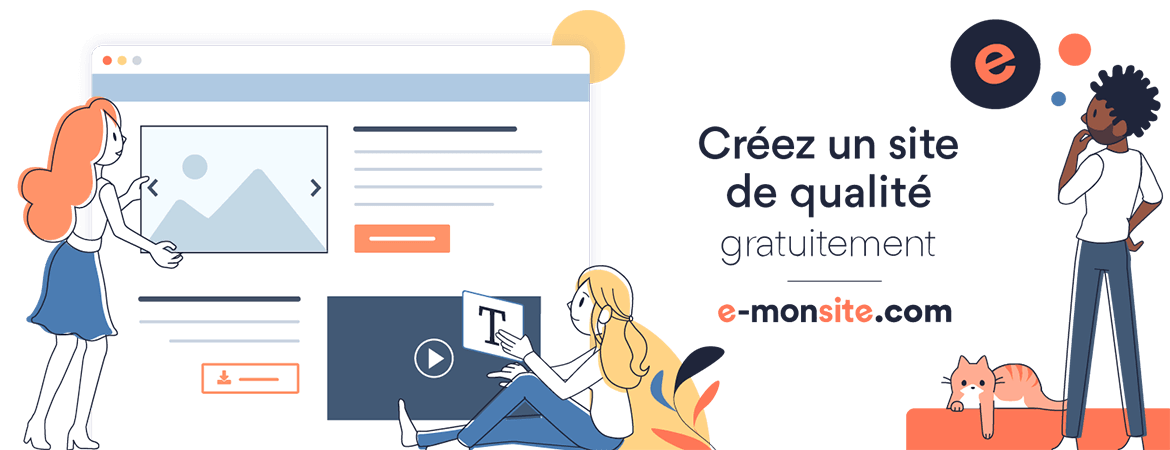Examen de Polyeucte par Corneille (1660)
I. Les données historiques
Les titres des chapitres ne sont pas de Corneille mais ont été ajoutés ici pour la commodité du lecteur.
« Ce martyre est rapporté par Surius sur[1] le 9e de janvier. Polyeucte vivait en l’année 250, sous l’empereur Décius. Il était Arménien, ami de Néarque, et gendre de Félix, qui avait la commission de l’Empereur pour faire exécuter ses édits contre les chrétiens. Cet ami l’ayant résolu à se faire chrétien il déchira ces édits qu’on publiait, arracha les idoles des mains de ceux qui les portaient sur les autels pour les adorer, les brisa contre terre, résista aux larmes de sa femme Pauline, que Félix employa auprès de lui pour le ramener à leur culte, et perdit la vie par l’ordre de son beau-père, sans autre baptême que celui de son sang. Voilà ce que m’a prêté l’histoire ; le reste est de mon invention.
[1] A la date du.
II. Altérations apportées à l’histoire par Corneille
Pour donner plus de dignité à l’action, j’ai fait Félix gouverneur d’Arménie, et ai pratiqué un sacrifice public, afin de rendre l’occasion plus illustre, et donner un prétexte à Sévère de venir en cette province, sans faire éclater son amour avant qu’il n’en eût l’aveu de Pauline. Ceux qui veulent arrêter nos héros dans une médiocre bonté, où quelques interprètes d’Aristote bornent leur vertu, ne trouveront pas ici leur compte, puisque celle de Polyeucte va jusqu’à la sainteté, et n’a aucun mélange de faiblesse. J’en ai déjà parlé ailleurs[1] ; et, pour confirmer ce que j’en ai dit par quelques autorités, j’ajouterai ici que Minturnus, dans son Traité du Poète[2], agite cette question, si [3]la Passion de Jésus-Christ et les martyres des saints doivent être exclus du théâtre, à cause qu’ils passent[4] cette médiocre bonté, et résout en ma faveur. Le célèbre Heinsius[5], qui non seulement a traduit la Poétique de notre philosophe[6], mais a fait un Traité de la constitution de la tragédie selon sa pensée, nous en a donné une sur le martyre des Innocents. L’illustre Grotius[7] a mis sur la scène la Passion même de Jésus-Christ et l »histoire de Joseph ; et le savant Buchanan[8] a fait la même chose de celle de Jephté et de la mort de saint Jean-Baptiste. C’est sur ces exemples que j’ai hasardé ce poète, où je me suis donné des licences qu’ils n’ont pas prises, de changer l’histoire en quelque chose, e d’y mêler es épisodes d’invention : aussi m’était-il plus permis sur cette matière qu’à eux sur celle qu’ils ont choisie. Nous ne devons qu’une croyance pieuse à la vie des saints, et nous avons le même droit sur ce que nous en tirons pour le porter sur le théâtre, que sur ce que nous empruntons des autres histoires ; mais nous devons une foi chrétienne et indispensable à tout ce qui est dans la Bible, qui ne nous laisse aucune liberté d’y rien changer. J’estime toutefois qu’il ne nous est pas défendu d’y ajouter quelque chose, pourvu qu’il[9] ne détruise rien de ces vérités dictées par le Saint-Esprit. Buchanan ni Grotius ne l’ont pas fait dans leurs poèmes ; mais aussi ne les ont-ils pas rendus assez fournis pour notre théâtre, et ne s’y sont proposé pour exemple que la constitution la plus simple des anciens. Heinsius a plus osé qu’eux dans celui que j’ai nommé : les anges qui bercent l’enfant Jésus, et l’ombre de Marianne avec les furies qui agitent l’esprit d’Hérode, sont des agréments qu’il n’a pas sur le théâtre, pourvu qu’on ne mette rien en la place ; car alors ce serait changer l’histoire, ce que le respect que nous devons à l’Écriture ne permet point. Si j’avais à y exposer celle de David et de Bersabée[10], je ne décrirais pas comme il en devint amoureux en la voyant se baigner dans une fontaine, de peur que l’image de cette nudité ne fît une impression trop chatouilleuse dans l’esprit de l’auditeur ; mais je me contenterais de le peindre avec de l’amour pour elle, sans parler aucunement de quelle manière cet amour se serait emparé de son cœur.
[1] Dans le Discours de la tragédie : « l’exclusion des personnes tout à fait vertueuses qui tombent das le malheur, bannit les martyrs de notre théâtre : Polyeucte y a réussi contre cette maxime. »
[2] Publié à Venise en 1559.
[3] À savoir si.
[4] Dépassent.
[5] Érudit hollandais (1580-1665).
[6] Aristote.
[7] Érudit hollandais (1583-1645), auteur d’un grand nombre d’ouvrages théologiques, historiques, politiques, juridiques, et de plusieurs tragédies en latin.
[8] Poète et historien écossais (1506-1582) qui fut à Bordeaux l’un des maîtres de Montaigne.
[9] Il neutre, se rapportant à quelque chose.
[10] Ou Bethsabée.
III. Succès, style et composition de la pièce
Je reviens à Polyeucte, dont le succès a été très heureux. Le style n’en est pas si fort ni si majestueux que celui de Cinna et de Pompée[1], mais il y a quelque chose de plus touchant, et les tendresses de l’amour humain y font un si agréable mélange avec la fermeté du divin, que sa représentation a satisfait tout ensemble les dévots et les gens du monde. À mon gré, je n’ai point fait de pièce où l’ordre du théâtre soit plus beau et l’enchaînement des scènes mieux ménagé. L’unité d’action, et celles du jour et du lieu, y ont leur justesse ; et les scrupules qui peuvent naître touchant ces deux dernières se dissiperont aisément, pour peu qu’on me veuille prêter de cette faveur que l’auditeur nous doit toujours, quand l’occasion s’en offre, en reconnaissance de la peine que nous avons prise à le divertir.
[1] L’Examen de Polyeucte est de 1660, postérieur à la tragédie de Pompée (1644).
IV. L’unité de temps
Il est hors de doute que si nous appliquons ce poème à nos coutumes, le sacrifice se fait trop tôt après la venue de Sévère ; et cette précipitation sortira du vraisemblable par[1] la nécessité d’obéir à la règle. Quand le roi envoie ses ordres dans les villes pour y faire rendre des actions de grâces pour ses victoires, ou pour d’autres bénédictions qu’il reçoit du ciel, on ne les exécute pas dès le jour même ; mais aussi il faut du temps pour assembler le clergé, les magistrats et les corps de ville, et c’est ce qui en fait différer l’exécution. Nos acteurs n’avaient ici aucune de ces assemblées à faire.
Il suffisait de la présence de Sévère et de Félix, et du ministère du grand prêtre ; ainsi nous n’avons eu aucun besoin de remettre ce sacrifice en un autre jour. D’ailleurs, comme Félix craignait ce favori, qu’il croyait irrité du mariage de sa fille, il était bien aise de lui donner le moins d’occasion de tarder qu’il lui était possible, et de tâcher, durant son peu de séjour, à[2]son esprit par une prompte complaisance, et montrer tout ensemble une impatience d’obéir aux volontés de l’Empereur.
V. L’unité de lieu
L’autre scrupule regarde l’unité de lieu, qui est assez exacte, puisque tout s’y passe dans une salle ou antichambre commune aux appartements de Félix et de sa fille. Il semble que la bienséance y soit un peu forcée pour conserver cette unité au second acte en ce que Pauline vient jusque dans cette antichambre pour trouver Sévère, dont elle devrait attendre la visite dans son cabinet[1]. A qui je réponds qu’elle a eu deux raisons de venir au-devant de lui : l’une, pour aire plus d’honneur à un homme dont son père redoutait l’indignation, et qu’il lui avait commandé d’adoucir en a faveur ; l’autre, pour rompre aisément la conversation avec lui, en se retirant dans ce cabinet, s’il ne voulait pas la quitter à sa prière, et se délivrer, par cette retraite, d’un entretien dangereux pour elles, ce qu’elle n’eût pu faire, si elle eût reçu sa visite dans son appartement.
[1] « Lieu le plus retiré du Palais » (Académie) et aussi : « Petit lieu retiré où l’on étudie et où l’on serre ce que l’on a de plus précieux. » (Furetière).
VI. La confidence de Pauline avec Stratonice
Sa confidence avec Stratonice, touchant l’amour qu’elle avait eu pour ce cavalier me fait faire une réflexion sur le temps qu’elle prend pour cela. Il s’en fait beaucoup sur nos théâtres, d’affections qui ont déjà duré deux ou trois ans, dont on attend à révéler le secret jusqu’au jour de l’action qui se présente, et non seulement sans aucune raison de choisir ce jour-là plutôt qu’un autre pour le déclarer, mais lors même que vraisemblablement on s’en est dû ouvrir beaucoup auparavant avec la personne à qui on en fait confidence. Ce sont choses dont il faut instruire le spectateur en les faisant apprendre par un des acteurs à l’autre ; mais il faut prendre garde avec soin que celui à qui on les apprend ait eu lieu de les ignorer jusque-là aussi bien que le spectateur, et que quelque occasion tirée du sujet oblige celui qui les récite à rompre enfin un silence qu’il a gardé longtemps. L’infante, dans le Cid, avoue à Léonor l’amour secret qu’elle a pour lui, et l’aurait pu faire un an ou six mois plus tôt. Cléopâtre, dans Pompée, ne prend pas des mesures plus justes avec Charmion ; elle lui conte la passion de César pour elle, et comme « Chaque jour ses courriers / Lui portent en tribut ses vœux et ses lauriers. »
Cependant, comme il ne paraît personne avec qui elle ait plus d’ouverture de cœur qu’avec cette Charmion, il y a grande apparence que c’était elle-même dont cette reine se servait pour introduire ces courriers, et qu’ainsi elle devait savoir déjà tout ce commerce entre César et sa maîtresse. Du moins il fallait marquer quelque raison qui lui eût laissé ignorer jusque-là tout ce qu’elle lui apprend, et de quel autre ministère cette princesse s’était servie pour recevoir ces courriers. Il n’en va pas de même ici. Pauline ne s’ouvre avec Stratonice que pour lui faire entendre le songe qui la trouble, et les sujets qu’elle a de s’en alarmer ; et comme elle n’a fait ce songe que la nui d’auparavant, et qu’elle ne lui eût jamais révélé son secret sans cette occasion qui l’y oblige, on peut dire qu’elle n’a point eu lieu de lui faire cette confidence plus tôt qu’elle ne l’a faite.
VII. La mort de Polyeucte
Je n’ai point fait de narration de la mort de Polyeucte parce que je n’avais personne pour la faire ni pour l’écouter, que des païens qui ne la pouvaient écouter, ni faire, que comme ils avaient fait et écouté celle de Néarque, ce qui aurait été une répétition et marque de stérilité, et en outre n’aurait pas répondu à la dignité de l’action principale, qui est terminée par là. Ainsi j’ai mieux aimé la faire connaître par un sait emportement de Pauline, que cette mot a convertie, que par un récit qui n’eût point eu de grâce dans une bouche indigne de le prononcer. Félix son père se convertit après elle ; et ces deux conversions, quoique miraculeuses, sont si ordinaires, dans les martyres, qu’elles ne sortent point de la vraisemblance parce qu’elles ne sont pas de ces événements rares et singuliers qu’on ne peut tirer en exemple; et elles servent à mettre le calme dans les esprits de Félix, de Sévère et de Pauline, que sans cela j’aurais eu bien de la peine à retirer du théâtre dans un état qui rendît la pièce complète, en ne laissant rien à souhaiter à la curiosité de l’auditeur. »
* * *