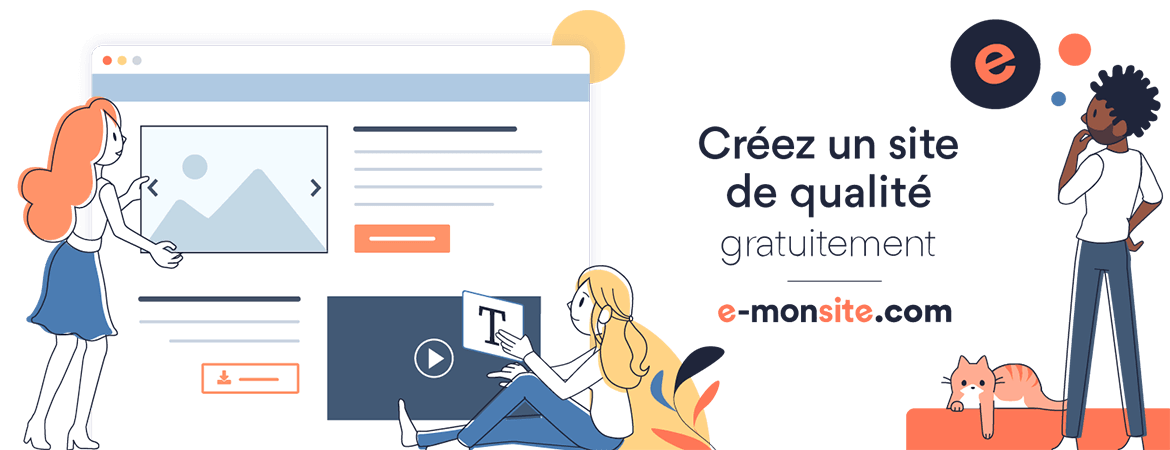Mme de Sévigné et l'hagiographie
Cours de Lanson sur Mme de Sévigné et ses Lettres
 Note préliminaire
Note préliminaire
Cette introduction, la même que pour Mme de La Fayette, n’est pas un doublon involontaire : on peut s’intéresser à Mme de Sévigné et ignorer Mme de La Fayette ou le contraire. Il s’agit pour moi de faire clairement comprendre au lecteur mes objectifs.
En 1894, Gustave Lanson publie son Histoire de la littérature française, qui fait longtemps référence pour ce qui est de la critique littéraire. Misogyne – et en accord avec l’esprit du siècle -, il méprise les femmes et ne leur accorde qu’une place limitée. Dans son ouvrage plus synthétique de 1929 (écrit en collaboration avec P. Tuffrau), Manuel illustré d’Histoire de la littérature française et dont je dispose, il ne cite, pour le 17e siècle par exemple, que Mme de La Fayette et Mme de Sévigné. Aucune femme pour le 18e siècle, sauf Mme du Deffand (qu'il inclut dans le chapitre XIII titré "Indices d'une transformation prochaine" et à laquelle il consacre deux pages) et Mme de Staël qu’il inclut à juste titre dans le 19e siècle comme préparant le romantisme : elle a droit à un chapitre entier.
Ses analyses sont bien entendu à tendance psychologisante : l’œuvre est souvent expliquée par le tempérament et l’existence.
Il semble toutefois intéressant de se pencher sur la manière dont il évoque ces femmes de lettres pour les raisons suivantes :
- comment furent-elles longtemps perçues ?
- dans quelle mesure et dans quel sens la critique littéraire a-t-elle progressé ?
- que peut-il nous apprendre que nous ignorons au sujet de Mme de La Fayette, en tout cas les élèves d’aujourd’hui ?
- quel était le style en vogue au 19e siècle ?
- que devaient apprendre les lycéens du 19e siècle ? En effet, chaque chapitre est suivi d’un questionnaire qui laisserait pantois élèves et enseignants actuels.
Lanson inscrit Mme de Lafayette et Mme de Sévigné dans la partie titrée « Les Mondains », à la suite de La Rochefoucauld et avant le cardinal de Retz (Chapitre IV).
MME DE SEVIGNE
Après une courte introduction puis la biographie de Mme de Sévigné, Lanson donne un résumé fort succinct des Lettres, analyse le caractère de la marquise et enfin son style. Il propose ensuite un questionnaire aux élèves et donne des conseils de lecture.
Introduction
« Mme de Sévigné eut une grande douleur dans sa vie : le départ de sa fille pour la Provence où M. de Grignan, son mari, l‘emmena. À cette circonstance nous devons la plus grande partie des fameuses Lettres, écrites pour tromper l’ennui de la séparation et pour tenir l’exilée au courant de la vie de la cour et de la ville. Cette correspondance est l’histoire d’une âme, la chronique d’une époque et d’une société. Mme de Sévigné nous y apparaît comme une femme au tempérament calme et équilibré, douée surtout d’intelligence et d’imagination. C’est une admirable artiste, qui écrit d’une façon vive, spirituelle et naturelle. »
Remarques
Ceci n’est pas faux, mais reste incomplet. Il est vrai que ce n’est qu’une présentation. Toutefois, on note les caractéristiques lansoniennes (et du 19e en général pour ce qui est de la critique littéraire) : justification de l’œuvre par la vie de l’auteur (il est vrai que, dans le cas de Mme de Sévigné, c’est juste), style emphatique (« eut une grande douleur », « histoire d’une âme »). Quant à affirmer que Mme de Sévigné était calme, c’est s’avancer peut-être un peu trop...
I. Vie de Mme de Sévigné
« Marie de Rabutin-Chantal est née en 1626. Orpheline à six ans, elle épouse à dix-huit ans un gentilhomme breton, le marquis de Sévigné. Il la ruina et se fit tuer en duel pour une autre. À vingt-quatre ans, elle demeurait veuve, avec une fortune compromise et la charge de deux enfants, une fille de cinq ans, un garçon de trois. Elle se retira alors dans une terre bretonne que son mari lui avait laissée, - Les Roches, près de Vitré -, pour y reconstituer le patrimoine de ses enfants. Ceux-ci grandissant, elle revint à Paris. Elle reparaît à l’Hôtel de Rambouillet, à la cour. Mais le fils part pour l’armée ; la fille épouse le comte de Grignan (1669) qui l’emmène bientôt à l’autre bout de la France, dans son gouvernement de Provence. Le départ de cette fille adulée, adorée est un cruel déchirement pour sa mère. Dès lors ce ne sont plus que de longues séparations traversées de mille inquiétudes et brèves réunions où la tendresse de la mère est blessée à tout instant : car autant Mme de Sévigné était vive, enjouée, aimante, expansive, autant Me de Grignan était sèche, froide et réservée. Et les difficultés recommencent : il faut de l’argent pour payer les fredaines du fils, « le petit fripon, le petit compère », bon cœur, tête fantasque, un peu trop dépensier : « sa main était un creuset où l’argent fondait. » Il en faut surtout pour jeter dans le gouffre ouvert par l’orgueil des Grignan ; pressés de dettes énormes, mais incapables de réduire leur train, ils ne se maintiennent qu’à force d’expédients. Ils se débarrassent brutalement de leur fille Marie-Blanche – une enfant de cinq ans et demi, que Mme de Sévigné avait élevée avec amour, qu’elle appelait « ses petites entrailles », mais qu’elle ne put pas préserver du couvent où on la jeta pout n’avoir pas à la doter. Et ils font épouser à leur fils, pour éviter la banqueroute, la fille d’un fermier général : « Il faut bien fumer ses terres », disait Mme de Grignan. Mme de Sévigné ressentait comme siens tous les soucis de sa fille ; elle n’osait la contrecarrer en rien, elle l’aidait de son mieux. Elle mourut auprès d’elle, sans doute en la soignant (1696).
En somme, l’événement capital de sa vie a certainement été le mariage de cette fille « dont elle avait fait, disait Arnauld, l’idole de son cœur. » A cette circonstance fortuite, nous devons l’un des chefs-d’œuvre de notre littérature. »
Remarques
Elles sont les mêmes que pour Mme de La Fayette :
* Les citations ne sont pas référencées.
* Le style est évidemment désuet, bourré de poncifs et clichés typiques du 19e siècle.
* Lanson donne le mauvais rôle à Mme de Grignan. Il est vrai qu’elle était plus froide que sa mère mais on sait désormais que Mme de Sévigné était une mère abusive (toutes proportions gardées) et que sa fille, très amoureuse de son mari, chercha à sa protéger de la mainmise maternelle. Lorsqu’elles étaient ensemble, les scènes ses succédaient : Mme de Sévigné n’était pas si calme que veut bien l’affirmer Lanson dans son introduction. À l’Hôtel Carnavalet, elle avait prévu la chambre de Mme de Grignan à côté de la sienne, reléguant son époux loin d’elles ; sa fille refusa, désireuse de partager celle de son époux (et son lit), ce qui choqua profondément Mme de Sévigné, veuve depuis longtemps et d’un tempérament frigide. Elle ne comprenait pas que l'on puisse faire autant d'enfants et écrivit à son gendre : "Ah ! mon cher comte, songez pourtant que la jeunesse, la beauté et la gaieté d'une femme que vous aimez, toutes ces choses sont détruites par les rechutes du mal que vous faites souffrir." Il est vrai qu'en ce temps, les accouchements étaient dangereux. Toutefois, au courant des méthodes de contraception (tampons vaginaux, breuvages de stérilité et autres restringents), elle s'exclamait à l'adresse de sa fille : "Quoi ! On ne connaît point les restringents en Provence ?"
* Lanson parle de l’orgueil des Grignan, mais c’est un orgueil justifié : en tant que gouverneur de la Provence, il doit tenir son rang. Par ailleurs, Mme de Sévigné également est orgueilleuse. De la beauté de sa fille d’abord, du fait que le roi Louis XIV la remarque, de sa manière de danser à la cour. Fière d’elle-même ensuite, de ses relations, d’avoir assisté à Saint-Cyr à la première d’Esther en compagnie de Louis XIV (qui lui adresse la parole) et de Mme de Maintenon. Fière de son esprit spirituel enfin et de son sens de la répartie. Son cousin Bussy-Rabutin dresse un portrait au vitriol de la jeune marquise.
* En ce qui concerne son fils Charles, Lanson est injuste : dissipé et dépensier dans sa jeunesse certes, il se range, fait un mariage raisonnable et heureux et consent même à se départir d’une part de son héritage pour sa sœur endettée. Il aime beaucoup sa mère et ne se montre jamais jaloux de l’amour immodéré qu’elle porte à sa fille.
* Mme de Grignan lit Descartes et met la raison au-dessus du sentiment, ce que sa mère ne peut évidemment concevoir. D’où la réputation de froideur et de réserve que lui fait Lanson.
* Il semble que Lanson commette une erreur à propos de la mort de Mme de Sévigné : on sait à peu près aujourd’hui qu’elle mourut de la petite vérole (ou d’un refroidissement). Sa fille était effectivement malade, dans la chambre au-dessus. L’a-t-elle vraiment soignée avant de tomber malade à son tour ? Ceci reste à prouver. En tout cas, elle mourut seule : sa fille ne la revit pas vivante.
II. Les Lettres de Mme de Sévigné
Lanson écrit : « Jusqu’au mariage de sa fille, Mme de Sévigné a peu écrit. Sa fille mariée, tout change ; désormais, pour conjurer l’ennui, pour rester aussi proche que possible de la chère absente, pour la distraire dans sa lointaine province, elle va lui envoyer par tous les courriers les nouvelles grandes et menues de la cour et de la ville, mêlées de réflexions, de papotages, d’impressions de toute espèce. Ces lettres n’étaient point destinées à la publicité : elles ne furent recueillies en volume que trente ans environ après la morte de la marquise (en 1725). »
Remarques
* Mme de Grignan lisait sans doute avec plaisir les nouvelles de la cour mais elle ne s’ennuyait guère à Grignan, où les distractions étaient nombreuses et les fêtes somptueuses.
* Certes, Mme de Sévigné écrivait à et pour sa fille mais elle n’était pas sans savoir que ses lettres étaient lues dans les salons parisiens. Elle pouvait en tirer une légitime fierté. On peut toutefois se demander dans quelle mesure son style est vraiment naturel... D’ailleurs, Lanson revient sur ce sujet un peu plus bas et admet que sa correspondance était connue dans les salons. Pas d’édition ou de publicité donc, mais une certaine notoriété qui la poussait à soigner son style. Naturel, peut-être, mais travaillé sans nul doute, l’un n’empêchant pas l’autre.
* Quant aux lettres, sa petite-fille, Mme de Simiane, ne les conserva pas toutes et hésita longuement à les faire publier. L’édition de 1725 reste incomplète.
Lanson résume ensuite le contenu des lettres, se contentant la plupart du temps de leur donner un titre. Il écrit :
« Cette correspondance est d’abord l’histoire d’une âme. Ce que nous y trouvons avant tout, c’est Mme de Sévigné elle-même, avec son aisance, ses grâces naturelles, son esprit droit et sa sensibilité impétueuse : effusions après les séparations qui lui sont si cruelles (6, 9, 13 févier, 4, 24 mars 1671, 5 octobre 1673), impressions de lectures, réflexions sur la vie, impressions de nature avec le « triomphe du mois de mai » (29 avril 1671), la gaieté de la fanaison (22 juillet 1671), la tristesse des arbres qu’on abat (27 mai 1689), la fantasmagorie des clairs de lune (12 juin 1680), l’éclosion joueuse des bourgeons (19 avril 1690).
C’est aussi l’histoire d’une société. De 1665 à 1686, il n’y a guère d’événement grave ou menu dont on ne trouve l’écho dans les Lettres : le procès de Fouquet (novembre-décembre 1664), l’incroyable mariage (manqué) de la Grande Mademoiselle (15 décembre 1670), la mort de Vatel (24, 26 avril 1671), le passage du Rhin (17, 20 juin, 3 juillet 1672), la mort de Turenne (28 août 1675), l’exécution de la Brinvilliers (17, 22 juillet 1676), la noce de Mlle de Louvois (29 novembre 1679). Les descriptions significatives, les anecdotes alertement contées abondent. Les lettres sont l’indispensable complément des Mémoires de Saint-Simon.
Histoire d’une âme, chronique d’une société, tout cela se mêle à vrai dire dans le cours de chacune de ces lettres changeantes et souples come la conversation même et qui ne sont à vrai dire que des conversations écrites ».
Remarques
* Notons encore le vocabulaire daté : « histoire d’une âme » (deux occurrences), « grâces naturelles », « séparations cruelles ».
* Que Lanson, grand misogyne, puisse conseiller la lecture de Mme de Sévigné à côté de Saint-Simon est surprenant...
III. Le caractère de Mme de Sévigné
« Un tempérament calme où dominent l’intelligence et surtout l’imagination, voilà comment Mme de Sévigné nous apparaît d’après ses Lettres.
En général, elle a plus d’enjouement que de vivacité et de sensibilité. Elle n’eut de passion que pour sa fille, un peu aussi pour Marie-Blanche, une affection calme pour son fils ; en dehors de cela, quelques amitiés solides et sereines où son esprit avait part autant que son cœur : Fouquet, Retz, Mme de La Fayette. En dépit donc de ses effusions maternelles, ce n’est pas une passionnée. En sa jeunesse, elle est vive et gaie, et donne par là prise aux médisants ; cela s’amortit un peu avec l’âge, mais on retrouve encore la rieuse jeune fille dans la grand’mère. Spirituelle, ironique, maligne, elle n’est point tendre, sentimentale ni mélancolique. Les larmes lui manquent, et la pitié : la dure répression de la Jacquerie en Bretagne ne l’attendrit guère.
Elle aime la nature, et par là ses lettres mettent une note originales dans la littérature classique : mais elle ne mêle à cet amour ni sentimentalité ni rêverie. Elle en fait de la joie, comme de tout, et une joie physique, sensuelle, une joie des yeux et des oreilles. Un printemps, c’est du rouge, puis du vert : en voilà assez pour l’enchanter. À Livry, aux Rochers, elle a des bois ; mais ici c’est un vert, et là un autre vert. En automne, « les feuilles sont aurore, et de tant de sortes d’aurore que cela compose un brocart d’or riche et magnifique. » Elle a ainsi des impressions, des plaisirs d’artiste.
Elle aime les livres : elle est passionnée de comprendre et de penser. Elle a des goûts de précieuse, d’exquise mais authentique précieuse. Les grandes aventures des romans la ravissent. Corneille l’enivre ; elle est charmée de Molière, réfractaire en somme à Racine, qu’elle ne sent pas ; preuve que sa nature est foncièrement intellectuelle. Au fond, comme il est naturel à une mondaine, elle saisit mieux les idées que la poésie.
Très solidement instruite, elle a un choix de lectures austères pour une femme. Elle lit Quintilien, Tacite, saint Augustin ; Pascal la transporte. De ce fonds de lectures, qu’elle applique à son expérience, sortent toutes ces réflexions sur la vie humaine, sur les mœurs et les passions, qui rendent ses lettres si substantielles.
Mais sa qualité essentielle et dominante, c’est l’imagination. Ce qui fait de ses lettres une chose unique, c’est cela : l‘imagination puissante qui voit les choses, l’invention verbale qui les peint. Elle écrit au bout d’un mois son admirable lettre sur la mort de Turenne, lorsqu’elle a déjà raconté dix fois par écrit le même fait : au lieu de s’émousser, l’impression s’est avivée en elle, parce que lentement, à mesure que les circonstances lui sont parvenues, son imagination en élabore une représentation complète : et c’est de cette vision qu’a jailli le récit définitif, simple, saisissant comme la réalité même, plus pathétique que n’eût été l’expression désordonnée de la première émotion. Les effets de cette faculté maîtresse sont sensibles jusque dans sa tendresse maternelle. La mère était toute spontanée, la fille peu communicative ; les scènes, les malentendus étaient fréquents entre elles. Mais l’éloignement agit, l’imagination exalta l’amour maternel ; elle se fit de sa fille une image plus parfaite que sa fille elle-même, et adora de loin cette idole avec laquelle, de près, elle ne s’entendait guère.
Bref, elle est artiste. Ses émotions se complètent de toutes sortes de représentations imaginatives qui par contrecoup les exaltent parfois ; en tout cas, elles mettent dans son œuvre plus de variété et de richesse qu’elle n’en a parfois ressenti dans son cœur.
De là dérive ce don rare de faire sortir d’une idée abstraite tout ce qu’elle contient de pathétique. Lisez la sublime demi-page sur la mort de Louvois (26 juillet 1691) : cette émotion n’est pas un épanchement de tendresse ou de sympathie sur les êtres ; elle naît du saisissement de découvrir à travers la réalité vivante les vérités éternelles devant lesquelles sa raison frisonne. Cette mort lui révèle la Mort. C’est le pathétique de Bossuet. »
Remarques
* Étude particulièrement psychologisante : analyse du tempérament d’un auteur à travers son œuvre, et l’inverse : le caractère explique l’œuvre.
* Un bon point pour Lanson qui mentionne son goût de la nature (assez rare à l’époque classique) et ses lectures. Mais lorsque Lanson les trouve «austères pour une femme », il se trompe d’époque : au 17e, les « Précieuses » et les femmes cultivées, fort rares, lisaient couramment le latin et s’adonnaient avec passion à des lectures sérieuses. Du reste, la littérature facile n’existait pratiquement pas, peu de femmes sachant lire. Sa fille, grande lectrice de Descartes, était encore plus intellectuelle qu’elle. Mme de Sévigné se trompait quelquefois : elle prétendait que la mode de Racine passerait et qu’il ne faisait de tragédies que parce qu’il était amoureux...
* Lanson insiste sur l’imagination de Mme de Sévigné, qu’il qualifie d’ « artiste ». Sans doute pense-t-il à l’imagination visuelle et à la peinture. Il est vrai qu’elle a le don de dresser des tableaux pleins de vie.
* Un autre bon point pour Lanson qui compare quasiment Mme de Sévigné à Bossuet. La voilà décidément en bonne compagnie !
IV. Le style de Mme de Sévigné
Note préliminaire : Au 19e et longtemps avant dans le 20e siècle, on étudiait la forme après le fond. De nos jours, nous estimons que la forme, le style, sont au service du fond. Néanmoins, nous pouvons lire ce paragraphe de Lanson :
« Bien que Mme de Sévigné ait prétendu qu’elle laissait « trotter sa plume la bride sur le cou », peu de ses lettres sont des effusions spontanées. Elle savait qu’on se les communiquait, qu’on les admirait. Même avec sa fille, elle surveille son inspiration, choisit et tâche de dégager les dons qu’elle se connaît : la vive allure, la grâce primesautière, le tour libre, la vivacité spirituelle des images, autant de qualités rares dans la prose du 17e siècle.
L’expression paraît quelquefois trop brillante : cette coquetterie de la plume, c’est la dernière trace de la préciosité. Elle est du reste peu fréquente. Et l’étonnant, ce n’est pas que Mme de Sévigné – Sophronie à l’Hôtel de Rambouillet – ait de-ci de-là placé quelques pointes, c’est au contraire qu’elle ait écrit d’une façon si directe, si juste et si simple, pour tout dire en un mot : si naturelle.
« Ne quittez jamais le naturel, cela compose un style parfait », écrivait-elle à Mme de Grignan (lettre du 18 février 1671). Toujours variée et personnelle, n’usant jamais de procédés, elle a donné de ce style un modèle inimitable. La Bruyère pensait peut-être à elle quand il jugeait les femmes nettement supérieures aux hommes dans la littérature épistolaire. En tout cas, la définition qu’il donne de leur talent lui convient à merveille : Elles ont, écrivait-il, un enchaînement de discours inimitable et qui n’est lié que par le sens. »
Remarques
* Lanson se contredit donc ici avec ce qu’il a dit plus haut et rétablit la vérité : certaines lettres de Mme de Sévigné circulaient dans les salons : elle se savait lue et soignait son style. Il fait allusion à La Bruyère « qui pensait peut-être à elle » : c’est qu’il avait lu des copies de quelques lettres.
* Aucun exemple, comme pour La Princesse de Clèves, de Mme de la Fayette : argument d’autorité ! Lanson le dit, donc, c’est vrai...
* Il lui reproche quelques préciosités de style. Mais les vraies (et les premières) précieuses, loin d’être celles ridiculisées par Molière, étaient des femmes intelligentes qui se réunissaient dans les « ruelles » et voulaient améliorer la langue française. Il y eut des excès et des débordements certes, mais on peut affirmer que Mme de Sévigné sut toujours rester dans le juste milieu. Sa grande amie fut Mme de la Fayette, que l’on ne peut accuser de ridicule langagier...
Suivent ensuite les questions pour les élèves (qui, tout comme pour Mme de La Fayette, nous laissent pantois) et des conseils de lectures.
Questionnaire
- Racontez la vie de Mme de Sévigné
- Quel en a été le grand événement ?
- À quelle date ont été publiées les Lettres ?
- Quel est le caractère de Mme de Sévigné ?
- Mme de Sévigné aimait-elle la nature ?
- Que savez-vous de ses lectures ? Quelle est sa qualité dominante ?
- Définissez le style de Mme de Sévigné.
- Comment la Bruyère apprécie-t-il la littérature épistolaire des femmes ?
Lectures recommandées
- Boissier, Mme de Sévigné, Hachette, 1887
- A. Hallays, Mme de Sévigné, Perrin, 1921
- Jean Lemoine, Mme de Sévigné, sa famille et ses amis, Hachette, 1926
Biographie hagiographique de Mme de Sévigné (1890)
Cette notice biographique, imprimée dès 1870, est extraite de l’étude de Paul Mesnard qui figure dans la collection des Grands Écrivains. Au style suranné, on peut ajouter le parti-pris de discrétion et, bien entendu, le registre mélioratif du texte. Comment les élèves de la fin du 19e siècle (et même jusqu’en 1914) abordaient-ils la vie des grands auteurs ? En voici un exemple.
I. Enfance et adolescence
« Mme de Sévigné naquit à Paris, sous le règne de Louis XIII, le 5 février 1626, dans un hôtel de la place Royale. Elle était fille de Celse-Bénigne de Rabutin, baron de Chantal, et de Marie de Coulanges, et fut inscrite sur les registres de la paroisse Saint-Paul sous les noms de Marie de Rabutin Chantal.
Son origine paternelle était très noble, mais elle ne paraît pas avoir attaché à l’antiquité et à la noblesse de sa race la même importance que son cousin Bussy, qui lui écrivait un jour : « Je le cède à Montmorency pour les honneurs, non pour l’ancienneté. » Elle se montra surtout glorieuse d’avoir pour aïeule cette Mme de Chantal qui, restée veuve jeune encore, renonça au monde et à sa famille, et partit pour Annecy, où elle allait, sous la conduite de François de Sales, commencer l’établissement de l’ordre de la Visitation de Sainte-Marie.
Bussy Rabutin, dans son Histoire généalogique, nous a laissé le portrait du fils de sainte Chantal, qui devait être le père de Mme de Sévigné. Élevé dans la maison du président Frémyot, son grand-père paternel, « il devint, dit Bussy, un des cavaliers les plus accomplis de France, soit pour le corps, soit pour l’esprit, soit pour le courage. Il dansait avec une grâce non pareille ; il faisait très bien des armes. Il était extrêmement enjoué. Il y avait un tour à tout ce qu’il disait qui réjouissait les gens ; mais ce n’était pas seulement par là qu’il plaisait : c’était encore par l’air et par la grâce dont il disait les choses ; tout jouait en lui. »
Philippe de Coulanges et Marie de Bèze, aïeuls maternels de Mme de Sévigné, ne pouvaient pas se vanter d’une origine aussi noble ; mais Bussy les qualifie de gens « pleins d’honneur et de vertu », genre de noblesse qui en vaut bien un autre. Ce qui, du reste, semble attester le mérite de Philippe de Coulanges, c’est qu’il parvint au rang de conseiller du Roi en ses conseils d’État et privé.
Marie de Chantal, la future Mme de Sévigné, n’avait que dix-huit mois quand son père fut forcé, pour échapper au mauvais vouloir de Richelieu, de se retirer dans l’Île de Ré, où il prit du service dans l’armée de son ami Toiras, qui en était gouverneur. Il y périt glorieusement, le 22 juillet 1626, dans un combat contre les Anglais, à l’âge de trente et un ans.
De la branche aînée des Rabutin, qui venait de perdre le dernier de ses descendants mâles, il ne restait plus que la troisième fille de sainte Chantal, mariée au comte de Toulongeon, et la petite Marie de Chantal, destinée à dépasser la gloire de ses ancêtres et à jeter sur sa maison un éclat impérissable.
Quoique retirée du monde, sainte Chantal avait conservé une grande tendresse pour son fils, tendresse qu’elle reporta ensuite sur sa petite-fille, ainsi que le prouvent ses lettres, toutes remplies de touchante sollicitude.
Quand Marie de Coulanges, la veuve du baron de Chantal, mourut, la petite Marie n’avait que sept ans et demi : l’enfant fut élevée chez son grand-père et sa grand-mère, M. et Mme de Coulanges, qui l’entourèrent des soins les plus affectueux et les plus éclairés. Elle fit sa première communion en l’année 1634, lorsqu’elle venait d’avoir huit ans, ce qui ne laisse aucun doute sur la précocité de sa raison, de son intelligence et de sa sagesse.
Peu de temps après, elle devint plus orpheline encore qu’elle n’était : la mort lui enleva sa grand-mère, Mme de Coulanges, et elle resta sous la garde d’un vieillard de soixante-treize ans, dont l’appui lui manqua bientôt aussi.
Un conseil de famille, dans lequel Bussy, alors âgé de dix-huit ans, représenta son père, retenu loin de Paris, déféra la tutelle au second fils de Philippe de Coulanges, qui était abbé de Livry. Jamais tutelle ne fut remise en des mains plus dévouées. Depuis ce jour jusqu’à sa mort, c’est-à-dire pendant cinquante années, le « bien Bon » (c’est le nom que Mme de Sévigné lui donnait) ne quitta pour ainsi dire plus sa pupille. C’était un ami sûr et fidèle, un caractère honnête et solide, un homme d’affaires exact, et Mme de Sévigné apprécia toujours avec une vive reconnaissance les soins qu’il donna à sa fortune et la prudence de ses conseils. Si, avec tant de vivacité, elle eut un si ferme esprit de conduite, on peut croire qu’elle lui en fut en partie redevable. Dans ce bel équilibre de tant d’imagination et de tant de sagesse, ce fut lui peut-être qui mit le lest de la froide raison. Elle apprit à son école à payer ses dettes, à se faire de cette probité bourgeoise un point d’honneur, comme si elle n’eût pas été si grande dame, à gérer elle-même ses biens, à régler ses dépenses, à ménager le patrimoine de ses enfants.
L’abbé de Coulanges donna pour maîtres à sa pupille Chapelain, mauvais poète, mais critique judicieux, et le savant Ménage, si érudit dans les langues anciennes et modernes. Tous deux étaient fort capables de donner à Mlle de Chantal d’excellentes leçons d’italien. Ménage lui enseigna aussi l’espagnol qui, en ce temps-là, était avec l’italien, la langue à la mode parmi les femmes d’un esprit cultivé ; elle lui dut une connaissance du latin suffisante pour que, plus tard, elle pût, comme nous le voyons dans une de ses lettres, lire Virgile dans toute la majesté du texte. Quant à cet art charmant qui a fait sa gloire, elle n’avait sans doute besoin de l’apprendre de personne. Si elle y eut d’autres maîtres qu’une heureuse nature, elle les trouva dans la brillante société au milieu de laquelle elle vécut.
Il faut penser que ce fut au temps de son adolescence que Mlle de Chantal se livra aux études dont nous venons de parler. Il y a quelques années de son enfance sur lesquelles nous ne savons rien, si ce n’est qu’elles s’écoulèrent, en grande partie, sous les frais ombrages de l’abbaye de Livry, dont les jardins se trouvaient au milieu de la forêt de Bondy.
II. Mariage
Au premier rang de ceux qui avaient pu connaître Marie de Chantal, l’aimer pour tous ses agréments, goûter le charme de son esprit, apprécier même la riche dot qu’elle possédait, et le plus facilement lui plaire, était son cousin Roger, comte de Bussy, qui appartenait à une branche cadette de la famille de Rabutin, et que nous avons déjà nommé plusieurs fois. Mais si, comme il est assez probable, quoi qu’il ait voulu dire depuis, il songea à une alliance avec sa cousine, ce projet n’eut pas de suite. Elle épousa, le 4 août 1644, le marquis Henri de Sévigné, gentilhomme breton, petit-cousin par sa mère de Paul de Gondi, coadjuteur de Paris et plus tard cardinal de Retz. La bénédiction nuptiale fit donnée dans l’église de Saint-Gervais et Saint-Protais, à Paris, par Jacques de Neuchèse, évêque et comte de Chalon-sur-Saône, fils d’une sœur de sainte Chantal. Ce prélat avait fait à Mme de Sévigné, dans le contrat de mariage, une donation de dix mille écus.
Le marquis de Sévigné emmena sa femme à sa terre des Rochers, qui est à une lieue et demie de Vitré. Ils y passèrent deux années, faisant de courtes apparitions à Paris, où ils ne revinrent pour un long séjour qu'au commencement de l’automne de 1646. Le 10 octobre, Mme de Sévigné mit au monde une fille : ce fut, on peut le dire, le plus grand événement de sa vie, puisque, dans cette vie, une fille si chèrement aimée devait prendre la première place. M. et Mme de Sévigné restèrent à Paris tout l’hiver qui suivit cette naissance. Un procès les y retenait, et vraisemblablement aussi les plaisirs d’une société brillante, qu’ils étaient faits tous deux pour goûter. Mme de Sévigné entra dans le monde justement quand l’état des mœurs et de la langue se trouvait en France le plus favorable à l’agrément et à la délicatesse des entretiens. L’hôtel de Rambouillet était encore dans tout son éclat. Pour avoir fréquenté cet hôtel, et en général les plus célèbres réduits, Mme de Sévigné avait droit à a place que Saumaise (sic) lui a donnée dans son Dictionnaire des Précieuses. La préciosité, qui dégénéra quelques années plus tard en ridicule affectation, se pouvait alors définir surtout : la délicatesse du goût et des sentiments, l’urbanité des manières et du langage, l’opposé de la grossièreté d’esprit et de la grossièreté des mœurs.
Mme de Sévigné était certainement de retour aux Rochers au commencement de l’année 1648. C’est là que naquit son second enfant, Charles de Sévigné, et c’est de là qu’elle écrivit, le 15 mars de cette même année, à son cousin Bussy cette charmante lettre qui commence ainsi : « Je vous trouve un plaisant mignon », et où, le menaçant de « le réduire au lambel » (Note : brisure qui indique dans les armoiries les branches cadettes), elle lui annonce qu’elle est accouchée d’un garçon.
Les contemporains qui ont parlé du marquis Henri de Sévigné ne l’ont pas fait dans des termes très flatteurs : « Ce Sévigné, dit Tallemant, n’était pas un honnête homme : il ruinait sa femme, qui est une des plus agréables et des plus honnêtes femmes de Paris. » Suivant Conrart, dans ses Mémoires, il y avait cette différence entre son mari et elle, « qu’il l’estimait et ne l’aimait point, au lieu qu’elle l’aimait et ne l’estimait point. » Ses grandes dépenses, ses prodigalités avaient commencé à mettre le désordre dans la fortune de sa femme. Les amis de celle-ci, et avant tous le bon abbé de Coulanges, l’avaient forcée à se séparer de biens. Cependant, telles étaient sa bonté et son affection pour son mari, qu’on ne put, même après cette séparation, l’empêcher de lui venir en aide en s’engageant pour une somme de cinquante mille écus.
La vie de dissipation et de débauche que menait Sévigné eut l’issue qu’on pouvait prévoir. Le marquis s’étant permis, à ce qu’on prétendait, de railler le chevalier d’Albret, celui-ci lui fit demander des explications par un de ses amis nommé Soyecourt. Il nia les discours qu’on lui avait prêtés, mais seulement pour rendre hommage, dit-il, à la vérité, non pour se justifier, ce qu’il ne faisait jamais que l’épée à la main. On se battit. Après quelques instants de combat, Sévigné, s’étant enferré lui-même, tomba grièvement blessé. Il expira le surlendemain, 6 février 1651, à l’âge de trente-deux ans.
Mme de Sévigné le pleura sincèrement, quoique dans le monde on crût « que sa douleur n’était que grimace. » Mme de Sévigné ne savait pas feindre : dans sa conduite comme dans ses sentiments, il est impossible de surprendre jamais aucune hypocrisie. Si d’ailleurs elle eût, en cette circonstance, joué une comédie, elle l’aurait, en vérité, fait durer longtemps car, deux ans après, dit Tallemant, ayant rencontré dans un bal Soyecourt, dont la vue lui rappela le funeste duel, elle pensa s’évanouir. Une autre fois, s’étant trouvé en face du chevalier d’Albret, elle éprouva le même saisissement et perdit connaissance.
Elle passa les premiers temps de son deuil dans sa solitude des Rochers. L’abbé de Coulanges était près d’elle. Il s’occupa de remettre l’ordre dans ses affaires, que l’inconduite du marquis avait laissées en fort mauvais état.
III. Mme de Sévigné telle qu’en elle-même…
Revenue à Paris, elle reparut dans le monde, où elle avait déjà brillé du vivant de son mari, et ce fut proprement, nous l‘avons dit, l’école où se forma son talent. Cette société, si bien faite, par sa politesse, pour cultiver et aiguiser l’esprit, offrait aussi bien des écueils à une jeune veuve n’ayant auprès d’elle d’autre protection, d’autre sauvegarde que ses deux très jeunes enfants.
* Amitié avec Fouquet
Parmi les personnages qui, à cette époque, recherchèrent le plus Mme de Sévigné, il faut citer le surintendant des finances Fouquet. Elle venait souvent embellir de ses grâces et de son esprit les fêtes somptueuses et les brillantes réunions de la magnifique résidence de Vaux. Lorsqu’arriva la disgrâce du surintendant, elle resta fidèle à son infortune. Les lettres à Pomponne, sur le procès de Fouquet, seront toujours au premier rang parmi celles qui la font aimer. Pomponne, suspect comme tous les amis de Fouquet, était exilé dans ses terres. Mme de Sévigné, qui était à Paris et pouvait suivre de près tous les incidents du procès, se chargea de les lui raconter jour par jour. Elle ne se contenta pas d’exprimer dans ses lettres ses angoisses, son indignation, sa sympathie ; elle fit plus : avant même l’ouverture des débats, Olivier le Fèvre d’Ormesson (sic), un des juges rapporteurs du procès, qui lui était attaché par des liens d’amitié et de parenté, l’entendit plus d’une fois plaider devant lui la cause du surintendant. Que d’Ormesson ait été tout à fait sourd aux larmes et à la charmante éloquence de cette généreuse amie, ou qu’il y ait, à son insu, accordé quelque chose, toujours est-il certain que ce fut lui qui sauva la tête de Fouquet. Il résista courageusement à Sainte-Hélène, l’autre juge rapporteur : il opina pour le bannissement perpétuel et fit prévaloir son avis.
* Fâcherie avec Bussy
L’esprit de Bussy, que Mme de Sévigné goûtait beaucoup et par lequel elle sentait le sien excité, et ce faible de la parenté qu’elle appelait le « Rabutinage », avaient toujours maintenu entre eux une très bonne intelligence. Mais, au mois de mai 1658, Bussy, qui se préparait à rejoindre Turenne à l’armée de Flandre, demanda à sa cousine de lui avancer une somme de mille pistoles. Elle parut très disposée à lui faire ce plaisir, mais le bonhomme Coulanges n’était pas d’avis qu’on prêtât de l’argent, même à des cousins, sans de solides garanties. Il fut donc répondu à l’emprunteur qu’il y avait préalablement des éclaircissements nécessaires à prendre en Bourgogne. Bussy, piqué de cette réponse, emprunta ailleurs deux mille écus et partit pour l’armée plein de ressentiment contre Mme de Sévigné. Si même on admet que Bussy ait eu quelque raison de se plaindre, il ne tarda pas à mettre les torts de son côté par une vengeance indigne d’un galant homme. Il fit un portrait satirique de Mme de Sévigné, dont les copies se multiplièrent avec rapidité. Cette calomnieuse diffamation, venant d’un ami, d’un parent, ce tort impardonnable et que pourtant plus tard elle pardonna magnanimement, fut sans aucun doute un des plus sensibles chagrins de sa vie.
* Mère et fille
Jusqu’ici nous ne l’avons montrée que femme spirituelle et séduisante, amie sûre et dévouée. Il est temps de la faire connaître comme mère. L’abbé Arnauld, frère d’Arnauld de Pomponne, nous a laissé dans ses Mémoires ce gracieux tableau : « Il me semble que je la vois encore telle qu’elle me parut la première fois que j’eus l’honneur de la voir, arrivant dans le fond de son carrosse tout ouvert, au milieu de Monsieur son fils et de Mademoiselle sa fille : tous trois tels que les poètes représentent Latone au milieu du jeune Apollon et de la petite Diane, tant il éclatait d’agréments et de beauté dans la mère et dans ses enfants. »
Françoise-Marguerite de Sévigné, la future Mme de Grignan, fut placée dans le couvent des filles de Sainte-Marie, à Nantes, mais elle n’y resta sans doute que fort peu de temps : l‘élever, l’instruire elle-même devait être, pour Mme de Sévigné, la plus douce tâche. Ce fut elle qui lui apprit l’italien, probablement aussi le latin ; nous savons du moins qu’avant d’être mariée, Mlle de Sévigné lisait, aux Rochers, Tacite avec sa mère, qui lui en faisait admirer les belles périodes.
Pour la philosophie de Descartes, dans laquelle Mme de Grignan fit si versée, elle eut d’autres maîtres : sa mère ne se piquait point de cette science. Il paraît que celui qui lui en donna le goût et les premières leçons fut l’abbé de la Mousse, docteur en théologie, zélé cartésien, « qui était fort glorieux, nous dit quelque part Mme de Sévigné, d’avoir fait une si merveilleuse écolière. » Cet abbé de la Mousse est fréquemment nommé dans les lettres de la marquise : c’était un des amis qu’elle emmenait avec elle aux Rochers. Quand Mme de Sévigné lisait si bien tant de livres sérieux et restait la plus charmante des femmes, Mme de Grignan pouvait assurément lire Descartes sans être pédante et sans offenser les Grâces. Mais ce don, vraiment féminin, de prendre à la fleur de la science ses plus doux parfums et même ses sucs les plus généreux, sans aller jusqu’aux sèches et rudes épines, Mme de Grignan l’eut-elle comme sa mère ? On en peut douter. Le soin que celle-ci prit toujours de se donner elle-même pour bien plus profane et ignorante qu’elle ne l’était en effet en matière de cartésianisme, ce nom de « philosophie » qu’elle prononce si souvent, quand elle fait allusion aux froideurs de sa fille, font soupçonner qu’elle l’aurait volontiers dispensée de tant de science, et que si, dans la brillante instruction de Mlle de Sévigné, le but fut dépassé, ce fut contre l’intention de sa mère. Que de bonnes leçons d’ailleurs elle dut recevoir de cette mère ! Quel maître elle eut là dans l’art de causer et dans celui d’écrire ! De ce côté Bussy n’a rien exagéré quand il dit : « La bonne nourriture qu’elle lui donna et son exemple sont des trésors que les rois mêmes ne peuvent toujours donner à leurs enfants. »
Il est à craindre que la « nourriture » morale n’ait pas été aussi excellente. Cette imprudente adoration de sa fille, continuelle dans les lettres de Mme de Sévigné, cette extase devant ses perfections, ces louanges données à cette beauté autant qu’à son esprit, comment croire que le dangereux abus n’en ait pas commencé de bonne heure ? Le vieil Arnauld d’Andilly était bien sage quand il grondait si fort Mme de Sévigné, quand il lui disait qu’elle était une jolie païenne, qu’elle faisait de sa fille une idole dans son cœur, et que cette sorte d’idolâtrie, quoiqu’elle la crût moins criminelle qu’une autre, était aussi dangereuse. Cette éducation, à laquelle les plus tendres soins furent prodigués, ne réussit, au moins complètement, qu’à orner de connaissances, de talents et d’agréments très prisés dans le monde une enfant gâtée.
Mlle de Sévigné avait seize ans lorsqu’elle parut à la cour. Sa beauté était éblouissante. Blonde comme sa mère, elle avait la même fleur de teint ; sa bouche était petite, fine, parfaite ; son nez plus régulier que celui de sa mère ; sa taille était fort élégante. Il paraît que dans sa première enfance, elle avait un peu louché. C’est Mme de Lafayette qui le dit : « Ma petite-fille est louche comme un chien, il n’importe ; Mme de Grignan l’a bien été, c’est tout dire. » Mais il ne lui était rien resté de ce défaut. Bussy l’avait baptisée « la plus jolie fille de France ». Mme de Sévigné a dit que sa fille tenait d’elle une extrême facilité à rougir. Elles n’en paraissaient sans doute moins belles ni l’une ni l‘autre. On croit les voir toutes deux, avec cette charmante ressemblance, se prêtant un mutuel éclat, dans ces fêtes de la cour où les yeux de la mère, pleins de tendresse et d’admiration, ne se détachaient point de sa fille. Mme de Sévigné avait alors trente-six ans, mais elle avait gardé toute sa fraîcheur. Elle pouvait n’être pas trop éclipsée même par la jeunesse de Mlle de Sévigné dans son printemps ; mais elle s’oubliait elle-même, et sons seul orgueil était l’orgueil maternel.
Accueillies à la cour avec la plus grade faveur, elles ne purent manquer d’être, dans le même temps, répandues à la ville, dans le monde le plus brillant. Contentons-nous de les montrer au milieu de quelques amis de prédilection, disgraciés alors, mais qui avaient dans cette disgrâce, sauvé de beaux restes de leur splendeur passée, et réunissaient une société aimable et lettrée.
Mme du Plessis Guénégaud, dont le mari, secrétaire d’État, prodigieusement riche, avait été impliqué dans les concussions de Fouquet, s’était beaucoup lié avec Mme de Sévigné depuis ce procès du surintendant, qui les avait tant inquiétées et touchées l’une et l’autre, et pendant lequel elles s’étaient vues souvent et mutuellement consolées. Il s’était ainsi formé entre elles une amitié « par réverbération » : le mot est de Mme de Sévigné. Pomponne, leur ami commun, avait été aussi un trait d’union entre elles. Au commencement de 1665, l’hôtel de Nevers, splendide demeure de Mme de Guénégaud, s’était déjà rouvert aux agréables réunions des personnes distinguées et des beaux esprits qui, depuis longtemps, étaient habitués à s’y rassembler à peu près comme à l’hôtel de Rambouillet. Mme et Mlle de Sévigné s’y rencontraient avec La Rochefoucauld et Mme de Lafayette. Boileau y venait réciter quelques-unes de ses satires, encore inédites et Racine sa tragédie d’Alexandre. Souvent aussi, pendant la belle saison, quand elles n’étaient pas aux Rochers, ou qu’elles quittaient pour quelques jours leur cher Livry, Mme du Plessis Guénégaud les recevait dans son château de Fresnes. Là, on jouait de petites pièces romanesques ou féeriques, sur un théâtre de société, où Mme de Sévigné remplissait son rôle avec un talent supérieur, dont elle se souvenait pour s’humilier, quand elle voyait jouer la Champmeslé, ne se trouvant plus digne alors « d’allumer les chandelles ».
* Le mariage de Mlle de Sévigné
Quelque peu pressée que fût la tendre mère de se séparer de sa fille, elle commença à trouver, quand elle la vit près d’atteindre sa vingt-troisième année, que son établissement se faisait longtemps attendre. Plusieurs partis s’étaient présentés, mais aucun n’avait paru convenir. Mlle de Sévigné finit par épouser un homme qui n’était ni très beau ni très jeune, un mari déjà deux fois veuf. « C’était, dit Saint-Simon, un fort honnête homme, fort poli, fort noble, sentant fort ce qu’il était. » François Adhémar, comte de Grignan, était l’aîné d’une très ancienne et très illustre famille de Provence. Il devait avoir près de quarante ans lorsqu’il épousa Mlle de Sévigné. Il était homme du monde et homme d’esprit, excellent musicien, et avait aussi de plus solides qualités, qui le firent estimer dans les difficiles fonctions qu’il eut à remplir. Quand il épousa Mlle de Sévigné, il était un des lieutenants généraux en Languedoc. Sa première femme avait été Angélique-Clarisse d’Angennes, de la famille de Rambouillet ; de ce premier mariage M. de Grignan avait deux filles. La seconde union, qu’il avait contractée avec Angélique du Puy-du-Fou, ne lui avait pas laissé d’enfants. Mme de Sévigné donna une très belle dot à sa fille et M. de Grignan avait en Provence des biens considérables. Malheureusement, cette fortune était dès lors obérée : on voit dans le contrat de mariage que, sur les deux cent mille livres, partie de la dot qui fut remise en deniers comptants, la veille des épousailles cent quatre-vingt mille devaient être employées au paiement des dettes du mari.
Le mariage fut célébré le 29 janvier 1669, jour de saint François de Sales.
Cette alliance fut pour Bussy l’occasion d’un mécontentement qui contraria beaucoup Mme de Sévigné et qu’elle ne parvint à adoucir que par un de ces prodiges d’adresse et de séduction aimable qui lui étaient familier. Le comte de Grignan n’écrivit pas à Bussy pour lui faire part de son mariage. Bussy, parent et ami de « la plus jolie faille de France », fut très vivement blessé et n‘eut pas tort, ce semble, de juger que « cela n’était pas de la politesse de Rambouillet. »
Quand Mlle de Sévigné s’était mariée, on s’était flatté que M. de Grignan ne s’éloignerait guère de la cour ; mais le duc de Vendôme, qui avait succédé à son père comme gouverneur de la Provence, n’avait que treize ans. En son absence, le baron d’Oppède, premier président du parlement d’Aix, était chargé du gouvernement et, à côté de son autorité, on avait laissé s’établir l’influence de l’évêque de Marseille. Cet état de choses avait de grands inconvénients ; pour le faire cesser, on nomma le comte de Grignan lieutenant général en Provence, et il eut ordre de s’y rendre au plus vite, sa présence pouvant seule mettre un terme à de fâcheuses contestations.
M. de Grignan partit pour son gouvernement vers la fin d’avril 1670. Sa femme alla le rejoindre le 5 février de l’année suivante. Ce fut un moment cruel pour Mme de Sévigné, qui ne devait plus revoir sa fille qu’à de longs intervalles. De ce moment commença cette correspondance presque de chaque jour où l’on retrouve tout l’esprit, tous les agréments, tous les tons variés des autres correspondances de Mme de Sévigné, mais aussi, dans l’inépuisable expression de sa sensibilité, une éloquence passionnée qui n’est que là. Nous voulons croire, parce que cela est trop naturel, que Mme de Grignan aimait autant sa mère qu’elle pouvait aimer ; mais combien les lettres de celle-ci, presque au lendemain de la séparation, ne nous offrent-elles pas de traces de cruelles blessures faites au cœur maternel, trop exigeant peut-être, mais exigeant à si bon droit ! Faisons la part d’une susceptibilité inquiète, d’une tendresse insatiable et ombrageuse ; croyons qu’à force d’aimer sa fille, Mme de Sévigné la tourmentait beaucoup trop ; accusons-la bien fort, afin de ne pas trouver Mme de Grignan trop ingrate. Si, après cela, nous mettons la raison du côté de celle-ci, nous aurons toujours peur de cette raison froide et sèche, et, de ces deux femmes, nous aimerons mieux celle qui avait tort.
Le comte de Grignan, dès qu’il prit possession de son gouvernement, fut extrêmement offusqué par l’importance et le crédit de l’évêque de Marseille, Forbin Jason. Mme de Sévigné, qui avait su gagner la confiance de son gendre, lui donna d’utiles conseils. Avec son esprit sage et conciliant, elle lui écrivit pour le calmer. On est vraiment étonné de voir une femme qui n’aurait su, se semble, connaître du monde que les plaisirs frivoles ou les agréables récréations de l’esprit, une femme trop simple et trop aimable pour afficher aucune prétention messéante de régenter des hommes publics, tracer à un gouverneur de province, à l’aide des seules lumières de son bon sens et des inspirations de son amour maternel, des règles parfaites de conduite avec les personnes, lui dire si bien par quels ménagements on les gagne, comment on les engage dans de bons sentiments en ne leur en supposant pas trop aisément de contraires et avec une justesse de coup d’œil que les politiques de profession n’ont pas toujours, reconnaître et signaler les écueils de la défiance et des préventions.
M. de Grignan eut également à s’applaudir d’avoir suivi les prudents conseils de Mme de Sévigné dans ses rapports avec le président d’Oppède. Beaucoup de lettres font allusion à ces démêlés.
D’autres furent écrites à l’époque où M. de Grignan reçut l’ordre de Colbert de demander six cent mille livres aux états de Provence, au lieu des quatre cent mille de l’année précédente. Dans cette circonstance encore, on ne saurait trop louer les conseils pleins de sagesse donnés par la belle-mère à son gendre.
Elle ne les épargnait pas non plus lorsqu’il s’agissait des affaires personnelles de ses enfants. « Il a, disait-elle en parlant de M. de Grignan, une religion et un zèle pour les intérêts du Roi, son maître, qui ne peut se comparer qu’à sa négligence pour les siens. » C’était là, en effet, la grande plaie de cette maison. La négligence et aussi le faste en commencèrent de bonne heure la ruine. Ce fut bien pis quand le jeu s’en mêla. Mme de Grignan n’était pas moins inattentive que son mari dans la gestion de sa fortune, ni moins excessive dans ses orgueilleuses dépenses.
* Le fils de Mme de Sévigné
Nous venons de parler assez longuement de la fille de Mme de Sévigné, et nous n’avons encore dit qu’un mot de son fils, qui pourtant mérite bien d’être connu. On a peu de détails sur son enfance, mais on ne peut douter que son éducation n’ait été entourée de beaucoup de soins et qu’il n’ait reçu une première instruction très solide. Tout ce que nous savons d’ailleurs de lui, par ses lettres et par celles de sa mère, atteste un esprit de bonne heure cultivé.
Ce fut lui qui fit le premier connaître à sa mère le chagrin des séparations. Il avait vingt ans lorsqu’il s’engea dans l’aventureuse expédition de Candie, que le duc de la Feuillade conduisit au secours de Venise contre les Turcs. N’eût-elle pas été aussi bonne mère qu’elle était, comment n’aurait-elle pas aimé ce fils ? C’était de ses deux enfants celui qui lui ressemblait le plus par le caractère. Mais Charles de Sévigné avait d’autres titres à l’affection de sa mère qu’une certaine conformité de caractère et d’esprit. Son amour filial était touchant. Inépuisable auprès d’elle en gentilles prévenances, il cherchait toujours à l’égayer et à lui plaire. Amusant et plein d’esprit, il savait la faire rire aux larmes ; il n’aimait rien mieux que sa compagnie et son entretien ; il était son lecteur assidu dans sa solitude, son garde-malade, dévoué comme une fille, quand elle avait besoin de ses soins. Au lieu d’être jaloux de sa sœur, il se mettait de moitié dans ce sentiment, avec une générosité qui ne parut jamais forcée, et qui, dans aucun temps, ne s’est démentie. Il se contentait de quelques taquineries, en riant, sur une si visible prédilection.
Charles de Sévigné remplissait bien ses devoirs militaires, sans y avoir beaucoup de goût. Il fit la guerre en Allemagne, en Franche-Comté et en Flandre ; mais il quitta de bonne heure le service, se retira en Bretagne, s’y maria, et put mener enfin la vie douce et paisible après laquelle il avait toujours soupiré.
* Les petits-enfants
Nous avons fait connaître les deux enfants de Mme de Sévigné ; il nous reste à donner quelques détails sur ses petits-enfants. Mme de Grignan éleva deux filles, Marie-Blanche et Pauline, et un fils.
- Marie-Blanche, née en 1670, que Mme de Sévigné avait gardée chez elle pendant les deux ou trois premières années de son enfance, qu’elle avait prise en grande affection, et qu’elle appelait « ses petites entrailles », n’était âgée que de cinq ans et demi lorsque Mm de Grignan la fit entrer au couvent de Sainte-Marie de la Visitation, à Aix, où elle prit le voile à seize ans et mourut religieuse en 1735. Mme de Sévigné ne parle jamais qu’avec une commisération profonde de cette pauvre enfant sacrifiée.
- Pauline fut certainement plus en faveur auprès de sa mère que Marie-Blanche. Elle était jolie enfant ; elle annonça de bonne heure beaucoup d’esprit. Mme de Grignan eut, à ce qu’il semble, pour elle un moment de fantaisie. Mais peut-on appeler bien sérieuse, bien solide, vraiment maternelle, une affection qui fut si promptement rebutée par les difficultés de l’éducation, et qui eut sas cesse besoin d’être stimulée, réveillées par Mme de Sévigné et par tous les amis de Mme de Grignan ? Pauline échappa au couvent, mais ce ne fut pas sans peine. L’espérance, qui se réalisa, de la marier avec une médiocre dot l’aida beaucoup à s’y soustraire. Mais surtout elle fut soutenue par Mme de Sévigné qui, bien plus que Mme de Grignan, l’aimait avec tendresse, et qui fut toujours, déplorable nécessité, son avocat auprès de sa mère.
- Mme de Sévigné montra une tendresse non moins vive et non moins éclairée pour son petit-fils, Louis-Provence, marquis de Grignan, qu’elle nomme dans ses lettres « le petit marquis ». En 1677, il n’avait que six ans, et déjà elle voulait qu’il eût un précepteur : elle ne se rendait pas aux objections qu’on lui faisait sur son âge, parce qu’elle croyait son esprit fort précoce. Mme de Grignan paraissait alors fort inquiète de la timidité qu’elle remarquait dans cet enfant ; sa mère la rassurait avec beaucoup de bon sens à ce sujet, lui représentant qu’il ne serait pas raisonnable d’en tirer de fâcheux augures sur son courage dans l’avenir ; elle lui recommandait surtout, si elle voulait triompher de cette timidité, de ne point l’effaroucher, de ne point le rabaisser, mais « de le mener doucement, comme un cheval qui a la bouche délicate. » Plus tard, lorsque le petit marquis se fut distingué dans ses premières campagnes, Mme de Sévigné, pendant un séjour qu’il fit à Paris, se plut à le diriger par ses conseils, à lui enseigner, au moment où il entrait dans le monde, ce qu’elle appelait le « manège des conversations. » Elle tâchait aussi de lui inspirer le goût de la lecture et, à son grand regret, elle y réussissait assez peu. De son côté, le chevalier de Grignan, oncle du jeune capitaine, le nourrissait des plus solides maximes de l’honneur militaire, et lui apprenait, en même temps, ce dont il n’avait guère trouvé les leçons ni l’exemple dans la maison paternelle : l’habitude de compter, de ménager son argent. Ce fut lui qui le produisit à la cour, où il lui ménagea un accueil très flatteur.
IV. Fins de vie...
Mme de Sévigné avait fait plusieurs voyages à Grignan. Elle s‘y rendit encore en 1694, et assista au double mariage de Pauline et de Louis-Provence. Ces deux mariages, très avantageux du côté de la fortune, vinrent calmer les inquiétudes que depuis longtemps lui causaient les cruels embarras d’argent où se trouvaient sa fille et son gendre. Mais des soucis d’une autre nature ôtèrent le repos à ses derniers jours. La santé de Mme de Grignan devint extrêmement mauvaise. Les inquiétudes de sa mère furent si vives, que très vraisemblablement ses forces affaiblies et son sang échauffé la prédisposèrent à la maladie dont elle fut bientôt attaquée. Au mois d’avril 1696, elle fut atteinte de la petite vérole. Elle était au château de Grignan. Mlle de Martillac, demoiselle de compagnie de Mme de Grignan, lui donna des soins avec une affection et un dévouement que la crainte de la contagion n’effraya pas. Mme de Grignan était sous le même toit et ne parut pas au lit de mort de sa mère. Croyons pour son honneur que, trop malade elle-même et trahie par les forces du corps, elle fut dans l’impossibilité de s’y traîner. Au témoignage de M. de Grignan, Me de Sévigné montra, à l’heure de la mort, une fermeté et une soumission étonnantes : « Cette femme, dit-il, si tendre et si faible pour tout ce qu’elle aimait, n’a trouvé que du courage et de la religion quand elle a cru ne devoir songer qu’à elle. » Ce fut le 17 avril 1696 qu’elle fut emportée par le terrible fléau qui, neuf ans plus tard, devait aussi frapper sa fille. Elle avait soixante-dix ans et deux mois. Elle fut enterrée dans l’église collégiale de Grignan, à gauche du grand autel.
Son esprit, comme son cœur, l’agrément de son commerce, sa bonté, sa fidélité dans ses amitiés, la rendaient infiniment regrettable à tous ceux de ses amis qui lui survivaient. Quelques jours après sa mort, Emmanuel de Coulanges, son cousin germain, écrivait à Mme de Simiane (Pauline) : « Que coup pour nous tous, tant que nous sommes ! Mme de Coulanges est dans une désolation qu’on ne vous peut exprimer, et si grande que je crains qu’elle n’en tombe bien malade. Mme la duchesse de Chaulnes s’en meurt. La pauvre Mme de la Troche ! Enfin, nous nous rassemblons pour pleurer. »
Qui pourrait douter qu’au milieu de ces douleurs une des plus vives n’ai été celle de Charles de Sévigné ? Sa vie tout entière dit assez quels durent être ses regrets. Il donna d’ailleurs, après la mort de sa mère, des marques si touchantes de son respect pour toutes ses volontés et tous ses sentiments, que l’amour filial n’a point de larmes qui soient plus éloquentes. Mme de Sévigné, avant de quitter Paris pour son dernier voyage en Provence, avait laissé entre les mains du lieutenant civil le Camus une cassette qui renfermait des papiers où elle assurait des avantages à Mme de Grignan. Elle avait recommandé qu’elle en fit usage, si son frère élevait quelque prétention contre elles. Le Camus expliqua au marquis de Sévigné les intentions de sa mère, et sur-le-champ obtint un acte de soumission. Sévigné écrivit à sa sœur une admirable lettre, qui le fait mieux connaître que tout ce que nous avons pu et pourrions dire de lui.
Mme de Grignan mourut le 16 août 1705, dans une terre aux environs de Marseille. Comme sa mère, nous l’avons dit, elle succomba à la petite vérole.
Son fils, au mois d’octobre de l’année précédente, lui avait été enlevé à Thionville par la même maladie, étrangement fatale à cette famille. Il était brigadier des armées du Roi, et s’était fort distingué à la bataille d’Höchstädt, si funeste à nos armes, et qui fut livrée deux mois avant sa mort, le 13 août 1704. Il ne laissa point de postérité.
Charles de Sévigné finit ses jours le 26 mars 1713, à Paris, sans sa maison sise grande rue du faubourg Saint-Jacques. Sa veuve, Jeanne-Marguerite de Brehan de Mauron, mourut plus de vingt ans après lui, en 1737.
Le comte de Grignan survécut plusieurs années à sa troisième femme : il mourut le 31 décembre 1714. Il revenait de Lambesc, où il avait été ouvrir l’assemblée des états, et se rendait à Marseille, lorsque la mort le surprit dans une hôtellerie. Il était fort âgé ; il gouvernait la Provence depuis quarante-cinq ans. Ce gouvernement, exercé pendant tant d‘années, avait été souvent une lourde charge pour lui et pour sa maison ; mais il y avait rendu de très utiles services. Celui de tous qui a laissé le souvenir le plus glorieux pour lui est l’affaire de Toulon en 1707. Cette ville était menacée par le duc de Savoie et par le prince Eugène, qui avaient fait une pointe en Provence. Le maréchal de Tessé, qui était trop éloigné pour secourir la ville à temps, ordonna au comte de Grignan de la couvrir. Celui-ci forma rapidement un camp. Il avait fondu toute sa vaisselle d’argent pour en faire de la monnaie obsidionale. Son activité sauva Toulon. « Le vieux Grignan, dit le duc de Savoie, nous a gagné de vitesse. » Lorsque le maréchal de Tessé fut arrivé, il y eut un combat contre les Impériaux, qui dura six heures, et pendant lequel, malgré son grand âge, Grignan, toujours à cheval, se battit comme un jeune officier.
Après la mort du comte de Grignan, le mari de sa fille Pauline, M. de Simiane, qui était premier gentilhomme de la chambre du duc d’Orléans, dut à la faveur de ce prince la lieutenance générale de Provence, dans laquelle il succéda à son beau-père. Il ne jouit que trois ans de sa charge : il mourut en 1718. Sa veuve passa plusieurs années à la cour, comme dame de compagnie de la duchesse d’Orléans ; puis elle retourna en Provence, où elle vécut très retirée, dans une grande dévotion. Elle mourut à Aix, le 3 juillet 1737. Ce qui fera toujours profiter le nom de Mme de Simiane de l’immortalité de celui de Mme de Sévigné, c’est, avec toutes les pages charmantes que celles-ci a écrites sur l’enfance et sur la jeunesse de sa chère Pauline, la part que cette Pauline a prise aux premières publications des lettres de son aïeule.
Mme de Simiane eut trois filles, dont une seule, Mme de Villeneuve, a laissé une postérité qui existe encore. »
Sources : Lettres choisies de Madame de Sévigné, extraites de l’édition Des grands écrivains de la France, par AD. RÉGNIER, Hachette, 1914.
* * *
Date de dernière mise à jour : 13/10/2017