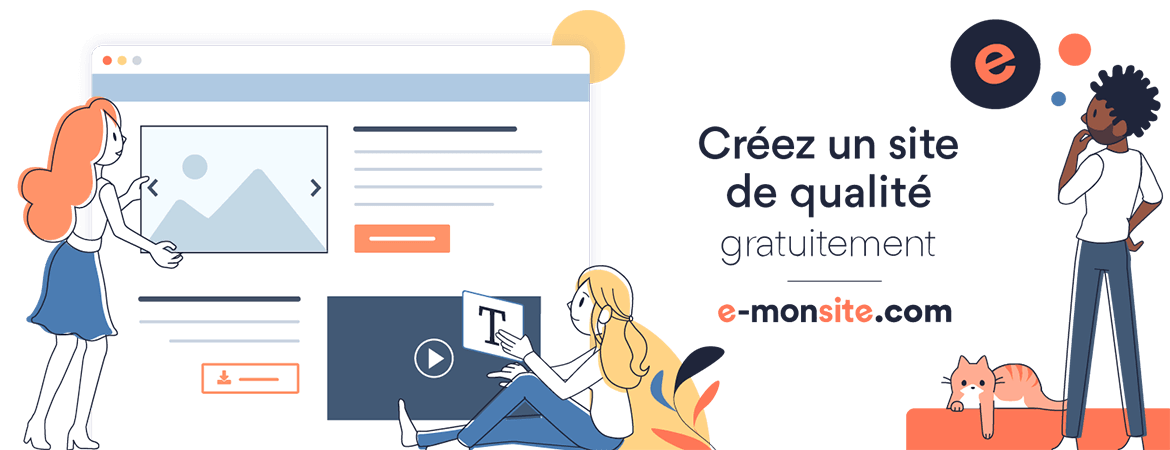Mme du Châtelet : Discours sur le bonheur
Libertinage
 Gabrielle Emilie du Châtelet, née le Tonnelier de Breteuil, voit le jour le 17 décembre 1706 à Paris. Dans cette vie très riche, nous nous intéresserons avant tout à son goût pour les plaisirs, à ses aptitudes intellectuelles, scientifiques et philosophiques, et à ses relations avec Voltaire.
Gabrielle Emilie du Châtelet, née le Tonnelier de Breteuil, voit le jour le 17 décembre 1706 à Paris. Dans cette vie très riche, nous nous intéresserons avant tout à son goût pour les plaisirs, à ses aptitudes intellectuelles, scientifiques et philosophiques, et à ses relations avec Voltaire.
« Nous n’avons rien à faire dans ce monde, dit-elle, qu’à nous procurer des sensations et des sentiments agréables », non de façon discrète ou dissimulée comme la plupart de ses amies, mais de manière ostentatoire et souvent excessive, à la manière des hommes. Ce qui déconcerte ses contemporains, c’est l’aspect androgyne de sa personnalité et son tempérament excessif. Dualité bien cernée par Voltaire qui la surnomme « Pompon-Newton » en raison de son goût pour les fanfreluches d'une part et de son attrait pour les mathématiques d'autre part, double personnalité originale car en investissant le territoire masculin des sciences (physique et géométrie), elle tourne le dos aux normes de la féminité de son époque et de sa classe. Les femmes qui tiennent salon la détestent, notamment Mme du Tencin, Mme du Deffand et Mme Geoffrin.
Elle va au spectacle, prend le goût des cabarets où elle aime s'encanailler, fréquente volontiers Versailles où elle dépense des sommes folles à la cavagnole (on dit aussi biribi) à la table de la reine Marie L., qui adore ce jeu. Elle rencontre Voltaire un jour d’avril 1733 et devient rapidement sa maîtresse : Émilie est amusée et flattée mais ça n’est pas le coup de foudre. À l’heure qu’il est, elle a déjà eu des amants, en particulier le duc de Richelieu et le savant Maupertuis. C’est l’époque, entre vingt et vingt-huit ans, où elle se partage entre les grossesses (elle fait trois enfants à son mari dont deux survivent), l’initiation aux mathématiques et les plaisirs de la société.
Elle aime les parures. Soucieuse de son apparence, elle cherche à camoufler une virilité du corps et de l’esprit sous un amas de fanfreluches. Probablement inquiète de sa féminité et de son pouvoir de séduction, Émilie ne se montre en public qu'extrêmement maquillée et couverte de diamants, de pompons, de rubans et autres nœuds ou pierreries. Mme du Châtelet n'est pas épargnée, après sa mort, par la plume féroce de Mme du Deffand qui écrit en 1777, dans sa Correspondance : « Représentez-vous une femme grande et sèche, sans c.., sans hanches, la poitrine étroite, deux petits tétons arrivant de fort loin, de gros bras, de grosses jambes, des pieds énormes, une très petite tête, la visage aigu, le nez pointu, deux petits yeux vert-de-mer, le teint noir, rouge, échauffé, la bouche plate, les dents clairsemées et extrêmement gâtées. Voilà la figure de la belle Émilie, figure dont elle est si contente qu'elle n'épargne rien pour la faire valoir : frisure, pompons, pierreries, verreries, tout est à profusion ; mais comme elle veut être belle en dépit de la nature, et qu'elle veut être magnifique en dépit de la fortune, elle est souvent obligée de se passer de bas, de chemises, de mouchoirs et autres bagatelles. » (Correspondance, 1777).
Les excès de la passion
Autoritaire et méprisante, notamment avec les subalternes, elle sait aussi être charmante voire soumise quand elle veut séduire. Libre de ses choix et de ses mouvements, elle va s’installer à Cirey, propriété de son mari (épousé le 20 juin 1725), avec Voltaire (dont elle est la compagne fidèle par intermittences durant plus de 16 ans). Elle ignore le juste milieu, brûle la vie et meurt à 42 ans en accouchant d’une petite fille, la bâtarde de Saint-Lambert.
Contrairement à Madame du Deffand née « sans tempérament ni roman », Émilie n’envisage la vie que sous les couleurs de la passion, de toutes les passions. Elle pense que « l’on n'est heureux que par des goûts et des passions satisfaites. » Née avec un tempérament de feu, elle est sujette à des colères homériques et elle a besoin de sensations fortes pour se sentir exister.
Elle aime les jeux à la folie dès lors qu’ils la mettent en danger, non seulement les jeux amoureux mais aussi les jeux de cartes, quand on joue gros et qu’on risque d’y laisser sa chemise. Elle en fait ainsi l’éloge : « Notre âme veut être remuée par l’espérance ou la crainte ; elle n’est heureuse que par les choses qui lui font sentir son existence. Or le jeu nous met perpétuellement aux prises avec ces deux passions, et tient, par conséquent, notre âme dans une émotion qui est un des grands principes du bonheur qui soit en nous. »
Ajoutons-y les jeux de la scène où elle excelle. Sur les planches, elle est capable de tout, y compris de faire rire d’elle. Elle pratique le théâtre avec le même excès que tout le reste. Les malheureux invités de Cirey, contraints de suivre le rythme effréné de leur hôtesse, en savent quelque chose. Mme de Graffigny, épuisée, note : « Nous jouons aujourd’hui L’Enfant Prodigue et une autre pièce en trois actes dont il faut faire les répétitions. Nous avons répété Zaïre jusqu’à trois heures du matin ; nous la jouons demain avec la Sérénade. Il faut se friser, s’ajuster, entendre chanter un opéra […]. Nous avons compté hier au soir que dans les 24 heures, nous avons tant répété que joué trente-trois actes, tant tragédie, opéra que comédie. »
Mais tout ceci n’est rien à côté de la seule grande passion « qui puisse nous faire désirer de vivre et nous engager à remercier l’auteur de la nature, quel qu’il soit, de nous avoir donné l’existence » : l’amour. Mais ne nous y trompons pas : elle attribue au plaisir des corps une importance que lui dénient la plupart des moralistes. Émilie est une insatiable, ignorant l’indolence et la tiédeur qui peuvent naître avec le temps et la « continuité d’un commerce ». Elle est, dit-elle, de « ces âmes tendres et immuables qui ne savent ni déguiser ni modérer leurs passions, qui ne connaissent ni l’affaiblissement, ni le dégoût, et dont la ténacité sait résister à tout, même à la certitude de n’être plus aimée ». Émilie va au-devant de bien des chagrins. On lui connaît six amants : une passade sans conséquence avec son chargé d’affaires à Bruxelles, des amours contingentes avec le duc de Richelieu et Maupertuis et trois passions dévastatrices : la première, la dernière et Voltaire.
Le comte de Guébriand est son premier amant. C’est un don Juan assez médiocre, élégant, bon danseur et beau parleur. Elle a vingt-et-un ans et en tombe éperdument amoureuse, sans être payée de retour et fait une tentative de suicide. Vingt ans plus tard, méditant sur elle-même, elle pourra affirmer qu’une « première passion emporte tellement hors de soi une âme de cette trempe [de la sienne] qu’elle est inaccessible à toute réflexion et à toute idée modérée […]. Mais le plus grand inconvénient attaché à cette sensibilité emportée est qu’il n’y a presque point d’homme dont le goût ne diminue par la connaissance d’une telle passion. » Elle conclut que pour conserver longtemps le cœur d’un amant, il faut alterner le chaud et le froid. Reste que sa dernière passion pour le jeune Saint-Lambert ressemble en tout point à la première. Elle le rencontre en 1748 à la cour du roi Stanislas à Lunéville. A quarante et un ans, elle oublie ses sages réflexions et se comporte comme la jeune femme de vingt-et-un ans, sans les grâces de la jeunesse. Elle l’accable de ses attentions, de ses lettres, de ses reproches et de son adoration. Or Saint-Lambert n’est guère plus épris que Guébriand et la passion dévorante de cette femme impétueuse et exigeante l’ennuie au plus haut point. Il n’aura pas l'occasion de rompre puisqu’elle mourra de ses œuvres : le 4 Septembre 1749, Émilie accouche d’une petite fille, immédiatement mise en nourrice ; le 9, elle envoie le manuscrit de son commentaire sur Newton à la Bibliothèque du roi et meurt subitement quelques heures plus tard.
L'intellectuelle
Très jeune, elle montre du goût pour l'étude et le travail et fait preuve d'une intelligence pratique, portée sur des applications concrètes. Ne nous étonnons donc pas de son attirance pour les mathématiques et la physique. Grâce à une éducation atypique en ce siècle, elle est autorisée à rester au salon quand ses parents reçoivent et à intervenir dans la conversation, elle demande à Fontenelle de lui expliquer ses Entretiens sur la pluralité des mondes. Il lui parle de physique et d’astronomie. Il lui aurait même procuré certaines communications de l’Académie des Sciences, comme celles du célèbre Cassini sur les satellites de Saturne.
Au printemps 1735, elle tourne le dos à l'inconstant Maupertuis et rejoint Voltaire au château de Cirey, dans la Haute-Marne. Après sa jeunesse libertine, elle avoue : « Depuis que j’ai commencé à vivre avec moi, et à faire attention au prix du temps, à la brièveté de la vie, à l’inutilité des choses auxquelles on la passe dans le monde, je me suis étonnée d’avoir eu un soin extrême de mes dents, de mes cheveux, et d’avoir négligé mon esprit et mon entendement. J’ai senti que l’esprit se rouille plus aisément que le fer […]. J’ai cherché quel genre d’occupation put en fixant mon esprit, lui donner cette consistance qu’on acquiert jamais, en ne se proposant pas un but dans ses études. »
Élisabeth Badinter nous dit : « Lucide sur ses talents, elle sait qu’elle ne peut prétendre ni au génie de Voltaire, ni à celui de Newton. Elle s’assigne donc plus modestement le rôle de traducteur. Son but : “Transmettre d’un pays à un autre les découvertes et les pensées des grands hommes.” Elle s’attaque aux deux grands génies que sont Leibniz et Newton, moins pour traduire leurs mots que pour expliquer leur pensée au public éclairé de son pays. Ce faisant, elle s’approprie la physique et la métaphysique la plus sophistiquée de son temps et entre dans le club très fermé des savants, jusque-là réservé aux hommes. Rares sont ceux qui savent mesurer les talents exceptionnels de cette femme. Mais parmi eux, figurent Voltaire, Maupertuis, Clairaut, d’Alembert et Diderot. Autrement dit, l’élite de ses contemporains. »
Douée et ambitieuse, Émilie possède également une grande puissance de travail et de la ténacité. Cette énergie hors du commun ne manque pas de surprendre Madame de Graffigny, toujours elle, lors de son séjour à Cirey : « Elle passe tous les jours presque sans exception jusqu’à cinq et sept heures du matin à travailler […]. Vous croyez qu’elle dort jusqu’à trois heures ? Point du tout […]. Elle ne dort que deux heures et ne quitte son secrétaire dans les 24 heures que le temps du café qui dure une heure, et le temps du souper et une heure après. » Elle ne se déplace jamais sans son petit étui de mathématiques en or, un rare étui en galuchat noir, créé en 1730 par Nicolas Bion.
Elle entretient des correspondances scientifiques avec de nombreux savants. L’été 1737, après deux ans de travail acharné, elle décide de concourir au prix de l’Académie des Sciences qui a pour sujet La nature du feu et sa propagation. Voltaire concourt également. A son insu, en quelques nuits, elle rédige son mémoire qu’elle fait parvenir anonymement (c’est la règle) à l’Académie. Ni elle, ni lui ne l’emporteront, mais l’Académie leur fera l’honneur d’une publication.
Elle écrit ensuite un traité de physique adressé à son fils. Pour le terminer, elle embauche le savant allemand König qui l’initie à la physique leibnizienne. Elle, qui ne jurait que par Newton, est séduite par son adversaire. Elle est convaincue de la véracité du calcul des forces vives. Les Institutions de Physique paraissent en 1740. Le Journal des Savants lui consacre deux comptes rendus élogieux, montrant le cas qu’il fait de cette œuvre sérieuse, et néanmoins polémique. En effet, la marquise qui ne manque ni d’audace ni de courage, s’est autorisée à critiquer la théorie des forces du secrétaire de l’Académie des Sciences, Dortous de Mairan. Vexé, cet homme d’habitude si courtois, publie une réponse qui tente de la ridiculiser. En vain. Elle lui répond à nouveau avec brio et avec une insolence qui humilient Mairan et réjouissent son ami Maupertuis : « Voilà Madame du Châtelet au comble de ses vœux […]. Elle a raison pour le fond et pour la forme ». En attendant, si certains refusent de la prendre au sérieux à Paris, les Institutions sont traduites en italien dès 1743 et lui valent d’être associée à l’Académie de Bologne en 1746. Deux siècles et demi plus tard, on peut encore juger que « les premiers chapitres des Institutions sont l’une des plus belles et des plus nettes expositions de la doctrine de Leibniz en français ». Les savants allemands lui en sont reconnaissants puisque la « Décade d’Augsbourg » la compte, en 1746, parmi les dix savants les plus célèbres de l’époque. Émilie n’a pas pour autant tourné le dos à Newton. Au contraire, alors qu’elle rédige les Institutions, elle annonce déjà un prochain travail sur le système du monde selon Newton. Elle a eu l’occasion de se familiariser avec cette philosophie ardue, exigeant une solide culture scientifique, grâce à Maupertuis et Voltaire, qui en sont les hérauts en France ; non seulement elle a rédigé un traité d’optique newtonien, mais elle a collaboré à la préparation des Éléments de la philosophie de Newton que Voltaire publie en 1738. Dans l’épître dédicatoire à Madame la marquise du Châtelet, il rend un vibrant hommage à son travail qui est sa « gloire et celle de son sexe ». Il dit d'elle par ailleurs : « Une femme qui a traduit et commenté Newton, en un mot un très grand homme ! » Quant à Ampère, il la considère comme un « génie en géométrie ».
Pourtant, ce n’est qu’en 1744 qu’elle se met véritablement au travail. Son objectif : traduire du latin en français l’œuvre maîtresse de Newton, les Principia Mathematica, encore fort peu lus en France, pour mettre un terme à la physique des tourbillons. Souvent interrompue par ses multiples obligations et ses allers et venues, la marquise mettra cinq ans pour atteindre son but. C’est pour elle, « une affaire très précieuse et très essentielle » dont sa réputation dépend. Les années 1745 et 1746 sont consacrées à cette traduction rendue difficile par le latin de Newton. Elle corrige les épreuves et refait inlassablement les calculs. 1748 est essentiellement l’année de Lunéville et de sa folle passion pour Saint-Lambert. Impossible de travailler au milieu d’une telle dissipation. Mais quand elle réalise qu’elle est enceinte, elle ressent l’urgence de finir son travail et de « le bien faire ». Envahie par un sinistre pressentiment – elle est convaincue de ne pas survivre à ses couches –, Émilie s’enferme dans son bureau parisien durant six mois pour terminer son grand œuvre : pour ne pas « perdre le fruit de son travail, en cas qu’elle meure en couches », elle établit un emploi du temps rigoureux : « Je me lève à 9 heures, quelquefois à 8, je travaille jusqu’à 3, je prends mon café à 3 heures, je reprends le travail à 4, je le quitte à 10 pour manger un morceau seule, je cause jusqu’à minuit avec monsieur de Voltaire, qui assiste à mon souper, et je reprends le travail à minuit, jusqu’à 5 heures. » (Lettre à Saint-Lambert du 15 juin 1749)
Ses craintes et ses espoirs se réalisent. Le 10 septembre, le jour de sa mort, elle signe la fin de son manuscrit et le fait parvenir à la Bibliothèque du Roi. Fidèles à la mémoire de leur amie, Voltaire et Clairaut prennent soin de la publication de l’ouvrage en 1756 et 1759. Dans la préface qu’il rédige, Voltaire lui rend cet hommage : « Cette traduction que les plus savants hommes de France devaient faire et que les autres doivent étudier, une femme l’a entreprise et achevée à l’étonnement et à la gloire de son pays. » Madame Du Châtelet a gagné son pari.
Relations avec Voltaire
Entre Guébriant et Saint-Lambert, il y a Voltaire, l’homme de sa vie. Pendant quinze ans, ils ne se quittent guère, partageant les plaisirs et les peines et ce qui est plus rare, les mêmes passions intellectuelles.
 Durant les premières années du tête à tête de Cirey, ils s'adorent et travaillent beaucoup. Ce sont des « philosophes très voluptueux », dit Voltaire. Lorsqu’il s’éloigne quelques mois en Hollande puis en Prusse (chez le roi Frédéric II), elle se dit malade de chagrin, incapable de survivre à son absence. Mais peu à peu, la passion s’étiole, l’autoritarisme de la marquise reprend ses droits et Voltaire, de dix ans son aîné, est bien loin d’avoir le tempérament de sa compagne. Il prend prétexte de sa santé, elle fait mine de comprendre et d’accepter. Elle veut à tout prix conserver l’illusion que rien n’a changé puisqu’elle aime pour deux. Mais quand elle apprend que Voltaire a une aventure avec la jolie Mlle Gaussin au printemps 1744, puis qu’il entretient une liaison en 1745 avec sa nièce, Madame Denis, joyeuse veuve de 33 ans, c’est un véritable deuil qu’elle doit opérer. Après les scènes et les larmes, elle pardonne tout. « La certitude et l’impossibilité du retour de son goût et de sa passion […] a amené insensiblement mon cœur au sentiment paisible de l’amitié. » Voltaire écrit à son sujet : « Mme du Châtelet est pour moi plus qu'un père, un frère et un ami. » Est-ce elle qui lui a inspiré ces quelques mots ? « Les femmes ressemblent aux girouettes : elles se fixent quand elles se rouillent », écrit-il quelque part. Et ailleurs : « Le grave magistrat qui a acheté pour quelque argent le droit de faire ces expériences [de torture] sur son prochain va conter à dîner à sa femme ce qui s'est passé le matin. La première fois, madame en a été révoltée ; à la seconde elle y a pris goût, parce qu'après tout, les femmes sont curieuses. Et ensuite, la première chose qu'elle lui a dit lorsqu'il est entré en robe [de magistrat] chez lui : « Mon petit cœur, n'avez-vous fait aujourd'hui donner la question à personne ? » (article « Torture » de l'Encyclopédie)
Durant les premières années du tête à tête de Cirey, ils s'adorent et travaillent beaucoup. Ce sont des « philosophes très voluptueux », dit Voltaire. Lorsqu’il s’éloigne quelques mois en Hollande puis en Prusse (chez le roi Frédéric II), elle se dit malade de chagrin, incapable de survivre à son absence. Mais peu à peu, la passion s’étiole, l’autoritarisme de la marquise reprend ses droits et Voltaire, de dix ans son aîné, est bien loin d’avoir le tempérament de sa compagne. Il prend prétexte de sa santé, elle fait mine de comprendre et d’accepter. Elle veut à tout prix conserver l’illusion que rien n’a changé puisqu’elle aime pour deux. Mais quand elle apprend que Voltaire a une aventure avec la jolie Mlle Gaussin au printemps 1744, puis qu’il entretient une liaison en 1745 avec sa nièce, Madame Denis, joyeuse veuve de 33 ans, c’est un véritable deuil qu’elle doit opérer. Après les scènes et les larmes, elle pardonne tout. « La certitude et l’impossibilité du retour de son goût et de sa passion […] a amené insensiblement mon cœur au sentiment paisible de l’amitié. » Voltaire écrit à son sujet : « Mme du Châtelet est pour moi plus qu'un père, un frère et un ami. » Est-ce elle qui lui a inspiré ces quelques mots ? « Les femmes ressemblent aux girouettes : elles se fixent quand elles se rouillent », écrit-il quelque part. Et ailleurs : « Le grave magistrat qui a acheté pour quelque argent le droit de faire ces expériences [de torture] sur son prochain va conter à dîner à sa femme ce qui s'est passé le matin. La première fois, madame en a été révoltée ; à la seconde elle y a pris goût, parce qu'après tout, les femmes sont curieuses. Et ensuite, la première chose qu'elle lui a dit lorsqu'il est entré en robe [de magistrat] chez lui : « Mon petit cœur, n'avez-vous fait aujourd'hui donner la question à personne ? » (article « Torture » de l'Encyclopédie)
La rupture est impossible avec cet homme devenu son compagnon de vie, dont l’esprit éblouissant la séduit toujours et qui veille sur elle comme nul autre. Voltaire, de son côté, accepte tout : ses tyrannies, ses caprices et ses pérégrinations. Il accepte même Saint-Lambert, non sans une scène de jalousie. Il reste près d’elle jusqu’au dernier jour et ne s’est jamais complètement remis de sa disparition. Madame Denis, qui lui succédera, ne la remplace pas. (Voltaire, Correspondance, 10 septembre 1749). Il affirme aussi : « Je n’ai pas perdu une maîtresse mais la moitié de moi-même. Un esprit pour lequel le mien semblait avoir été fait ». Il défend tout aussi vigoureusement la femme de science : « Un grand homme qui n’avait de défaut que d’être femme, et que tout Paris regrette et honore. On ne lui a pas peut-être rendu justice pendant sa vie. »
Quelques vers de Voltaire sur Émilie
« Cette belle âme est une étoffe
Qu’elle brode en mille façons.
Son esprit est très philosophe
Et son cœur aime les pompons.
J’avouerai qu’elle est tyrannique.
Il faut pour lui faire sa cour,
Lui parler de métaphysique
Quand on voudrait parler d'amour. »
Un poème du même
Une source sérieuse nous apprend que ce poème, qui date de 1741, est inclus dans une lettre de Voltaire à son ami de toujours, Cideville.
À Mme du Châtelet
« Si vous voulez que j'aime encore,
Au crépuscule de mes jours
Rejoignez, s'il se peut, l'aurore.
*
Des beaux lieux où le dieu du vin
Avec l'Amour tient son empire,
Le Temps, qui me prend par la main,
M'avertit que je me retire.
*
De son inflexible rigueur
Tirons au moins quelque avantage.
Qui n'a pas l'esprit de son âge,
De son âge a tout le malheur.
*
Laissons à la belle jeunesse
Ses folâtres emportements.
Nous ne vivons que deux moments :
Qu'il en soit un pour la sagesse.
*
Quoi ! pour toujours vous me fuyez,
Tendresse, illusion, folie,
Dons du ciel, qui me consoliez
Des amertumes de la vie !
*
On meurt deux fois, je le vois bien :
Cesser d'aimer et d'être aimable,
C'est une mort insupportable ;
Cesser de vivre, ce n'est rien.
*
Ainsi je déplorais la perte
Des erreurs de mes premiers ans ;
Et mon âme, aux désirs ouverte,
Regrettait ses égarements.
*
Du ciel alors daignant descendre,
L'Amitié vint à mon secours ;
Elle était peut-être aussi tendre,
Mais moins vive que les Amours.
*
Touché de sa beauté nouvelle,
Et de sa lumière éclairé,
Je la suivis ; mais je pleurai
De ne pouvoir plus suivre qu'elle. »
Sources :
En 2006, on célébra le tricentenaire de sa naissance lors de l'exposition « Madame du Châtelet, La femme des Lumières » (du 7 mars au 3 juin 2006 à la Bibliothèque nationale de France). Le site est sur internet avec de nombreux commentaires d'Élisabeth Badinter. Voir aussi l'ouvrage d'Élisabeth Badinter Émilie, Émilie, l’Ambition féminine au XVIIIe siècle, Paris, Flammarion, 1983.
Remarques
1) L'Essai sur les mœurs est écrit pour Mme du Châtelet.
C’est au château de Cirey que Voltaire commence pour sa compagne un traité philosophique sur l’histoire universelle. Il envisage d’abord d’en faire la préface du Siècle de Louis XIV. Mais cette « préface » s’amplifie et forme bientôt un ouvrage autonome.
L’Essai et Le Siècle sont publiés ensemble à Genève en 1756 ; dans la réédition de 1759, considérablement remaniée, L’Essai prend son titre définitif. Voltaire travaillera plus de quarante ans à ce livre et l’enrichira encore l’année de sa mort, bien après le décès de Mme du Châtelet (en 1749) qui, à sa manière, aura contribué à enrichir la philosophie des Lumières d’une œuvre maîtresse.
2) Poésie légère, fugitive, mélancolique, élégiaque et lyrique... Une autre facette (méconnue) de Voltaire.
Stances à Mme Lullin (1773)
Hé quoi ! vous êtes étonnée
Qu’au bout de quatre-vingts hivers,
Ma Muse faible et surannée
Puisse encor fredonner des vers ?
*
Quelquefois un peu de verdure
Rit sous les glaçons de nos champs ;
Elle console la nature,
Mais elle sèche en peu de temps.
*
Un oiseau peut se faire entendre
Après la saison des beaux jours ;
Mais sa voix n’a plus rien de tendre,
Il ne chante plus ses amours.
*
Ainsi je touche encor ma lyre,
Qui n’obéit plus à mes doigts ;
Ainsi j’essaie encor ma voix
Au moment même qu’elle expire.
*
« Je veux dans mes derniers adieux,
Disait Tibulle [1] à son amante,
Attacher mes yeux sur tes yeux,
Te presser de ma main mourante. »
*
Mais quand on sent qu’on va passer,
Quand l’âme fuit avec la vie,
A-t-on des yeux pour voir Délie [2],
Et des mains pour la caresser ?
*
Dans ce moment chacun oublie
Tout ce qu’il a fait en santé.
Quel mortel s’est jamais flatté
D’un rendez-vous à l’agonie !
*
Délie elle-même, à son tour,
S’en va dans la nuit éternelle,
En oubliant qu’elle fut belle,
Et qu’elle a vécu pour l’amour.
*
Nous naissons, nous vivons, bergère,
Nous mourons sans savoir comment ;
Chacun est parti du néant :
Où va-t-il ?… Dieu le sait, ma chère.
_ _ _
Notes
[1] Poète latin, auteur d’Élégies.
[2] Amante de Tibulle.
Extraits du Discours sur le bonheur (Mme du Châtelet)
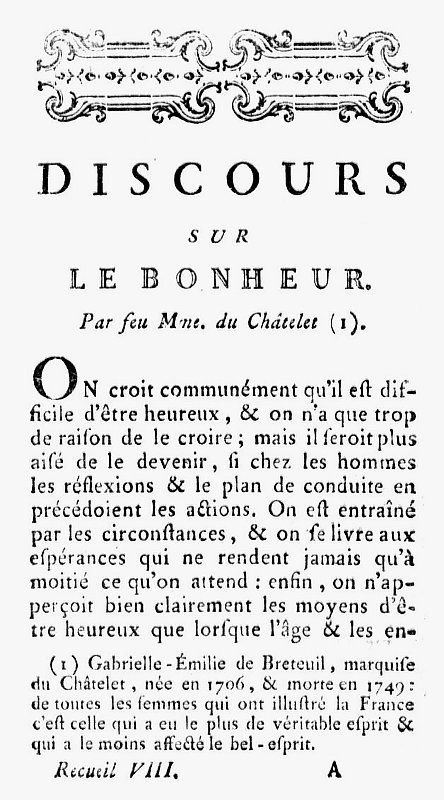 On sait que la notion de bonheur interroge le siècle. Mme du Châtelet, amie de Voltaire et physicienne émérite, réfléchit ici sur le bonheur.
On sait que la notion de bonheur interroge le siècle. Mme du Châtelet, amie de Voltaire et physicienne émérite, réfléchit ici sur le bonheur.
« Les malheureux sont connus parce qu’ils ont besoin des autres, qu’ils aiment à raconter leurs malheurs, qu’ils y cherchent des remèdes et du soulagement. Les gens heureux ne cherchent rien, et ne vont point avertir les autres de leur bonheur ; les malheureux sont intéressants, les gens heureux sont inconnus. […]
Je crois qu’une des choses qui contribuent le plus au bonheur, c’est de se contenter de son état, et de songer plutôt à le rendre heureux qu’à en changer. […]
Une autre source de bonheur, c’est d’être exempt de préjugés […], examiner les choses qu’on veut nous obliger de croire. […]
Je dis qu’on ne peut être heureux et vicieux, et la démonstration de cet axiome est dans le fond du cœur de tous les hommes. Je leur soutiens, même aux plus scélérats, qu’il n’y en a aucun à qui les reproches de sa conscience, c’est-à-dire, de son sentiment intérieur, le mépris qu’il sent qu’il mérite et qu’il éprouve, dès qu’on le connaît, ne tienne lieu de supplice. Je n’entends pas par scélérat les voleurs, les assassins, les empoisonneurs, ils ne peuvent se trouver dans la classe de ceux pour qui j’écris ; mais je donne ce nom aux gens faux et perfides, aux calomniateurs, aux délateurs, aux ingrats, enfin à tous ceux qui sont atteints des vices contre lesquels les lois n’ont point sévi, mais contre lesquels celles des mœurs et de la société ont porté des arrêts d’autant plus terribles, qu’ils sont toujours exécutés. Je maintiens donc qu’il n’y a personne sur la terre qui puisse sentir qu’on la méprise, sans désespoir. Ce mépris public, cette animadversion des gens de bien est un supplice plus cruel que tous ceux que le lieutenant - criminel pourrait infliger, parce qu’il dure plus longtemps, et que l’espérance ne l’accompagne jamais. […]
Être bien décidé à ce qu’on veut être et à ce qu’on veut faire, et c’est ce qui manque à presque tous les hommes ; c’est pourtant la condition sans laquelle il n’y a point de bonheur. Sans elle, on nage perpétuellement dans une mer d’incertitudes ; on détruit le matin ce qu’on a fait le soir ; on passe la vie à faire des sottises, à les réparer, à s’en repentir. Ce sentiment de repentir est un des plus inutiles […], il faut toujours écarter de son esprit le souvenir de ses fautes. […]
Qui dit sage dit heureux […]
Il est certain que l’amour de l’étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu’à celui des femmes. Les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux qui manquent entièrement aux femmes. Ils ont bien d’autres moyens d’arriver à la gloire et il est sûr que l’ambition de rendre ses talents utiles à son pays et de servir ses concitoyens, soit pas son habileté dans l’art de la guerre, ou par ses talents pour le gouvernement, ou par les négociations, est fort au-dessus de celle qu’on peut se proposer pour l’étude; mais les femmes sont exclues, par leur état, de toute espèce de gloire, et quand, par hasard, il s’en trouve quelqu’une qui est née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l’étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état. […]
Aimer ce qu’on possède, savoir en jouir, savourer les avantages de son état, ne point trop porter sa vue sur ceux qui nous paraissent plus heureux, s’appliquer à perfectionner le sien et à en tirer le meilleur parti possible, voilà ce qu’on doit appeler heureux […]. Pour jouir de ce bonheur, il faut guérir [de] l’inquiétude. […]
Notre âme veut être remuée par l’espérance ou la crainte ; elle n’est heureuse que par les choses qui lui font sentir son existence. Or, le jeu nous met perpétuellement aux prises avec ces deux passions, et tient, par conséquent, notre âme dans une émotion qui est un des grands principes du bonheur qui soient en nous. Le plaisir que m’a fait le jeu, a servi souvent à me consoler de n’être pas riche. […]
Plus notre bonheur dépend de nous, et plus il est assuré ; et cependant la passion qui peut nous donner de plus grands plaisirs et nous rendre le plus heureux, met entièrement notre bonheur dans la dépendance des autres : on voit bien que je veux parler de l’amour. […]
Nous nous figurons que nous rattraperons le bien [l’amour] que nous avons perdu, à force de courir après ; mais l’expérience et la connaissance du cœur humain nous apprennent que plus nous courons après et plus il nous fuit. […]
Le grand secret pour que l’amour ne nous rende pas malheureux, c’est de tâcher de n’avoir jamais tort avec votre amant, de ne lui jamais montrer d’empressement quand il se refroidit, et d’être toujours d’un degré plus froide que lui ; cela ne le ramènera pas, mais rien ne le ramènerait : il n’y a rien à faire qu’à oublier quelqu’un qui cesse de nous aimer. »
Émilie Du Châtelet, Discours sur le bonheur, Éd. Robert Mauzi, Paris, Les Belles Lettres, 1961
(p. 5, 7, 11, 12-13, 16-17, 19, 21, 24-25, 26, 27, 34, 35-36)
Extrait commenté
Extrait
« II faut commencer par se bien dire à soi-même et par se bien convaincre que nous n'avons rien à faire dans ce monde qu'à nous y procurer des sensations et des sentiments agréables. Les moralistes qui disent aux hommes : réprimez vos passions, et maîtrisez vos désirs, si vous voulez être heureux, ne connaissent pas le chemin du bonheur. On n'est heureux que par des goûts et des passions satisfaites ; je dis des goûts, parce qu'on n'est pas toujours assez heureux pour avoir des passions, et qu'au défaut des passions, il faut bien se contenter des goûts. Ce serait donc des passions qu'il faudrait demander à Dieu, si on osait lui demander quelque chose [...].
Mais supposons, pour un moment, que les passions fassent plus de malheureux que d’heureux, je dis qu’elles seraient encore à désirer, parce que c’est la condition sans laquelle on ne peut avoir de grands plaisirs ; or, ce n’est la peine de vivre que pour avoir des sensations et des sentiments agréables ; et plus les sentiments agréables sont vifs plus on est heureux. Il est donc à désirer d’être susceptible de passions, et je le répète encore : n’en a pas qui veut. »
On peut réfléchir sur les points suivants :
- organisation des idées, arguments et exemples ?
- se demander d’abord quelle est la thèse soutenue par Mme du Châtelet.
- s'interroger sur les marques de l’énonciation dans la présentation des idées.
- deux paragraphes => à quelles objections répond Mme du Châtelet dans chacun ?
- comment sa thèse est-elle nuancée dans le premier ?
- quelles sont les étapes du raisonnement dans le second paragraphe ? (voir les connecteurs logiques).
Les Femmes et la science (Robert Chazal)
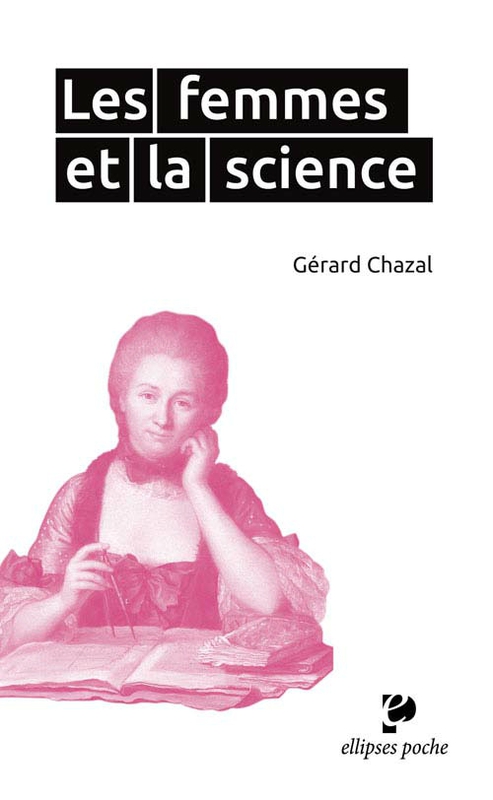 Présentation de l’éditeur
Présentation de l’éditeur
« L’auteur montre qu’il a existé une véritable discrimination vis-à-vis des femmes quant à la possibilité qu’elles participent à la constitution des savoirs. Pire, il y eut dans l’histoire de très grandes figures de femmes scientifiques trop souvent occultées. Elles ont ajouté à leur génie de savantes le courage de leur lutte pour s’imposer dans un monde masculin des sciences.
Depuis Hypatie assassinée sur les pavés d’Alexandrie par les fanatiques chrétiens à Lise Meitner injustement privée de prix Nobel, en passant par la Marquise du Châtelet et Marie Curie, ce livre rend justice aux femmes en sciences.
En astronomie, en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, en médecine, elles ont été sur tous les fronts de la recherche, pionnières dont il est peut-être temps de sortir les noms de l’oubli en rappelant ce que furent leur vie, leurs combats et leur succès. »
Pour le seul 18e siècle :
* Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet (1706-1749)
* Laura Bassi (1711-1778) à l’université de Bologne
* Maria Agnesi (1718-1799), mathématicienne érudite
* Sophie Germain (1776-1831), sous le nom de Monsieur Le Blanc
* Marie-Anne Paulze Lavoisier (1758-1836)
* et d'autres...
* * *
Le château de Cirey
 Le château est au cœur du village aux confins de la Lorraine, ses grilles s’ouvrant sur la rue principale. Une allée grimpe jusqu’à la cour d’honneur. Mme du Châtelet reste à Paris mais propose sa demeure quelque peu délabrée à Voltaire, condamnée à fuir après la publication ses Lettres philosophiques (dites aussi Lettres anglaises). À ses frais, Voltaire agrandit et modernise le château : aux briques et aux pierres du 17e siècle, il ajoute une longue galerie et une porte d’honneur sculptée. Il fait inscrire sur le fronton cette devise : « Deus nobis jaec otia fecit » (« Un dieu a créé pour nous ces lieux de paix. »). Mme du Châtelet le rejoint en mai 1735. Étude, réflexion philosophique, conversation, théâtre (scène aménagée dans les combles) et traduction de Newton pour la marquise. Vie frénétique, trois à quatre heures de sommeil. Selon Mme de Graffigny, la maison est mal tenue. La chambre d’Émilie, bleue et jaune, donne sur un canal.
Le château est au cœur du village aux confins de la Lorraine, ses grilles s’ouvrant sur la rue principale. Une allée grimpe jusqu’à la cour d’honneur. Mme du Châtelet reste à Paris mais propose sa demeure quelque peu délabrée à Voltaire, condamnée à fuir après la publication ses Lettres philosophiques (dites aussi Lettres anglaises). À ses frais, Voltaire agrandit et modernise le château : aux briques et aux pierres du 17e siècle, il ajoute une longue galerie et une porte d’honneur sculptée. Il fait inscrire sur le fronton cette devise : « Deus nobis jaec otia fecit » (« Un dieu a créé pour nous ces lieux de paix. »). Mme du Châtelet le rejoint en mai 1735. Étude, réflexion philosophique, conversation, théâtre (scène aménagée dans les combles) et traduction de Newton pour la marquise. Vie frénétique, trois à quatre heures de sommeil. Selon Mme de Graffigny, la maison est mal tenue. La chambre d’Émilie, bleue et jaune, donne sur un canal.
https://www.chateaudecirey.com/
* * *
Date de dernière mise à jour : 21/03/2021