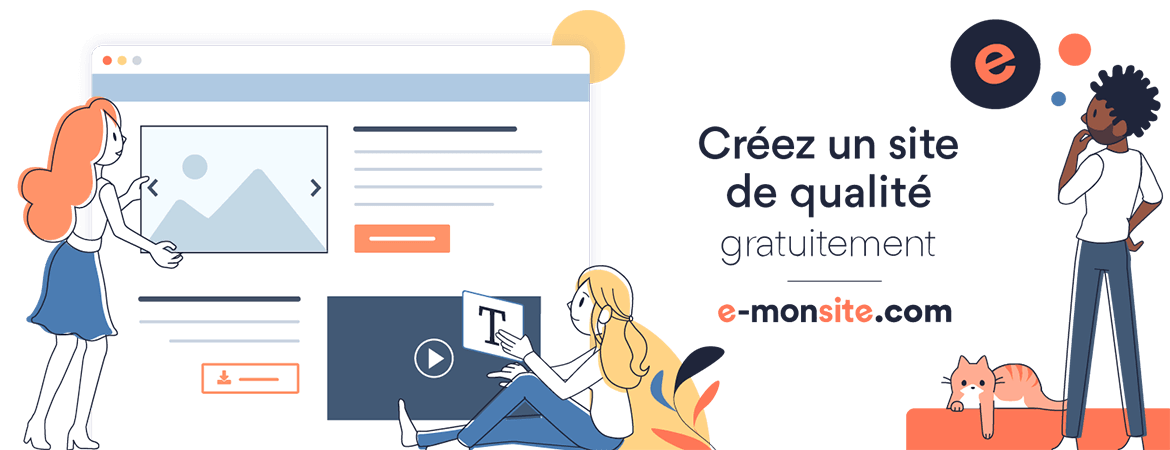A la cour
On a célébré à satiété ce siècle comme celui de la « douceur de vivre », au point que la baronne d'Oberkirch, de noblesse alsacienne, ne voulut point continuer ses Mémoires au-delà de 1789. Une douceur de vivre fondée sur un certain apprentissage.
De 1701 à 1789 en effet, les traités d'éducation occupent une place croissante. Tout traité d'éducation moderne aborde la question de la lecture, dressant parfois la bibliothèque idéale, et le noble français va peu à peu apprivoiser les livres car la maîtrise de la parole - et de la politesse - passe par l'étude : on ne peut pas vivre correctement dans le monde sans s'y être préparé dans les livres et chez les auteurs éprouvés, selon la recommandation de Sénèque à Lucilius. La bienséance est l'adéquation des paroles et des gestes à la fois au lieu, au temps, aux personnes et à son propre état. Madame de Genlis, qui éleva les enfants du duc d'Orléans, nous explique les usages du monde : « L'élégance des manières, la noblesse et la pureté de langage, la connaissance des égards ou du respect que l'on doit avoir, dans le grand monde, pour les gens qu'on y rencontre, suivent le mérite personnel, le nom, l'âge, le rang, enfin, toute la bienséance et les grâces sociales font la politesse. »
En 1684 parut L'Homme de Cour, une traduction par Amédée de la Houssaye du jésuite espagnol Baltasar Gracien. On y lit par exemple : « Il n'y a rien qui rende si poli que le savoir » mais sans l'intervention de l'art, celui-ci reste sans effet et « la science reste grossière. » Cet art est celui que l'on acquiert par « le commerce de la vie » : « Savoir vivre est aujourd'hui le vrai savoir. » La galanterie est un je-ne-sais-quoi acquis à force de travail et de composition de soi car « parler où il y a un grand naturel, l'artificiel y réussit encore mieux. » Mais il ne faut pas confondre artificiel et affectation.
La conversation est un test car la langue est le fond de l'âme. La cour est ainsi « le plus délicat endroit de commerce du monde » car les rencontres qu'on y fait apprennent l'art de converser, dont le moindre n'est pas celui des « pointes ». Dans la vie sociale, les choses ne passent point pour ce qu'elles sont mais pour ce dont elles ont l'apparence.
Mais il faut avant tout et bien entendu être « né » ; une naissance noble donne un corps harmonieux et bien développé. Le « port et la mine » annoncent le mérite et les grâces, nous dit Nicolas Faret dans L'Honnête Homme ou l'art de réussir à la Cour.
L'éducation du futur courtisan est un équilibre entre les humanités, les mathématiques et la maîtrise des arts d'agréments que sont la danse, la musique et la poésie.
On le voit, c'est l'éducation des apparences car la cour s'apprend : il s'agit d'être « de Versailles ». D'où l'importance du vêtement et les édits « somptuaires » des 16e et 17e siècles qui tentaient de réserver le luxe vestimentaire à une élite aristocratique. Nous savons que Louis XVI prendra sciemment l'exact contre-pied.
Il y a trois sujets à risque en public : la politique, les personnalités et les charges. La vertu cardinale est la complaisance qui consiste à savoir ménager son interlocuteur et éviter la médisance.
On croit aussi aux vertus de l'amitié, alliance temporaire d'intérêts convergents : il ne s'agit point de sentiment. Il ne s'agit pas pour autant d'y voir hypocrisie ou cynisme mais simple échange de bons offices qui maintient une certaine cohésion. Il faut donc posséder l'art de tisser des réseaux, se ménager la connaissance de « domestiques » de confiance, la protection d'un valet par une femme par exemple n'impliquant pas nécessairement une liaison. Par contre, on remarque un lien entre la noblesse de cour, sa domesticité et les librairies clandestines : c'est le siècle des rumeurs… Bref, il s'agit de mener une carrière habilement conduite. Si l'on veut quitter sa charge et se retirer, l'autorisation du roi est indispensable.
Qu’est-ce que l’esprit ?
La douceur des manières ne supplée pas à l'esprit, autre fondement de la sociabilité. « Le sot de la Cour dit ses sottises plus élégamment que le sot de la Ville ne dit les siennes » écrit Duclos en 1751. Ce talent est en fait une nécessité : le courtisan est en effet condamné à bien parler parce que c'est la seule liberté qui lui est laissé. « Ainsi, continue Duclos, les tours se multiplient et les idées se rétrécissent. » Du moins à la Cour car à Paris, différents salons sont le règne du goût, de la confiance et de la liberté.
Cette frivolité de la cour garantit étrangement l'ordre social et politique alors que les philosophes ont opéré une confusion des genres en ayant introduit la légèreté dans un domaine où elle n'était pas de mise : ils faisaient de sujets graves un « délassement d'esprit » et de la « gaieté pleine de finesse » une arme, dit encore Madame de Genlis. D'où la subversion des légitimités.
Il fallait connaître la géographie et les contours de cet usage du monde et donc lire le Mercure et la Gazette de France notamment qui diffusaient des informations mondaines ; on lisait aussi les nouvelles à la main et l'on prenait du temps à faire sa correspondance. Dans sa Correspondance, Luynes relate les funérailles importantes comme celles du chancelier d'Aguesseau. L'usage du monde s'accommodait volontiers de quelques talents, ceux que l'on appelait justement « de société » mais l'étalage de talents plus particuliers et, disons-le, de véritable intelligence, était de mauvais goût, on ne le souffrait pas très longtemps.
Pauvres femmes !
Citons ici les Mémoires de la duchesse de Brancas :
« Dans ce temps, une jeune femme de la cour ne manquait guère de se donner une certaine considération en recevant les assiduités des courtisans distingués par les bontés du roi, et que leur âge rendait plus capables de soins que d'entreprise. La duchesse de Tallart disait qu'il fallait en passer par là : c'était établi. Avait-on environ trente ans, formé par conséquent quelques liaisons plus intimes, enfin était-on parvenu à être quelque chose, parce qu'on était de tout, c'est à dire des soupers, bals, spectacles, voyages, on commençait à vivre un peu pour soi ; et les vieux courtisans vous priaient de traiter avec bonté les jeunes gens qui leur appartenaient. Mais quand on avait poussé cette vie aussi loin qu'elle pouvait aller, et qu'il fallait s'apercevoir qu'à aller encore partout on commençait partout à n'être de rien ; qu'enfin les cérémonies avec lesquelles vous étiez reçue, les compliments qu'on vous faisait, les égards dont vous ne pouviez pas vous défendre, vous avertissaient que, pour rester à la cour, il fallait pourtant quitter le monde, et que, si vous pouviez remplir votre place à Versailles, y faire votre devoir, y vivre enfin, il ne fallait pas moins renoncer à sa vie, il n'y avait pas d'autre parti à prendre que de se faire dévote, en attendant qu'on le devînt peut-être. On n'allait presque plus à la comédie mais on allait au sermon. On voyait beaucoup moins les gens qui quittaient le théâtre de la cour que pour celui de Molière, mais on était remarquée par ceux qui suivaient le roi à la chapelle. »
Sources : Louis XV et sa cour, Bernard Hours, P.U.F. 2002.
* * *