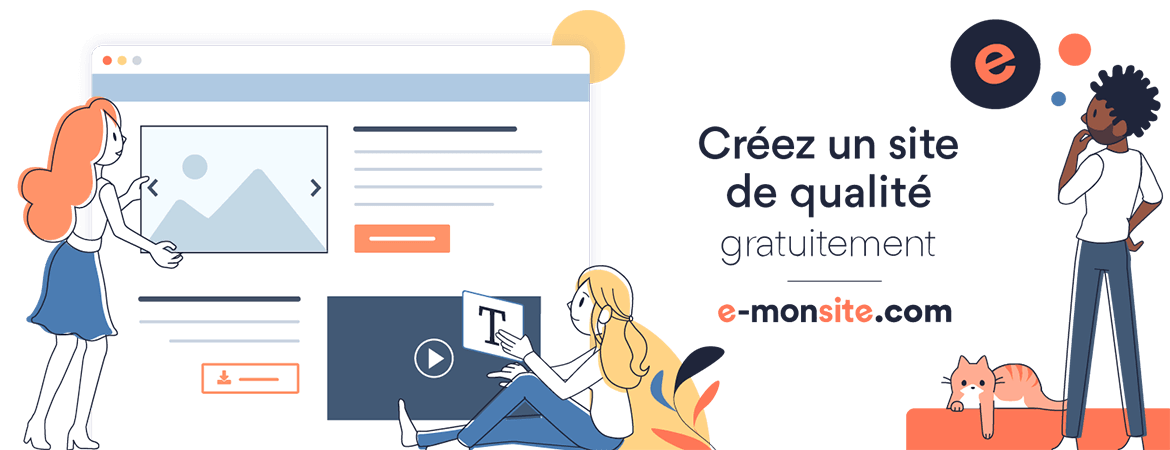Elisabeth de Bohême et Descartes
Mais qui est donc Elisabeth de Bohême ?
Élisabeth, princesse Palatine, naît le 28 décembre 1618, à Heidelberg (famille de Madame, belle-sœur de Louis XIV). Elle est la fille de l’électeur Frédéric, dont l’élection au trône de Bohème déclenchera en Allemagne la Guerre de Trente ans. En 1620, chassée de Bohême après la défaite de la Montagne Blanche, Élisabeth et sa famille s’exilent et se réfugient à La Haye. Frédéric V, « roi d’un hiver », meurt en 1632. Fin 1642, Pollot (ou Pallot), ami et correspondant de Descartes, les met en relation. Leur correspondance commence en 1643. En Juillet 1644, il publie à Amsterdam ses Principia Philosophiae [publiés à Paris à la fin de l’été 1647, avec une traduction de l’abbé Picot], dédiés à la princesse Élisabeth. En 1645-1646, sur sa demande, il entreprend un traité sur la passion de l’âme. En 1648, les traités de Westphalie mettent fin à la Guerre de Trente Ans. Charles-Louis, frère de la princesse Élisabeth, est rétabli comme électeur dans le Palatinat du Rhin et sa sœur le suit quelque temps à Heidelberg. Le 9 février 1649, Charles 1er roi d’Angleterre, oncle d’Élisabeth, est décapité à Londres à la suite de la guerre civile. Élisabeth, de confession calviniste, finira sa vie dans son abbaye d’Herford, en Westphalie. Sa sœur Sophie, née en 1630, sert d’intermédiaire dans la correspondance entre Élisabeth et Descartes. Elle épouse l’électeur de Hanovre, entretient une correspondance avec Leibniz… et avec notre princesse Palatine (belle-sœur de Louis XIV) et, seule descendante de Jacques 1er, transmettra à son fils George le trône d’Angleterre où il montera en 1714 et fondera l’actuelle dynastie.
Présentation de la correspondance entre Descartes et Élisabeth de Bohême
Les lettres échangées entre 1643 et 1649 constituent un genre spécifique, à l'origine du traité des Passions de l'âme.
Élisabeth de Bohême est plus jeune que lui mais il existe entre eux certaines affinités électives. Elle vit réfugiée avec ses parents en Hollande et l’exil a mûri la jeune fille. Sa grâce, ses vertus et son intelligence exceptionnelle retiennent Descartes. Au-delà de l’érudition, Descartes cherche des correspondants non-professionnels et il désire se faire entendre de tous, même des femmes. Du reste, il lui dédie ses Principes parus en 1644 : « À la sérénissime princesse Élisabeth, première fille de Frédéric, roi de Bohême, comte Palatin et prince-électeur de l’Empire ».
Les lettres sont en français, traversé de latinismes et d’incorrections sans doute mais d’une grande fluidité.
Les deux voix alternent : Descartes reprend, pour y répondre, la première suggestion venue d’Élisabeth « en un style si déréglé », d’une « personne ignorante et indocile » (lettre d’Élisabeth du 16 mai 1643). Grâce à elle, il approfondit, reprend et corrige sa doctrine : « Je me suis mal expliqué en mes précédentes » écrit-il dans la lettre du 28 juin 1643. En somme, elle lui fait toucher du doigt quelques lacunes et défaillances dans ses Principes philosophiques.
Nouveau traité donc que ces Passions de l’âme, auquel il ajoute une nouvelle étude de « toute la nature de l’homme ».
Considérations philosophiques et communications personnelles émaillent leur correspondance : Descartes agit en mathématicien, philosophe et conseiller en matière médicale et diplomatique. De privé, la correspondance devient publique. Si Élisabeth souhaite au début qu’il brûle ses lettres, la correspondance évolue et Descartes lui écrit le 21 mai 1643 : « Votre Altesse ne m’a rien communiqué qui ne mérite d’être vu et admiré de tous les hommes. »
Sources : Introduction de Jean-Marie Beyssade à la Correspondance avec Élisabeth et autres lettres (Flammarion, 1989).
Je n'insère ici que les lettres (sous forme d'extraits) de la jeune femme car je trouve tout à fait passionnant que la gent féminine du 17e siècle puisse s'exprimer et surtout penser ainsi.
Lettres d'Élisabeth de Bohême à Descartes (extraits)
* Lettre du 16 mai 1643
« … vous priant de me dire comment l’âme de l’homme peut déterminer les esprits du corps, pour faire les actions volontaires (n’étant qu’une substance pensante). Car il semble que toute détermination de mouvement se fait par la pulsion de la chose mue, à manière dont elle est poussée par celle qui la meut, ou bien de la qualification et figure de la superficie de cette dernière. L’attouchement est requis aux deux premières conditions et l’extension à la troisième. Vous excluez entièrement celle-ci de la notion que vous avez de l’âme et celui-là me paraît incompatible avec une chose immatérielle. Pourquoi je vous demande une définition plus particulière qu’en votre Métaphysique, c’est-à-dire de sa substance, séparée de son action, de la pensée. Car encore que nous le supposions inséparables (qui toutefois est difficile à prouver dans le ventre de la mère et les grands évanouissements), comme les attributs de Dieu, nous pouvons, en les considérant à part, en acquérir une idée plus parfaite… »
* Lettre du 20 juin 1643
« … ma stupidité de ne pouvoir comprendre l’idée par laquelle nous devons juger comment l’âme (non étendue et immatérielle) peut mouvoir le corps, par celle que vous avez eu autrefois de la pesanteur ; ni pourquoi cette puissance, que vous lui avez alors, sous le nom d’une qualité, faussement attribuée, de porter le corps vers le centre de la terre, nous doit plutôt persuader qu’un corps peut-être poussé par quelque chose d’immatériel que la démonstration d’une vérité contraire (que vous promettez en votre physique) nous confirmer dans l’opinion de son impossibilité : principalement, puisque cette idée (ne pouvant prétendre à la même perfection et réalité objective que celle de Dieu) peut être feinte par l’ignorance de ce qui véritablement meut ces corps vers le centre. Et puisque nulle cause matérielle ne se présentait aux sens on l’aurait attribué à son contraire, l’immatériel, ce que néanmoins, je n’ai jamais pu concevoir que comme une négation de la matière, qui ne peut avoir aucune communication avec elle.
Et j’avoue qu’il me serait plus facile de concéder la matière et l’extension à l’âme, que la capacité de mouvoir un corps et d’en être ému, à un être immatériel. Car, si le premier se faisait par information, il faudrait que les esprits, qui font le mouvement, fussent intelligents, ce que vous n’accordez à rien de corporel. Et encore qu’en vos Méditations métaphysiques, vous montrez la possibilité du second, il est pourtant très difficile à comprendre qu’une âme, comme vous l’avez décrite, après avoir eu la faculté et habitude de bien raisonner, peut perdre tout cela par quelques vapeurs, et que, pouvant subsister sans le corps et n’ayant rien de commun avec lui, elle en soit tellement régie… »
* Lettre du 1er juillet 1643
« … Je trouve aussi que les sens me montrent que l’âme meut le corps, mais ne m’enseignent point (non plus que l’entendement et l’imagination) la façon dont elle le fait. Et, pour cela, je pense qu’il y a des propriétés de l’âme, qui nous sont inconnues, qui pourront peut-être renverser ce que vos Méditations Métaphysiques m’ont persuadée, par de si bonnes raisons, de l’inextension de l’âme. Et ce doute semble être fond sur la règle que vous y donnez, en parlant du vrai et du faux, et que toute l’erreur nous vient de former des jugements de ce que nous ne percevons assez. Quoique l’extension n’est nécessaire à la pensée, n’y répugnant point, elle pourra duire [convenir] à quelque autre fonction de l’âme, qui ne lui est moins essentielle. Du moins elle fait choir la contradiction des Scolastiques, qu’elle est toute en tout le corps, et toute en chacune de ses parties. Je ne m’excuse point de confondre la notion de l’âme avec celle du corps par la même raison que le vulgaire ; mais cela ne m’ôte point le premier doute, et je désespèrerai de trouver de la certitude en chose du monde, si vous ne m’en donnez, qui m’avez seul empêchée d’être sceptique, à quoi mon premier raisonnement me portait…»
* Lettre datée d’août 1645
« … sans la dernière [lettre], je n’aurais pas si bien entendu ce que Sénèque juge de la béatitude, comme je crois le faire maintenant. J’ai attribué l’obscurité qui se trouve audit livre, comme en la plupart des anciens, à la façon de s’expliquer, toute différente de la nôtre, de ce que les mêmes choses, qui sont problématiques parmi nous, pouvaient passer pour hypothèses entre eux ; et le peu de connexion et d‘ordre qu’il observe, au dessein de s’acquérir des admirateurs, en surprenant l’imagination, plutôt que des disciples, en informant le jugement ; que Sénèque se servait de bons mots, comme les autres de poésies et de fables, pour attirer la jeunesse à suivre son opinion. La façon dont il réfute celle d’Épicure, semble appuyer ce sentiment. Il confesse dudit philosophe : « Ce dont nous disons qu’il fait loi pour la vertu, lui dit qu’il le fait pour le plaisir (1). » Et, un peu devant, il dit au nom de ses sectateurs : « Je soutiens en effet qu’on ne saurait vivre agréablement sans vivre aussi, en même temps, honnêtement (2). » D’où il paraît clairement, qu’ils donnaient le nom de volupté à la joie et satisfaction de l’esprit, que celui-ci appelle consequanti summum bonum (3). Et néanmoins, dans tout le reste du livre, il parle de cette volupté épicurienne plus en satire qu’en philosophe, comme si elle était purement sensuelle. Mais je lui en veux beaucoup de bien, depuis que cela est cause que vous avez pris le soin d’expliquer leurs opinions et réconcilier leurs différends, mieux qu’ils n’auraient su faire, et d’ôter par là une puissante objection contre la recherche de ce souverain bien que pas un de ces grands esprits n’ont pu définir, et contre l‘autorité de la raison humaine, puisqu’elle n’a point éclairé ces excellents personnages en la connaissance de ce qui leur était le plus nécessaire et le plus à cœur. J’espère que vous continuerez, de ce que Sénèque a dit, ou de ce qu’il devait dire, à m’enseigner les moyens de fortifier l’entendement, pour juger du meilleur en toutes les actions de la vie, qui me semble être la seule difficulté, puisqu’il est impossible de ne point suivre le bon chemin, quand il est connu… »
* Lettre du 13 septembre 1645
«… Il est vrai qu’une habitude d’estimer les biens selon qu’ils peuvent contribuer au contentement, de mesurer ce contentement selon les perfections qui font naître les plaisirs, et de juger sans passion de ces perfections et de ces plaisirs, les [les personnes gouvernant le public] garantira de quantité de fautes. Mais, pour estimer ainsi les biens, il faut les connaître parfaitement ; et pour connaître tous ceux dont on est contraint de faire choix dans une vie active, il faudrait posséder une science infinie. Vous direz qu’on ne laisse pas d’être satisfait quand la conscience témoigne qu’on s’est servi de toutes les précautions possibles. Mais cela n’arrive jamais, lorsqu’on ne trouve point son compte. Car on se ravise toujours de choses qui restaient à considérer. Pour mesurer le contentement selon la perfection qui le cause, il faudrait voir clairement la valeur de chacune, si celles qui ne servent qu’à nous, ou celles qui nous rendent encore utiles aux autres, sont préférables. Ceux-ci semblent être estimés avec excès d’une humeur qui se tourmente pour autrui, et ceux-là, de celui qui ne vit que pour soi-même. Et néanmoins chacun d’eux appuie son inclination de raisons assez fortes pour la faire continuer toute sa vie. Il est ainsi des autres perfections du corps et de l’esprit, qu’un sentiment tacite fait approuver à la raison, qui ne se doit appeler passion, parce qu’il est né avec nous. Dites-moi donc, s’il vous plaît, jusqu’où il le faut suivre (étant un don de nature), et comment le corriger.
Je vous voudrais encore voir définir les passions, pour les bien connaître ; car ceux qui les nomment perturbations de l’âme, me persuaderaient que leur force ne consiste qu’à éblouir et soumettre la raison, si l’expérience ne me montrait qu’il y en a qui nous portent aux actions raisonnables. Mais je m’assure que vous m’y donnerez plus de lumière, quand vous expliquerez comment la force des passions les rend d’autant plus utiles, lorsqu’elles sont sujettes à la raison… »
Lettre du 30 septembre 1645
« … Celle [la connaissance] de l’existence de Dieu et de ses attributs nous peut consoler des malheurs qui nous viennent du cours ordinaire de la nature et de l’ordre qu’il y a établi, comme de perdre le bien par l’orage, la santé par l’infection de l’air, les amis par la mort ; ais non pas de ceux qui nous sont imposés des hommes, dont l‘arbitre nous paraît entièrement libre, n’y ayant que la fois seule qui nous puisse persuader que Dieu prend le soin de régir les volontés, et qu’il a déterminé la fortune de chaque personne avant la création du monde.
L’immortalité de l’âme, et de savoir qu’elle est de beaucoup plus noble que le corps, est capable de nous faire chercher la mort, aussi bien que la mépriser, puisqu’on ne saurait douter que nous vivrons plus heureusement, exempts de maladies et passions du corps. Et je m’étonne que ceux qui se disaient persuadés de cette vérité et vivaient sans la loi révélée, préféraient une vie pénible à une mort avantageuse.
La grande étendue de l’univers, que vous avez montrée au troisième livre de vos principes, sert à détacher nos affections de ce que nous en voyons ; mais elle sépare aussi cette providence particulière, qui est le fondement de la théologie, de l’idée que nous avons de Dieu.
La considération que nous sommes une partie du tout, dont nous devons chercher l’avantage, est bien la source de toutes le actions généreuses ; mais je trouve beaucoup de difficultés aux conditions que vous leur prescrivez. Comment mesurer les maux qu’on se donne pour le public, contre le bien qui en arrivera, sans qu’ils nous paraissent plus grands, d’autant que leur idée est plus distincte. Et quelle règle aurons-nous pour la comparaison des choses qui ne sous point également connues, comme notre mérite propre et celui de ceux avec qui nous vivons ? Un naturel arrogant fera toujours pencher la balance de son coté, et un modeste s’estimera mois qu’il vaut.
Pour profiter des vérités particulières dont vous parlez, il faut connaître exactement toutes ces passions et toutes ces préoccupations, dont la plupart sont insensibles. En observant les mœurs des pays où nous sommes, nous en trouvons quelquefois de fort déraisonnables, qu’il est nécessaire de suivre pour éviter de plus grands inconvénients.
Depuis que je suis ici (4), j’en fais une épreuve bien fâcheuse ; car j’espérais profiter du séjour des champs, au temps que j’emploierais à l’étude et j’y rencontre, sans comparaison, moins de loisir que je n‘avais à La Haye, par les diversions de ceux qui ne savent que faire ; et quoi qu’il soit très injuste de me priver de biens réels, pour leur en donner d’imaginaires, je suis contrainte de céder aux lois impertinentes de la civilité qui sont établies, pour ne m’acquérir point d’ennemis… »
* Lettre du 28 octobre 1645
« Après avoir donné de si bonnes raisons, pour montrer qu’il vaut mieux connaître des vérités à notre désavantage, que se tromper agréablement, et qu’il n’y a que les choses qui admettent diverses considérations également vraies, qui nous doivent obliger de nous arrêter à celle qui nous apportera plus de contentement, je m’étonne que vous voulez que je me compare à ceux de mon âge (5), plutôt ne chose qui m’est inconnue qu’en ce que je ne saurais ignorer, encore que celle-là soit plus à mon avantage. Il n’y a rien qui me puisse éclaircir si j’ai profité davantage, à cultiver ma raison, que d’autres n’ont fait aux choses qu’ils affectaient, et je ne doute nullement qu’avec le temps de relâche que mon corps requérait, il ne m’en soit resté encore pour avancer au-delà de ce que je suis. En mesurant la portée de l’esprit humain par l’exemple du commun des hommes, elle se trouverait de bien petite étendue, parce que la plupart ne se servent de la pensée qu’au regard des sens. Même de ceux qui s’appliquent à l’étude, il y en a peu qui y emploient autre chose que la mémoire, ou qui aient la vérité pour but de leur labeur. Que s’il y a du vice à ne me plaire point de considérer si j’ai plus gagné que ces personnes, je ne crois pas que c’est l’excès d’humilité qui est aussi nuisible que la présomption, mais non pas si ordinaire. Nous sommes plus enclins à méconnaître nos défauts, que nos perfections. Et en fuyant le repentir des fautes commises, comme un ennemi de la félicité, on pourrait courir hasard de perdre l’envie de s’en corriger, principalement quand quelque passion les a produites, puisque nous aimons naturellement d’en être émus, et d’en suivre les mouvements ; il n’y a que les incommodités procédant de cette suite, qui nous apprennent qu’elles peuvent être nuisibles. Et c’est, à mon jugement, ce qui fait que les tragédies plaisent d’autant plus, qu’elles excitent plus de tristesse, parce que nous connaissons qu’elle ne sera point assez violente pour nous porter à des extravagances, ni assez durable pour corrompre la santé.
Mais cela ne suffit point, pour appuyer la doctrine contenue dans une de vos précédentes, que les passions sont d’autant plus utiles, qu’elles penchent plus vers l’excès, lorsqu’elles sont soumises à la raison, parce qu’il semble qu’elles ne peuvent point être excessives et soumises. […]
Je ne suis point persuadée, par les raisons qui prouvent l’existence de Dieu, et qu’il est la cause immuable de tous les effets qui ne dépendent point du libre arbitre de l’homme, qu’il l’est encore de ceux qui en dépendent. De sa perfection souveraine il suit nécessairement qu’il pourrait l’être, c’est-à-dire qu’il pourrait n’avoir point donné de libre arbitre à l’homme ; mais puisque nous sentons en avoir, il me semble qu’il répugne au sens commun de le croire dépendant en ses opérations, comme il l’est dans son être.
Si on est bien persuadé de l’immortalité de l’âme, il est impossible de douter qu’elle ne sera plus heureuse après la séparation du corps (qui est l’origine de tous les déplaisirs de la vie, comme l’âme du plus grand contentement) sans l’opinion de M. Digby (6), par laquelle son précepteur (7) (dont vous avez vu les écrits) lui a fait croire la nécessité du purgatoire, en lui persuadant que les passions qui ont dominé sur la raison, durant la vie de l’homme, laissent encore quelques vestiges en l’âme, après le décès du corps, qui la tourmentent d’autant plus qu’elles ne trouvent aucun moyen de se satisfaire dans une substance si pure. Je ne vois pas comment cela s’accorde avec son immatérialité. Mais je ne doute nullement, qu’encore que la vie ne soit point mauvaise de soi, elle doit être abandonnée pour une condition qu’elle connaîtra meilleure.
Par cette providence particulière, qui est le fondement de la théologie, j’entends celle par laquelle Dieu a, de toute éternité, prescrit des moyes si étranges, comme son incarnation, pour une partie du tout créé, si inconsidérable au prix du reste, comme vous nous représentez ce globe en votre physique ; et cela, pour en être glorifié, qui semble une fin fort indigne du créateur de ce grand univers. Mais je vous présentais, en ceci, plutôt l’objection de nos théologiens que la mienne, l’ayant toujours cru chose très impertinente, pour des personnes finies, de juger de la cause finale des actions d’un être infini… »
_______________
(1) Élisabeth cite en latin : « quam nos virtuti legem dicimus, eam ille dicit voluptati » (De la vie heureuse, XIII).
(2) « Ego enim nego quemquam posse jucunde vivere, nisi simul et honeste vivat. » (Ibid. IX)
(3) Des conséquences du souverain bien (Ibid. XV)
(4) A Ryswick. Élisabeth séjourne d’ordinaire à La Haye.
(5) Née en 1618, Élisabeth a alors 27 ans.
(6) Chevalier anglais fidèle à Charles 1er, il aurait voulu attirer Descartes en Angleterre. Il publie deux ouvrages en anglais à Paris en 1644, un Traité de la nature des corps et un Traité sur les opérations et la nature de l’âme humaine, d’où se déduit l’immortalité des âmes raisonnables.
(7) Sans doute Thomas White, aux nombreux pseudonymes, dont Albius ou Albanus, Blanc ou le Blanc ou encore M. Vitus. Prêtre anglais et philosophe dont Descartes apprécie Trois Dialogues sur le monde, sa création, ses formes et ses causes (1640). Très lié à Digby, il lui a adressé sa Partie théorique des Institutions Péripatétiques (1647 pour la deuxième édition), d’où peut-être le surnom de précepteur (ou instituteur).
Sources : voir supra.
Allons plus loin : Descartes et le sens du mot passion au 17e siècle
Le terme passion a une signification très large, héritée des catégories d’Aristote et de la philosophie scolastique en général. Descartes, dans le Traité des Passions de l’âme (1649), désigne ainsi tous les phénomènes passifs de l’âme, les modifications produites en elle, de façon involontaire, par l’agitation des « esprits animaux ». La théorie physiologique de l’origine de passions est aujourd’hui abandonnée mais elle nous aide à mieux comprendre la psychologie cornélienne : la volonté ne peut pas directement changer nos passions car elles s’accompagnent d’une « émotion » des esprits animaux qui s’impose à l’âme. Mais la volonté peut agir indirectement sur les passions en suspendant les actes dictés par les passions, en suscitant des passions contraires et elle peut même faire naître des passions conformes à une tendance raisonnable. Ainsi, raison, « gloire » (honneur), grandeur d’âme et générosité caractérisent les héros cornéliens.
Pour mieux comprendre le Traité des passions
Descartes aborde la vie morale avec le souci d’éclairer les rapports de l’âme au corps. Dans la première partie, il explique comment les passions sont communiquées à l’âme par le corps : avoir peur, c’est prendre conscience que le corps tremble. Plus l’âme est raisonnable, mieux elle peut imposer ses volontés au corps. La seconde partie analyse les principales passions, l’Admiration, l’Amour, la Haine, le Désir, la Joie et la Tristesse. Enfin, la troisième partie est consacrée aux passions particulières, notamment à la Générosité qui « fait que l’on ne s’estime que selon sa juste valeur » et qui constitue un remède général contre tous les dérèglements des passions.
Loin de les condamner, Descartes définit les passions comme des « plaisirs à part » de l’âme, pour peu que la volonté souveraine de l’homme parvienne à transformer de simples appétits ou manifestations physiologiques en joies et triomphes de l’esprit.
Descartes fonde donc la psychologie sur la physiologie et, en cela, s’avère résolument moderne. Les Passions se rattachent au climat héroïque de l’époque (cf. le théâtre de Corneille) où la volonté éclairée par la raison cherche, non à étouffer les passions, mais à les diriger vers le bien. Cette interprétation des passions comme un mécanisme psycho-physique normal et de la moralité comme une connaissance rationnelle sera reprise dans l’Éthique de Spinoza.
Toutefois, Le Cid fut écrit treize ans avant la parution du Traité : on ne peut donc parler d’influence directe. Mais Descartes, témoin de l’esprit d’une époque, a donné une expression nette et définitive aux tendances confuses de son temps vers l’ordre, la logique et la raison. Il est donc aisé de trouver, dans les quelques 212 articles dont l’oeuvre est composée, des réflexions qui rappellent le climat héroïque de l’époque en général.
Selon lui, tandis que les « actions de l’âme sont nos volontés à cause que nous expérimentons qu’elles viennent directement de notre âme et semblent ne dépendre que d’elle », on peut au contraire considérer comme passion « toute pensée qui est excitée dans l’âme sans le secours de la volonté par les seules impressions qui sont dans le cerveau. » Tout ce qui n’est pas manifestations de l’activité volontaire est considéré comme passion. Pour Descartes, perception, sentiments, émotions sont des « passions ». Cependant Descartes précise que le terme de « passion » définira pour lui surtout des émotions car « parmi toutes les pensées de l’âme les passions sont celles qui l’agitent et l’branlent le plus fort. » Les six passions fondamentales citées par Descartes (admiration, amour, haine, désir, joie et tristesse) sont des réactions affectives de l’individu à certains objets et renvoient aux besoins et tendances.
Pour tous les moralistes du 17e siècle, les passions désignent les « appétits » de l’être vivant.
Le sentiment régule mais la passion apparaît comme un déséquilibre : il s’agit du sentiment monstrueux d’un sentiment aux dépens de tous les autres. Harpagon (L’Avare) ne songe qu’à sa cassette, Nicodème (Corneille) s’écrie : « Un véritable roi n’est ni mari ni père, / Il regarde son trône et rien de plus. » Au 18e siècle, le chevalier des Grieux oubliera tous ses devoirs pour Manon Lescaut.
La passion d’empare de l’intelligence et de l’imagination, nous attache à des objets souvent médiocres qu’elle recouvre de prestiges illusoires (cf. la « cristallisation » de Stendhal) et semble par là nous déposséder de notre maîtrise et nous entraîner à des actes dont nous cessons réellement d’être les maîtres. Ainsi est-il nécessaire de conserver aujourd’hui cette signification de passivité qui, dans la tradition philosophique, d’Aristote à Descartes, inspire l’opposition de la passion (passivité, le fait de subir) et de l’action. Le passionné se définit lui-même comme un possédé, comme la victime d’une force fatale qui s’est emparée de lui. Phèdre avoue qu’elle a pris sa « flamme en horreur » et Oreste s’écrie : « Je me livre en aveugle au destin qui m’entraîne. »
Si Descartes voit dans la passion le signe de la dépendance de l’âme, en partie soumise au corps, il reconnaît à la fin du Traité des passions, que si l’âme a aussi ses plaisirs propres, indépendants du corps, il n’en reste pas moins que « les hommes que les passions peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie. » Bien loin de condamner les passions, il définit les passions comme des « plaisirs à part » de l’âme, pour peu que la volonté souveraine de l’homme parvienne à les transformer, de simples appétits ou manifestations physiologiques qu’elles risquent d’être, en joies et triomphes du cœur et de l’esprit.
Descartes a contribué à orienter la littérature vers l’expression des idées et les analyses psychologiques et morales. La Princesse de Clèves en est un bon exemple.
Article 204 : la gloire (1) (Extrait du Traité des Passions)
« Ce que j’appelle du nom de gloire est une espèce de joie fondée sur l’amour qu’on a pour soi-même et qui vient de l’opinion ou de l’espérance qu’on a d’être loué par quelques autres. Ainsi elle est différente de la satisfaction intérieure qui vient de l’opinion qu’on a d’avoir fait quelque bonne action ; car on est quelquefois loué pour des choses qu’on ne croit point être bonnes, et blâmé pour celles que l’on croit être meilleures : mais elles sont l’une et l’autre des espèces de l’estime qu’on fait de soi-même, aussi bien que des espèces de joie ; car c’est un sujet pour s’estimer que de voir qu’on est estimé par les autres. »
_ _ _
Notes
(1) Terme utilisé sans cesse après 1650 par Mmes de La Fayette, Sévigné, Maintenon et bien d’autres.
En résumé : analyse du Taité des Passions et psychologie cornélienne
Pour Descartes, les passions sont de brutales impulsions qui ont leur origine dans le corps : l'âme doit, avant de s'y abandonner, leur imposer le double contrôle de la raison et de la volonté. La raison se prononce sur la valeur de l'objet.La volonté, s'il y a lieu, réfrène la passion condamnable et en suspend les manifestations extérieures.L'amour subit la loi commune des passions : c'est par essence l'élan vers la perfection, mais la raison doit toujours vérifier si la perfection réside réellement dans l'objet qu'il a élu.
Corneille n'a jamais dit autre chose. Corneille et Descartes sont de la même génération : ils ont grandi entre les souvenirs d'un terrible passé et les secousses d'un présent encore troublé : conspirations contre Richelieu, Guerre de Trente ans ont forgé, d'une manière générale, de fortes et rudes natures, peu disposées à s'amuser aux enfantillages de la vie sentimentale, capables et avides d'action.On peut dire que Richelieu et Retz sont les prototypes vigoureux de la définition donnée par Descartes et du portrait dressé par Corneille.
Bien entendu, cette courte analyse (qui émane de Lanson) est à nuancer. Toutefois, on peut retenir que la théorie de l'amour chez Corneille, fondé sur l'estime,est cartésienne : l'amour est la connaissance du bien. Il change dès que que la connaissance change car celle-ci dispose pour se faire obéir d'un instrument : la volonté. Ainsi, l'héroïsme cornélien est l'affirmation de la volonté. Tel est le sublime cornélien.Il n'a pas forcément un caractère moral mais implique simplement de l'énergie.
Descartes biographié
Dans son ouvrage Le Pari biographique (Editions La Découverte, 2005), François Dosse s’intéresse à Descartes. Il écrit :
« Une manière féconde d’interroger l’itinéraire intellectuel d’un penseur nous est transmise par un type particulier de biographie qui consiste à examiner les diverses facettes, la multiplicité de appropriations de l’icône et les étapes traversées dans la conquête de la reconnaissance d’une grandeur par la société. C’est le projet que s’assigne Stéphane Van Damme dans sa biographie de Descartes (Descartes, Presses de Sciences-Po, 2002) [...]
Dans le même esprit, François Azouvi montre que le cartésianisme commence surtout après la mort de Descartes qui a été contraint à l’exil et dont l’œuvre a été mise à l’Index en 1663 : « Singulier destin d’un philosophe que rien, semblait-il, ne prédisposait à incarner une nation. » (Descartes et la France) [...]. Il étudie en quoi Descartes constitue une étape dans la construction de l’identité nationale de la France « par le biais du sort – ou des sorts – qu’elle réserve à l’auteur du Discours de la méthode depuis sa mort jusqu’à la période contemporaine. »
C’est dans la postérité longue de son œuvre que se trouvent les bases de sa grandeur, et cela implique de prendre en considération ce que françois Azouvi distingue comme les divers « cercles » de lecture du cartésianisme, qui appartiennent à des mondes culturels dont Descartes ne pouvait avoir la moindre idée, car les enjeux se sont déplacés au fil d’un temps qui n’est plus le sien. François Azouvi perçoit un premier cercle, celui des historiens de la philosophie, qui comprend les lectures de Descartes par Malebranche, Leibniz ou Spinoza, puis un second, qui relève encore de l’histoire de la philosophie et qui inclut Degérando et Victor Cousin. Le cercle va aussi s’ouvrir à des lectures moins internes à la philosophie avec Louis-Sébastien Mercier, Lamennais ou Péguy, ce dernier associant Descartes dans son hommage à Jeanne d’Arc pour célébrer la grandeur française.
Compte-tenu de sa problématique, celle de la réception d’une œuvre, François Azouvi accorde davantage d’attention à certains usages sociaux de Descartes qu’à des lectures sophistiquées et profondes de son œuvre.
C’est aussi dans cette perspective que s’inscrit Van Damme [...]. Cela présuppose de ne pas figer la pensée d’un auteur, de ne pas clore la portée de ses écrits à son temps de vie, et Van Damme invite à envisager la biographie intellectuelle dans ses grandeurs successives, ce qui implique une attention aux divers espaces ou cercles herméneutiques d’appropriation des thèses cartésiennes. Mieux comprendre la nouveauté du message cartésien, son souci de vérité et d’unité de la démarche scientifique, implique de prendre ses distances avec une démarche décontextualisante en restituant avec précisions les étapes de son parcours biographique inséré à l’intérieur des réseaux et des correspondants qui l’ont accompagné. Le biographe est donc attentif à dresser une véritable cartographie en évolution de la diffusion de l’œuvre de Descartes qui s’attache à repérer les justifications des éditeurs expliquant ce qui les a motivés dans leur participation de son œuvre, jouant ainsi un rôle majeur dans les évaluations de la grandeur de Descartes comme dans l’émergence du cartésianisme. Il en résulte un élargissement des cercles constitutifs de cette grandeur avec un transfert qui fait passer la réception de l’œuvre des premiers espaces familiaux aux patronages princiers, en passant par la désignation de nouveaux intermédiaires capables d’assurer cette métamorphose du cartésianisme : « Les savoirs cartésiens vont être l’objet d’usages sociaux diversifiés et devenir un phénomène culturel de large ampleur. » [...]
Après avoir suivi les transformations de l’icône jusqu’à sa panthéonisation et au culte rendu à celui qui est devenu un véritable « Dieu-fétiche », le biographe étudie les divers mondes cartésiens et retrouve alors le sujet biographié comme personne dans son rapport aux autres, à l’intérieur de ses pratiques, que ce soit celle de l’homme de lettres, de l’homme de science ou du philosophe de cour, puisqu’il achève son itinéraire au service direct de la reine Christine de Suède jusqu’à sa mort le 11 février 1650... »
_ _ _ Fin de citation.
* * *
Date de dernière mise à jour : 24/02/2020