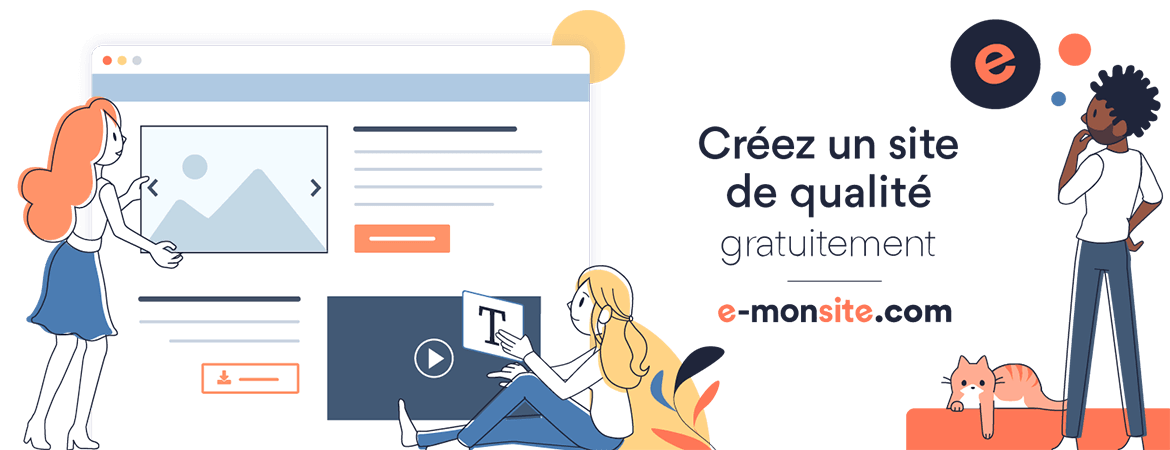Lettres portugaises
L'incroyable aventure des Lettres portugaises : mystification ou authenticité ?
Parues le 4 janvier 1669 chez l’éditeur parisien Claude Barbin, traduites du portugais, ces lettres exprimaient une passion dévorante et pathétique. Barbin les avait lues dans les cercles littéraires où elles circulaient sous le manteau. Il décida de les publier et obtint un privilège de publicité le 28 octobre 1668. Il les présenta « au lecteur » en déclarant qu’il ignorait le nom de leur possesseur – du destinataire – comme celui de leur traducteur et ne révéla ces noms que dans la seconde édition de l’ouvrage.
Le public apprit alors que Les Lettres étaient traduites par Guilleragues, secrétaire du cabinet du roi [1] et écrites par une religieuse portugaise à un gentilhomme français, le comte Chamilly de Saint-Léger, qui avait fait campagne au Portugal.
Le succès du volume fut immense : cinq éditions parurent en sept mois : Barbin en donna deux, Pierre du Marteau (de Cologne) également deux, et Isaac Van Dyck, d’Amsterdam, en publia une.
Mais ce succès entraîna partout des séries de « suites », de « nouvelles lettres », de « réponses » apocryphes, ayant pour but d’exploiter la vogue des premières qui, seules, sont authentiques et considérées comme le premier roman épistolaire français, ce qui n’est pas rien. Des batailles d’opinions sur l’origine des Lettres se déclenchèrent.
Des analyses approfondies faites par des linguistes portugais reconnurent l’authenticité de l’expression. Les archaïsmes trahissaient leur origine, ainsi que l’oubli de tout souci d’effet littéraire ou de recherche linguistique.
En 1810, un Académicien, E. de Boissonnade, permit d’établir indiscutablement leur authenticité en découvrant sur un exemplaire de la première édition de Barbin, une note manuscrite déclarant : « La religieuse qui a écrit ces lettres s’appelait Mariana Alcoforado, religieuse à Beja, entre l’Estrémadure et l’Andalousie. Le chevalier à qui elles furent écrites était le comte de Chamilly, appelé alors comte de Saint-léger. » Sur cette précieuse indication, les littérateurs portugais reprirent leurs investigations, découvrirent les Archives de la famille Alcoforado et purent reconstituer l’identité et la passion des deux amants.
Mariana Alcoforado était née, comme en témoigne son acte de baptême, le 22 avril 1640 à Beja, fille de Dom Francisco da Costa Alcoforado et de Léonor Mendez. Elle mourut le 28 juillet 1723 d’après l’acte de décès dans le Registre du Couvent royal de Notre-Dame-de-la-Conception. D’une noble et puissante famille, Mariana entra au couvent à l’âge de neuf ans et prit le voile à onze sur l’ordre de son père. Elle avait vingt ans lorsque la guerre éclata entre l’Espagne et le Portugal. Le roi Alphonse VI dut faire appel à la France et Louis XIV envoya un corps expéditionnaire, commandé par le général de Schomberg, dont les troupes campèrent à Beja. Parmi les officiers se trouvait le comte de Saint-Léger que Saint-Simon décrit comme « beau et bien fait ». Il fut remarqué par la jeune religieuse qui, derrière les fenêtres grillagées, suivait le mouvement des troupes. Comme l’entrée du couvent était un droit de guerre accordé aux gentilshommes en campagne, Mariana et Saint-Léger se rencontrèrent au parloir pendant les soirées de trêve. Une ardente et brève passion se déclara : le scandale entraîna le rappel de l’officier en France. C’est alors que Mariana écrivit ses lettres où on crut déceler le caractère farouche, primitif et héroïque de l’âme portugaise. Chamilly écrivit quelques brèves réponses qui ne furent jamais retrouvées. Le cloître se referma sur Mariana. « Elle y fit trente ans de rigoureuses pénitences et s’éteignit en donnant les signes de la prédestination », ainsi qu’il est écrit dans le registre du couvent après son acte de décès.
Cette approche critique des Lettres portugaises a été totalement renouvelée par les travaux de Frédéric Deloffre et Jacques Rougeot. En 1962, ils publièrent une nouvelle édition, dans laquelle ils attribuèrent à Guilleragues, considéré jusqu’alors comme le simple traducteur, la paternité de l’ouvrage, une pure fiction.
Cette attribution à Guilleragues semble aujourd’hui prévaloir, même si le problème de l’authenticité reste posé par d’autres éditions récentes.
Sources : Dictionnaire des lettres françaises, Le XVIIe siècle, collectif, Fayard, 1951, 1996.
_ _ _
Notes
[1] D’autres sources le disent ambassadeur à Constantinople, l’un n’empêchant pas l’autre.
Analyse stylistique des Lettres portugaises (Guilleragues, 1669) – Extraits
 Les Lettres portugaises, premier roman épistolaire, sont parues en 1669, sans nom d’auteur. Succès immédiat pour cet ouvrage composé de cinq lettres, soi-disant écrites par une religieuse portugaise à un chevalier français dont elle serait tombée amoureuse. On a longtemps [1] cru à l’authenticité de ces lettres, en raison de l’anonymat et de la Préface qui les introduit (voir supra).
Les Lettres portugaises, premier roman épistolaire, sont parues en 1669, sans nom d’auteur. Succès immédiat pour cet ouvrage composé de cinq lettres, soi-disant écrites par une religieuse portugaise à un chevalier français dont elle serait tombée amoureuse. On a longtemps [1] cru à l’authenticité de ces lettres, en raison de l’anonymat et de la Préface qui les introduit (voir supra).
Cinq lettres, comme les cinq actes d’une tragédie classique dont le dénouement – le silence – équivaut à la mort symbolique de la religieuse…
Passion dévorante, exacerbée : Mme de Sévigné, qui a lu l’ouvrage, reprend l’adjectif du titre et, à propos d’une lettre d’un de ses correspondants, la qualifie de « portugaise », synonyme pour elle de passionnée.
Il faudra attendre l’année 1962 pour que deux universitaires [2] prouvent qu’il s’agit bien d’une fiction, œuvre de Guilleragues, auteur d’épigrammes, chansons et madrigaux. Ambassadeur de France à Constantinople, il s’ennuie et… écrit ces Lettres, véritable coup de maître.
Un chevalier français – on ignore son nom -, en poste au Portugal, séduit Mariane (sic), une jeune religieuse enfermée dans son couvent, lui promet un amour éternel, retourne à la guerre puis en France, l’abandonnant au désespoir et à la solitude. En écrivant ces lettres, Mariane prend peu à peu conscience de sa situation et des ravages d’une passion unilatérale. Le motif de l’absence devient donc le thème de l’oeuvre.
Quelques extraits commentés
L’absence
* « Une passion sur laquelle tu avais fait tant de projets de plaisirs, ne te cause présentement qu’un mortel désespoir, qui ne peut être comparé qu’à la cruauté de l’absence qui le cause. » (Lettre I) => Ancrage de l’absence dès la première lettre.
* « Quoi ? Cette absence, à laquelle ma douleur, tout ingénieuse qu’elle est, ne peut donner un nom assez funeste, me privera donc pour toujours de regarder ces yeux dans lesquels je voyais tant d’amour, et qui me faisaient connaitre des mouvements qui me comblaient de joie. » (ibidem) => Discours de la passion réduit au désespoir tragique car racine amputée. Impossibilité à qualifier l’absence, sauf par l’hyperbole « un nom assez funeste ».
* « Écrivez-moi souvent ». (ibidem) => Espoir.
* « Il me semble que je vous parle, quand je vous écris, et que vous m’êtes un peu plus présent. » (Lettre IV) => nécessité de la lettre, tentative de rétablir le contact : la lettre n’est pas un prétexte ou un artifice mais est subordonnée à la nécessité de l‘histoire racontée.
* « Pourquoi ne m’avez-vous point écrit ? » (ibidem) => Absence de l’amant et absence de lettres.
* Cette absence envahit tout l’espace de Mariane, sa vie comme son discours. Certes, le chevalier lui répond – ses lettres ne sont pas consignées – mais Mariane n’y trouve aucun réconfort puisqu’elles ne parlent pas d’amour et donc, à ses yeux, n’existent pas : « Vous demeurez dans une profonde indifférence, sans m’écrire que des lettres froides, pleines de redites ; la moitié du papier, n’est pas remplie, et il paraît grossièrement que vous mourez d’envie de les avoir achevées. » (Lettre IV) Elle écrit déjà dans sa première lettre : « Ne remplissez plus vos lettres de choses inutiles, et ne m’écrivez plus de me souvenir de vous. » => Opposition entre « remplir » et « inutile », c’est-à-dire entre la plénitude qu’elle espère et le vide qu’elle ressent.
* « J’espérais que vous m’écririez de tous les endroits où vous passeriez, et que vos lettres seraient fort longues. » (Lettre III) => Lettres courtes et rares.
* « Vos impertinentes protestations d’amitié et les civilités ridicules de votre dernière lettre m’ont fait voir que vous aviez reçu toutes celles que je vous ai écrites, qu’elles n’ont causé dans votre cœur aucun mouvement, et que cependant vous les avez lues. » (Lettre V) => Discours de l’amant quasiment inexistant et fuyant : Mariane ne peut s’y référer. Lexique dépréciatif : « impertinentes », « ridicules ». Jugement de Mariane.
* « Je ne puis quitter ce papier, il tombera entre vos mains, je voudrais bien avoir le même bonheur. » (Lettre I) => Identification, assimilation entre Mariane et ses lettres. La lettre devient pour le destinataire une métonymie de l’expéditeur : présence réelle des partenaires.
Les temps
L’histoire de l’œuvre, c’est l’histoire des lettres, un présent de la narration qui relègue à l’arrière-plan la relation amoureuse. Les évocations du passé sont rares ou bien dépendent du présent, c’est-à-dire de l’abandon et de sa prise de conscience.
Ainsi l’incipit : « Considère, mon amour, jusqu’à quel excès tu as manqué de prévoyance. Ah ! malheureux ! tu as été trahi, et tu m’as trahie, par des espérances trompeuses. Une passion sur laquelle tu avais fait tant de projets de plaisirs, ne te cause présentement qu’un mortel désespoir, qui ne peut être comparé qu’à la cruauté de l’absence qui le cause. » (Lettre I). => Le passé composé signale un contexte révolu : « tu as manqué, tu as été trahi, tu m’as trahie ». Le plus-que-parfait (« tu avais tant de projets ») renforcent le lointain de ce passé, ainsi que les termes abstraits « projets » et « plaisirs ». Ces deux temps sont liés au présent : « ne te cause présentement qu’un mortel désespoir, qui ne peut être comparé qu’à la cruauté de l’absence qui le cause. » L’adverbe « présentement » unit le temps de l’histoire à celui de la narration, d’où le désespoir de Mariane dont les lettres se font l’écho. Le temps de l’écriture (« causer » est au présent) s’associe à la négation et à la restriction (« ne… que ») pour resserrer le point de vue et introduire la cause du désespoir. Une cause double (« comparé à ») : erreur (ou mensonge cruel) et absence.
Mais le passé composé est aussi le temps le plus proche du présent et donc le plus apte à traduire les affres de la passion : « Je vous ai destiné ma vie aussitôt que je vous ai vu et je sens quelque plaisir en vous la sacrifiant. » (Lettre I). Le coup de foudre immédiat se revit par le passé composé relié à un présent (« je sens ») qui montre un mouvement, un trajet, une suite logique conduisant à la situation actuelle de Mariane au moment où elle écrit au chevalier, et non à celui où elle recompose son passé. Elle n’écrit pas ses mémoires : quand elle dit « je », elle se tourne vers l’autre. On peut y voir une nouvelle forme d’introspection en cette fin de siècle, ces Lettres étant, ne l’oublions, pas, le premier roman épistolaire. Mariane est lucide sur la gravité de sa situation : « Je suis au désespoir, votre pauvre Mariane n’en peut plus, elle s’évanouit en finissant cette lettre. Adieu, adieu, ayez pitié de moi. » (Lettre II)
Le lieu
Autre facteur important d’enfermement, le choix du lieu : Mariane est enfermée dans un couvent, comme dans son propre soliloque. Le couvent peut être [3] un lieu de retraite privilégié pour la réflexion et le recueillement. Ici, il fonctionne autrement et devient cloître et prison, empêchant la communication devenue vitale, d’où la nécessité des lettres. Contrairement à certains mémoires qui évoquent le couvent comme cadre du récit, il devient un obstacle : « S’il m’était possible de sortir de ce malheureux cloître, je n‘attendrais pas en Portugal l’effet de vos promesses ; j’irais sans garder aucune mesure vous chercher, vous suivre, vous aimer par tout le monde. » (Lettre I) On retrouve ici l’unité de lieu chère à la tragédie classique. Clôture inutile, comme l’annonce la deuxième lettre : « Un oubli qui me met au désespoir. » Pas de réponse, défaite de l’échange inscrite à l’ouverture de la troisième lettre : « Je me trouve bien éloignée de tout ce que j’avais prévu : j’espérais que vous m‘écririez de tous les endroits où vous passeriez, et que vos lettres seraient fort longues ; que vous soutiendriez ma passion, par l’espérance de vous revoir. »
Monologue introspectif
À partir de là, Mariane renonce à tout espoir et écrit pour elle-même, se livrant à l’introspection, à la recherche des causes de son amour. Elle ne cherche plus à instaurer de dialogue mais institue un monologue : la lettre devient le reflet d’elle-même.
Dans la cinquième et dernière Lettre, Mariane décide de ne plus écrire puisque ses lettres ne lui servent qu’à s’épancher d’une manière répétitive et n’ont pas ramené l’amant : « Mais je ne veux plus rien de vous, je suis une folle de redire les mêmes choses si souvent, il faut vous quitter et ne penser plus à vous, je crois même que je ne vous écrirai plus. » L’échec du dialogue conduit au solipsisme [4] : « J’ai éprouvé que vous m’étiez moins cher que ma passion. » Ainsi, la lettre perd sa valeur en tant que message à l’autre et devient expression d’un individu à la quête de soi.
Ce roman épistolaire est un texte fondateur :
- distance entre les correspondants
- absence définitive du destinataire
- amour vécu dans l’absence et le déchirement
- du point de vue de celui qui l’éprouve
- discours à la 1re personne : précision et vérité dans la description de la passion et dans le discours qui la nourrit et la génère.
_ _ _
Notes :
[1] Trois siècles !
[2] Frédéric Deloffre et Jacques Rougeot.
[3] Dans la littérature.
[4] Attitude d'une personne qui, dans son expression, sa création, sa vision du monde, privilégie la solitude de sa subjectivité.
Sources : Le Roman épistolaire, Fréderic Calas, Armand Colin, 2007, pp. 67-74.
Les cinq lettres en bref
La Première Lettre, remplie de la douleur et de de la révolte causées par la séparation, est encore éclairée par les illusions tenaces, le vague espoir d'un retour de l'aimé, la certitude surtout que l'amour est réciproque ("Le destin ne saurait séparer nos coeurs").
La Deuxième Lettre, écrite six mois après, traduit un amour solitaire, replié sur lui-même devant l'indifférence et les dérobades de l'absent. La passion reste l'unique raison de vivre, mais le doute et la souffrance s'installent.
La Troisième Lettre suppose que l'autre n'a jamais aimé. L'amour dédaigné tourne en rond dans le vide et l'angoisse : comment survivre quand l'amant se tait ? L'héroïne est humiliée.
La Quatrième Lettre peur surprendre car elle semble interrompre la montée du désespoir, tant elle est pleine de passion dans ses questions et ses reproches, ses regrets et ses désirs, ses élans et ses souvenirs.
La Cinquième lettre se veut celle du renoncement ; l'amoureuse n'opposera plus que le mépris et le silence à l'indifférence de l'autre, mais la passion n'est pas morte, la lettre semble quémander une réponse et les derniers mots sont loin d'être définitifs. La notion stendhalienne de "cristallisation" permet de comprendre l'évolution du sentiment amoureux.
Pour terminer, une citation de Rousseau pour lequel le mérite du roman épistolaire est de laisser " le coeur parler au coeur."
* * *
Date de dernière mise à jour : 23/02/2020